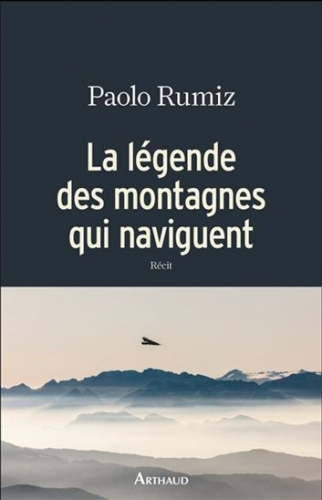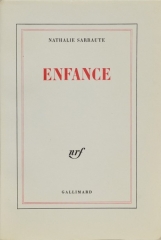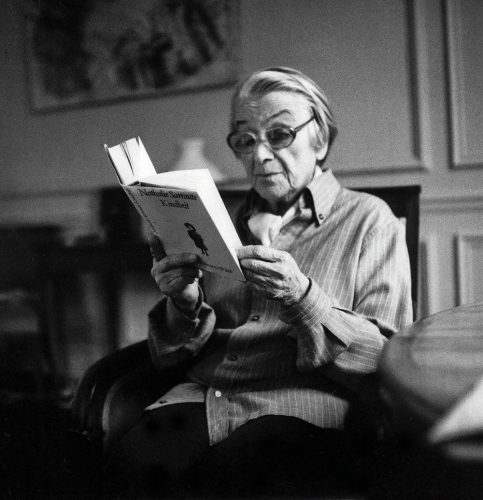La légende des montagnes qui naviguent (2007, traduit de l’italien par Béatrice Vierne, 2017) de Paolo Rumiz correspond à ce que j’écrivais ici pour conclure ma première lecture du journaliste et écrivain-voyageur italien (né en 1947) : « Ni cours d’histoire ni cours de géographie, Aux frontières de l’Europe est une succession d’expériences et surtout de rencontres. Raconter, écouter, apprendre, comprendre. « Chemin faisant. » »
Cette fois, le « fils de ce vent qu’on appelle la bora » a entrepris dans les Alpes et dans les Apennins, « le cœur du monde euro-méditerranéen », une « traversée en zigzag de huit mille kilomètres, soit la distance de l’Atlantique à la Chine », entre le printemps 2003 et l’été 2006. En terminant le dernier chapitre sur les Alpes (Du Grand Paradis à Nice), j’ai déjà envie de vous en parler avant d’entamer la lecture de la seconde partie.
Une carte est utile pour suivre ce voyage de l’est vers l’ouest. Le récit commence en Croatie sur un bateau, « dans la baie de San Giorgio dans l’île de Veglia – en croate, la baie de Sveti Juraj dans l’île de Krk ». La première destination : le Montemaggiore ou l’Ucka. « Tout à coup, dans la bourrasque, tout devint clair. Les comptes étaient bons, nos chœurs de montagnards chantés en mer devenaient une cosmogonie, la perception d’une genèse. Mais évidemment ! Nous étions en train de naviguer sur les Alpes ! »
Braudel parlait de la Méditerranée comme d’une « mer de montagnards », un espace où les bergers deviennent capitaines de vaisseau. Avec ses compagnons, Paolo Rumiz vagabonde « dans l’archipel du vent ». Il est de Trieste, « le seul endroit d’Italie d’où l’on peut voir les Alpes de l’autre côté de l’eau ». Embarquons donc pour la Croatie, l’Autriche, la Suisse, l’Italie, la France.
Eté 2003, « une chaleur à crever ». Avec un guide natif de Fiume, « une ville parfaite » où l’on peut escalader les Alpes le matin et le soir tremper ses pieds dans la mer, il cherche sur une carte « le commencement des Alpes » qui ne figure dans aucun guide. « Décollage à la verticale » sur un petit escalier qui mène aux pentes « envahies d’arbustes épineux qui avaient jadis été des vignes ». Une montée lente, « avec le plaisir clandestin d’une aventure à deux pas de chez nous, absolument seuls sur une route jalonnée d’antiques bornes » (la via Carolina, « grandiose et oubliée »).
Dans le bourg de Vrata, personne ne sait où elles commencent les Alpes. Une vieille dame en noir les envoie chez une amie, celle-ci chez la maîtresse d’école, qui les envoie chez un géographe, professeur à l’université de Zagreb, mais « géographe marin », leur dit-il – « Les Croates ne savaient pas qu’ils appartenaient à une nation alpine, donc nous fûmes obligés de leur expliquer. »
En 2005, Rumiz est au cimetière militaire de Redipuglia pour exaucer le vœu de Carlo Orelli, dernier témoin de la première guerre mondiale, qui venait de mourir à cent dix ans. Les fascistes ont construit ce cimetière en 1938 pour plus de cent mille soldats italiens morts au front durant la Grande Guerre. Puis le voilà à bicyclette à Caporetto en Slovénie pour nous parler des ours qui descendent jusque dans les jardins de la vallée, si nombreux (de quatre à six cents) qu’ils fuient en Italie, profitant des alpages abandonnés.
Ainsi se tisse peu à peu La légende des montagnes qui naviguent. A la description du chemin, des aléas du voyage, se mêlent l’histoire et l’actualité, les bergers et les chasseurs, les ours et les marmottes, les anecdotes, la réflexion sur l’évolution des modes de vie, la résistance des montagnards, la fuite en avant des promoteurs. Rumiz ne cache pas sa colère contre les dérives contemporaines, l’abandon des territoires et de leurs habitants au profit du tourisme et des loisirs, en Italie surtout, où tant de choses ne fonctionnent plus, où des villages se retrouvent privés d’eau, pompée au profit du ski d’été même là où les glaciers périssent du réchauffement climatique.
Comme en montagne, il faut prendre son temps pour avancer dans ce livre tant il est dense. L’érudition de l’auteur est telle que j’ai bientôt renoncé, pour ma part, à approfondir toutes les allusions géographiques, historiques et sociales qu’il y brasse, pour suivre simplement son rythme. Tous ces arrêts sur image du présent ou du passé ne sont pas des digressions, mais l’exploration de ce qui fait l’âme du monde alpin au début du XXIe siècle.
Le sel de l’aventure, ce sont les rencontres, fortes, parfois de hasard, parfois des rendez-vous : des gens racontent, se souviennent, témoignent. Comme ce vieillard « aussi heureux qu’un rongeur » avant l’hiver, accumulant tout ce qu’il peut même s’il suffirait de descendre au magasin : « Si je fais des provisions, je suis mieux à même d’affronter la saison du repos, de la lecture, du recueillement. »
L’homme au violoncelle vieux de plus de quatre siècles dans la forêt de Paneveggio – « Depuis toujours, les arbres qu’on écoute sont des arbres morts » – à la recherche du « sujet parfait » : il plante son instrument dans le tronc d’un bel arbre abattu pour écouter la résonance, puis dans un arbre vivant, émerveillé. Ryszard Kapuściński, « le plus grand reporter de l’après-guerre », si gentil avec tout le monde, remerciant sans cesse : « Si tu ne montres pas ton respect pour les autres, tu te fermes toutes les portes. »
De chapitre en chapitre, voilà Rumiz au Mont Rose puis au Mont Blanc, où l’on entendait à nouveau les ruisseaux après qu’on avait dévié la circulation des poids lourds à la suite de l’incendie dans le tunnel en 1999 (ils y sont revenus). Hommage à Ulysse Borgeat, ancien gardien du refuge du Couvercle et « papa des alpinistes ». Du Val d’Aoste à Nice, le dernier chapitre m’a particulièrement accrochée – résonances particulières à l’évocation d’une région que l’on a fréquentée. Une pause et on continuera : rendez-vous dans les Apennins.