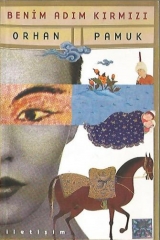Jan (sur un air de jazz) est le septième titre d’Emmanuelle Pol mentionné par la maison d’édition qui publie ses romans et nouvelles depuis 2009. Née à Milan d’une mère française et d’un père italien, elle a grandi en Suisse et vit à Bruxelles depuis une quarantaine d’années. Je ne la connaissais pas. La couverture très graphique de Jan (deux mains sur un clavier, des touches colorées) annonce bien ce récit où sa compagne raconte la vie d’un pianiste de jazz rencontré sur le tard et leur complicité.

Deux pages sur le pays où Jan est né, « une région où s’étendent à perte de vue des champs de betteraves et de pommes de terre », un paysage « conçu pour la grisaille, la pluie et la bourrasque » – des clichés sur la Flandre belge que l’autrice reprend à son compte. Puis vingt-quatre chapitres qui s’ouvrent tous sur quelques lignes en italiques. J’ai aimé ces ouvertures qui rendent une atmosphère musicale, un tempo, un ressenti : « Fragilité, sensibilité, son feutré à fleur de peau. »
Pas de portrait de Jan à proprement parler, mais un étonnement admiratif pour son « incroyable gentillesse ». « Un genre de pureté d’enfant. Un truc d’extraterrestre. » Un grand corps timide, souple, un homme « joyeux ». C’est dans un bar bruxellois bien connu (qui ressemble à l’Archiduc), presque vide en août – « un des concerts gratuits du dimanche après-midi » –, qu’elle croise le regard du pianiste et qu’ils se parlent pour la première fois.
Les yeux de Jan, ses mains, ses oreilles, sa voix, ses jambes, l’amour avec lui, le bonheur d’être ensemble. Après avoir exercé divers métiers, eu « des hommes de toutes les couleurs et de toutes les classes sociales », la narratrice était seule, restée proche d’anciens amants mais indépendante. Jan était seul aussi, excepté « son pote Jozef », ami d’enfance : « Aussi vulgaire que Jan était délicat. Aussi brutal que Jan était doux. Aussi paresseux que Jan était bosseur. »
La musique était sa priorité : « aléas de l’inspiration », tournées, hauts et bas des ventes, affaires d’argent, « faire le job ». La nouvelle petite amie de Jozef, surnommée « Comtesse », plus âgée que lui, parlait volontiers français, ce qui a aidé la narratrice à entrer dans leur cercle. Elle avait emménagé chez Jan, mais seuls les privilégiés passaient le seuil de son studio, sa « grotte ». « J’étais chez moi partout, mais pas là. » Parfois Jan y emmenait ses amis en fin de soirée.
Jan travaillait pendant des heures au piano. Alors elle allait se promener dans les rues venteuses ou montait dans un tram au hasard, observait les gens, les touristes, les familles. « Et soudain ce fut une évidence : si j’étais tombée si amoureuse de Jan, c’est aussi parce qu’il représentait à mes yeux la figure parfaite, la quintessence, l’incarnation même de ce pays triste et joyeux, ce pays morne et vivant, ce pays divisé, têtu, fragile, désordonné, rêveur et commerçant, ce pays qui m’avait accueillie et que j’avais adopté. »
Nicole, la mère de Jan – qu’il salue d’un « Dag’ Mama » –, porte un prénom francophone venu de « l’époque où la bourgeoisie flamande se piquait encore de parler français » et aime la poésie française. Jan, lui, déteste évoquer son passé ; Nicole surprendra sa compagne en lui expliquant le choix du prénom de son fils (lui semble ignorer en ignorer les raisons). Bon élève, il avait été inscrit tôt au Conservatoire. A dix-sept ans, c’était décidé : il serait musicien.
Jozef, enfant brutal, s’était pris d’une amitié viscérale pour ce garçon apparemment si faible, délicat. Quand celle qui partage à présent sa vie remarque que Jan lui donne de l’argent pour l’aider, il répond que son ami n’a pas eu de chance et que ça ne regarde personne. Il va même l’engager comme impresario, sans se rendre compte de ses mauvais choix et de ses erreurs. On sent qu’entre eux, ça finira mal.
Jan est le roman d’une vie dédiée au jazz – l’harmonie, l’improvisation, le rythme – dans un pays dépeint d’une manière forcément subjective. La romancière y montrer les joies et les aléas de la création artistique, les difficultés de la vie d’artiste. On y découvre leur vie intime et, à travers les yeux de la narratrice, la Côte belge, Ostende, la mer du Nord dans les toiles des peintres, Gand préféré à Bruges, les bons restaurants, le formidable Black Cat dont le patron est un ami de Jan et qui sert de cadre à un enregistrement live mémorable.
Emmanuelle Pol entrelace ces thèmes romanesques : « Jan, Jozef, la musique, l’amour et la Belgique ». Dans Le Carnet et les Instants, Michel Zumkir apprécie « la manière dont Emmanuelle Pol raconte cette histoire d’amour entre sexagénaires — une tranche d’âge rare dans les romans — et la manière dont elle évolue. Rien de simple, rien de lisse. » Cette évocation d’une vie avec un musicien ne manque pas d’originalité.
 « A mi-chemin entre la grande falaise et la prairie de la Cloche, se trouvait une large pierre plate sur laquelle Tiburius aimait à se reposer. Là, le sol était sec et sur les grands troncs élancés, le soleil faisait de magnifiques jeux d’ombre et de lumière.
« A mi-chemin entre la grande falaise et la prairie de la Cloche, se trouvait une large pierre plate sur laquelle Tiburius aimait à se reposer. Là, le sol était sec et sur les grands troncs élancés, le soleil faisait de magnifiques jeux d’ombre et de lumière.