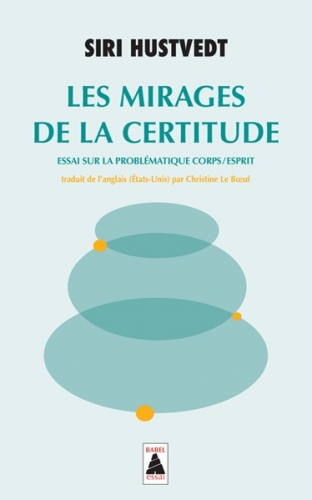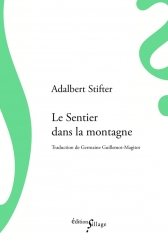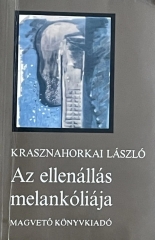Dans Vivre, penser, regarder, Siri Hustvedt, essayiste et romancière, maître de conférence en neurosciences, avait déjà montré à quel point, depuis toujours, elle éprouve une « curiosité constante à l’égard de ce qu’être humain signifie ». Son essai Les Mirages de la certitude (2016, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Christine Le Bœuf, 2018) porte sur « la problématique corps/esprit ».
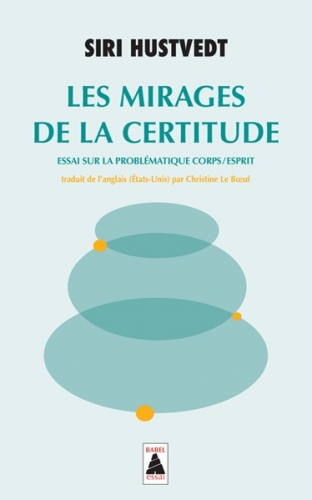
Dès la première phrase, elle se situe de manière critique : « En dépit de prédictions enthousiastes selon lesquelles l’innovation technologique va ouvrir la voie à l’utérus artificiel et à la vie éternelle, il est encore vrai que tout être humain naît du corps de sa mère et que tout être humain meurt. » Si les sciences affinent la description des mécanismes physiologiques, déterminer en quoi consiste l’esprit « et ce qu’il a à voir avec nos corps » reste une question ouverte.
« Tout ça, c’est dans ta tête », dit-on à quelqu’un dont on juge le problème « psychologique » ou « mental ». « Mais de quoi sont faites les pensées ? Si elles ne viennent pas de notre corps, d’où viennent-elles ? » L’autrice se penche sur le « Je pense donc je suis », le propre des humains selon Descartes ; sur le matérialisme de Thomas Hobbes, son contemporain, pour qui pensées et sensations, dans cette « machine » qu’est le corps humain, s’apparentent à des « mouvements du mécanisme cérébral » ; sur les idées de Margaret Cavendish, généralement ignorées de son vivant et redécouvertes, pour qui « l’esprit n’est pas seulement un élément de l’être humain, mais fait partie de la totalité de l’univers ».
Rappelant que toutes les idées sont, « d’une manière ou d’une autre, des idées reçues », Hustvedt « interroge la certitude et prône le doute et l’ambiguïté, non que nous soyons incapables de connaître les choses, mais parce qu’il nous faut examiner nos convictions et nous demander d’où elles viennent. Le doute est fertile en ce qu’il ouvre le penseur à des pensées qui lui sont étrangères. Le doute est générateur de questions. » Vous l’aurez compris, cet essai est rempli de questions très intéressantes.
« Si l’on croit que l’esprit est une chose différente du cerveau, la question devient : De quoi l’esprit est-il fait que le cerveau n’est pas ? » Et si le cerveau est simplement un organe comme un autre, « pourquoi l’esprit est-il considéré comme plus noble qu’une simple partie du corps ? » Il n’y a pas de théorie unique sur la nature de l’esprit : « La confusion règne, et pas seulement chez ceux qui pensent rarement au problème corps/esprit. Scientifiques, philosophes et érudits s’affrontent fréquemment à propos de cette question. »
Son essai est « personnel », écrit Siri Hustvedt dans une longue parenthèse : « je m’efforce de comprendre ce que j’ai eu du mal à comprendre ». Elle s’intéresse aux hypothèses cachées et cherche à bousculer « quelques-unes des convictions fondamentales ou prémisses confuses » de manière à faire comprendre que « beaucoup reste inconnu pour ce qui est de l’esprit et de sa relation au corps et au monde. » Même si nous ne possédons pas ses larges connaissances scientifiques et si certains développements sont ardus, elle arrive à nous y intéresser par son questionnement original.
L’inné et l’acquis, les cerveaux « rigides ou malléables », les histoires de jumeaux, le rationnel et le sensuel… Pour présenter différents points de vue sur ces distinctions, elle rappelle des théories, des expériences, des anecdotes, puise dans la culture populaire, dans les articles scientifiques (dont elle donne les références dans une quarantaine de pages à la fin de l’ouvrage). Dans Esquisse d’une psychologie scientifique, un manuscrit abandonné en 1896, retrouvé et publié en 1950, Freud, neurologue de formation, projetait de donner « une psychologie en tant que science de la nature » où il parlait des neurones comme de « particules matérielles ».
Certains considèrent que les esprits fonctionnent comme des ordinateurs : comment leurs modèles intègrent-ils les émotions, l’expérience sensorielle et sensorimotrice, le flux de conscience ? Hustvedt réaffirme régulièrement que « les humains sont des créatures humides, et non sèches », à la fois par « l’humidité » de la réalité corporelle et pour les distinguer de la théorie computationnelle de l’esprit qui assimile le mental et les neurones conceptuels à une machine de traitement de l’information. Elle ne croit pas à l’avènement « d’une ère post-biologique et surnaturelle de robots brillants et immortels ».
Mémoire, imagination, empathie, il reste tant d’aspects à explorer plus avant dans notre réalité humaine, dans la relation corps/esprit – « des myriades d’incertitudes ». Avec Les Mirages de la certitude, Siri Hustvedt « nous invite dans à ne pas accepter benoîtement un avenir conditionné par des industries qui minimisent l’importance de ce qui fait toute notre humanité. »
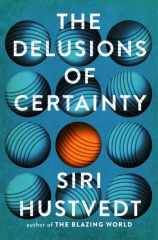 « On peut donc à bon droit s’interroger : pourquoi se soucier de ce qu’est l’esprit ? Il est manifeste que beaucoup de gens vivent leur vie sans gâcher une minute de sommeil à se poser cette question. Or elle est importante, me semble-t-il, parce que la solution qu’on lui apporte a, de manière plus ou moins visible, des conséquences dans de nombreuses disciplines. Par exemple, si les problèmes mentaux relèvent du cerveau et non de l’esprit, pourquoi avons-nous la psychiatrie pour soigner l’esprit et la neurologie pour le cerveau ? Pourquoi pas une seule discipline consacrée au cerveau ? Chaque jour nous apporte des informations nouvelles en provenance des confins de la science du cerveau, de la génétique et de l’intelligence artificielle, et le contenu de ces rapports est déterminé par la façon dont chaque savant comprend le problème corps/esprit.
« On peut donc à bon droit s’interroger : pourquoi se soucier de ce qu’est l’esprit ? Il est manifeste que beaucoup de gens vivent leur vie sans gâcher une minute de sommeil à se poser cette question. Or elle est importante, me semble-t-il, parce que la solution qu’on lui apporte a, de manière plus ou moins visible, des conséquences dans de nombreuses disciplines. Par exemple, si les problèmes mentaux relèvent du cerveau et non de l’esprit, pourquoi avons-nous la psychiatrie pour soigner l’esprit et la neurologie pour le cerveau ? Pourquoi pas une seule discipline consacrée au cerveau ? Chaque jour nous apporte des informations nouvelles en provenance des confins de la science du cerveau, de la génétique et de l’intelligence artificielle, et le contenu de ces rapports est déterminé par la façon dont chaque savant comprend le problème corps/esprit.