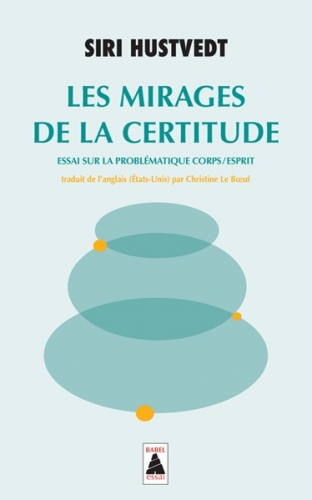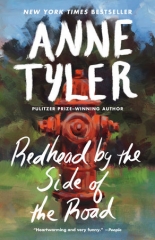Un garçon sur le pas de la porte de la romancière américaine Anne Tyler (°1941) – Redhead on the Side of the Road, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Cyrielle Ayakatsikas – est un roman centré sur une vie ordinaire, celle de Micah Mortimer, la quarantaine, dans un quartier du nord-est de Baltimore. Sa société s’appelle « Techno crack », son surnom au lycée. Devenu aussi « l’intendant clandestin de la résidence où il habite en sous-sol », il travaille officiellement comme installateur et dépanneur à domicile pour ceux qui ont besoin d’aide en informatique. Rien d’exceptionnel mais une histoire bien racontée.

Grand, un peu voûté, il porte toujours « la même tenue : jean, t-shirt ou sweat-shirt selon la saison ». Il a une « bonne amie », mais ils ne vivent pas ensemble. Les gens qui ont besoin de ses services lui téléphonent, des vieilles dames souvent. Très routinier, il a des habitudes pour tout, pour la vaisselle, pour le nettoyage réparti sur chaque jour de la semaine. En voiture, il imagine un « dieu de la Circulation » qui le félicite chaque fois qu’il respecte le code ou fait preuve de courtoisie. « Au moins, cela chassait un peu l’ennui. »
Juste quand il a garé sa voiture devant la maison d’une cliente, son amie Cassia Slade l’appelle. L’institutrice a eu la visite surprise de Nan, la locataire officielle qui lui sous-loue son appartement. Elle n’a pas pu cacher Moustache : Nan, allergique aux poils de chat, est furieuse. Cassia s’attend à ce qu’elle l’oblige à se’en débarrasser ou pire, l’expulse. Micah tente de la calmer ; de toute façon, elle trouverait un autre logement si c’était le cas. Cass coupe court brusquement.
Le premier à aller à l’université dans sa famille, Micah a déçu leurs attentes. Ennuyé par les cours magistraux, il avait bifurqué vers l’informatique et puis abandonné en dernière année pour fonder une société éditrice de logiciels avec un autre étudiant. Leur association n’avait pas marché. Son métier actuel le satisfait – « aucune raison d’être malheureux ».
Chaque visite à domicile le fait entrer dans l’univers de ses clients qu’il finit par connaître. Quand il arrive le soir chez Cassia avec une commande emportée de « son restaurant de grillades préféré », elle a déjà dressé la table. A nouveau, elle réagit mal à son conseil de rappeler Nan elle-même pour y voir clair et n’est pas enthousiaste quand il propose de passer la nuit chez elle.
Le lendemain matin, de retour de son jogging, Micah trouve devant chez lui « un jeune homme vêtu d’un blazer en velours côtelé » qui l’attend. Brink Adams, comme il se présente, connaît le nom de Micah et lorsqu’il complète le sien, Brink Bartell Adams, Micah comprend qu’il est le fils de Lorna Bartell, sa petite amie à l’université, devenue avocate à Washington. Brink a trouvé une photo de Micah parmi les souvenirs de sa mère, celle-ci a parlé de lui comme de son « grand amour ». Il s’est figuré qu’il était le fils de Micah.
Or Brink a dix-huit ans, Micah a arrêté ses études il y a plus de vingt ans et Lorna « se réservait » pour le mariage : il n’est pas le père biologique du garçon. Ce qui le surprend, c’est que Brink avait déjà deux ans quand sa mère s’est mariée. Micah lui conseille de l’interroger, elle, et lui offre un café avant de partir chez un client. Cette visite surprise fait remonter ses souvenirs, il se rappelle leur rupture, le choc quand il avait vu Lorna sur un banc avec un garçon de son groupe biblique qui l’embrassait.
Brink réapparait le soir – il a passé la journée dans une bibliothèque – et est ravi de partager le chili que Micah prépare pour Cass et lui. Il est trop tard pour rentrer dans sa chambre d’étudiant en Virginie et il aimerait dormir sur le canapé, Micah est d’accord. A l’arrivée de Cass, le garçon, très à l’aise, lui annonce qu’il va « squatter la chambre d’ami ». Après le journal télévisé, elle préfère rentrer chez elle, encore inquiète à l’idée de devoir se réfugier dans une voiture si elle perd l’appartement. Le lendemain matin, une suite de textos arrivent sur le téléphone de Brink. Lorna lui demande de donner un signe de vie. Micah enjoint Brink d’appeler sa mère inquiète, mais le garçon prend ses affaires et s’en va.
Les interventions de Micah chez ses clients sont décrites avec humour, de même que le repas chez sa sœur Ada qui nous fait découvrir sa drôle de famille : « des gens bruyants, joyeux, négligés, vêtus de couleurs extravagantes, entourés de chiens qui aboyaient et de bébés qui pleuraient par-dessus le raffut de la télévision, et au milieu de bols de chips et de sauces déjà sauvagement dévorées ». On comprend pourquoi Micah s’est juré de faire les choses autrement, quitte à passer pour un maniaque.
Cass a très mal pris qu’il héberge un inconnu et ne lui ait même pas proposé sa chambre en cas de besoin. Micah manquerait-il d’empathie ? Ses sœurs le persuadent de chercher le numéro de téléphone de Lorna pour la rassurer. Que cache la fugue de son fils ? Le titre de la traduction renvoie à Brink, son visiteur. Le titre original correspond au sentiment de ce célibataire d’être un laissé pour compte, « sur le bord de la route ».
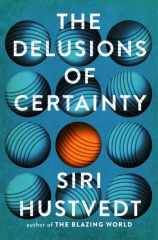 « On peut donc à bon droit s’interroger : pourquoi se soucier de ce qu’est l’esprit ? Il est manifeste que beaucoup de gens vivent leur vie sans gâcher une minute de sommeil à se poser cette question. Or elle est importante, me semble-t-il, parce que la solution qu’on lui apporte a, de manière plus ou moins visible, des conséquences dans de nombreuses disciplines. Par exemple, si les problèmes mentaux relèvent du cerveau et non de l’esprit, pourquoi avons-nous la psychiatrie pour soigner l’esprit et la neurologie pour le cerveau ? Pourquoi pas une seule discipline consacrée au cerveau ? Chaque jour nous apporte des informations nouvelles en provenance des confins de la science du cerveau, de la génétique et de l’intelligence artificielle, et le contenu de ces rapports est déterminé par la façon dont chaque savant comprend le problème corps/esprit.
« On peut donc à bon droit s’interroger : pourquoi se soucier de ce qu’est l’esprit ? Il est manifeste que beaucoup de gens vivent leur vie sans gâcher une minute de sommeil à se poser cette question. Or elle est importante, me semble-t-il, parce que la solution qu’on lui apporte a, de manière plus ou moins visible, des conséquences dans de nombreuses disciplines. Par exemple, si les problèmes mentaux relèvent du cerveau et non de l’esprit, pourquoi avons-nous la psychiatrie pour soigner l’esprit et la neurologie pour le cerveau ? Pourquoi pas une seule discipline consacrée au cerveau ? Chaque jour nous apporte des informations nouvelles en provenance des confins de la science du cerveau, de la génétique et de l’intelligence artificielle, et le contenu de ces rapports est déterminé par la façon dont chaque savant comprend le problème corps/esprit.