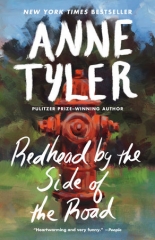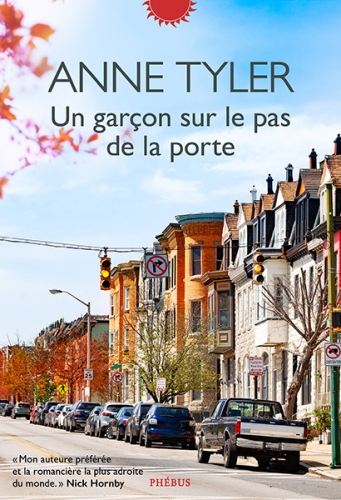Comment décrire mon sentiment à la lecture de La mélancolie de la résistance de László Krasznahorkai (1989, traduit du hongrois par Joëlle Dufeuilly, 2006) ? Dans Arts Libre (11/2), Geneviève Simon cite un extrait du dernier livre de Julian Barnes, qui pourrait convenir : « Si l’humanité ne peut supporter trop de réalité, je soupçonne qu’elle ne peut pas supporter non plus trop de savoir sur elle-même. Nous ne pouvons vivre sans tourment – ou « heureux » –, me semble-t-il, qu’en limitant consciemment ou non notre savoir et notre réalité. Trop de l’un ou de l’autre pourrait nous rendre fous. Nous comprenons cela et, avec une prudente horreur, nous fermons les portes sur nous-mêmes. »

Dès le début du roman, l’écrivain hongrois installe une atmosphère de chaos : un train de voyageurs n’est pas arrivé, « deux simples wagons équipés de banquettes en bois vétustes » sont remis en service pour permettre aux gens d’arriver à destination. Tout est bouleversé dans la région, les habitants s’y sont résignés : « l’avenir était insidieux, le passé révolu, le fonctionnement de la vie courante imprévisible ».
Mme Pflaum a trouvé une place assise près de la fenêtre dans le sens de la marche. Elle aspire à retrouver son appartement, ses meubles, ses plantes, ses bibelots, son refuge. Quand elle découvre le regard lubrique d’un homme mal rasé et puant l’alcool sur sa poitrine, elle ressent effroi et dégoût, finit par quitter sa place pour échapper à la grossièreté – le voyage tourne au cauchemar.
Enfin elle peut descendre à son arrêt, mais l’éclairage de la ville s’éteint. Elle se dépêche dans les rues vides, a peur d’être suivie, découvre un convoi énorme : des forains annoncent une attraction fantastique, ils ont une baleine dans leur remorque. Une fois chez elle, Mme Pflaum, deux fois veuve, est rassurée. Le calme à peine retrouvé, on sonne chez elle. Ce n’est pas son fils Valuska qu’elle a chassé, c’est Mme Eszter, que Mme Pflaum et ses amies évitent et qu’elle compte bien renvoyer. « Les choses se passèrent autrement. »
Krasznahorkai déroule son texte sans alinéas sur plusieurs pages, ce qui entraîne le lecteur dans un continuum envoûtant. Chaque nouvelle séquence reprend les derniers mots de la précédente. Donc ici : « Les choses se passèrent autrement et ne pouvaient se passer autrement, car Mme Eszter savait pertinemment à qui elle avait affaire […]. » On change alors de point de vue.
Mme Eszter parvient à s’imposer chez Mme Pflaum dont elle méprise le bien-être et le confort douillet. Elle veut son appui pour décider Eszter – sans lui, « la ville était imprenable » – à appuyer sa campagne « COUR BALAYEE, MAISON RANGEE ». Ils vivent séparés, son mari ayant besoin de calme et de solitude pour travailler, et elle se sert de Valuska, « le disciple et petit protégé d’Eszter, cet incurable crétin », pour transporter le linge de son mari qu’elle s’est résolue à laver, « au vu et au su de toute la ville ». Mme Pflaum refuse immédiatement.
Le gel précoce, sans neige, et divers incidents étranges inquiètent les habitants de la ville de plus en plus délabrée. Dans la nuit, un peuplier géant tombe contre une façade, nouveau signe de « l’effondrement de l’ancien monde ». En marchant, Mme Eszter « était redevenue elle-même : résolue, invulnérable, équilibrée et pleine d’assurance ». Elle compte bien jouer un rôle décisif dans le « nouvel ordre » qui va succéder à ce monde ancien en faillite et en tirer profit. L’arrivée des forains est une première victoire pour elle, qui a réussi à convaincre le Conseil de la ville de les accueillir.
Valuska et Eszter sont les protagonistes des Harmonies Werckmeister, la partie principale du roman. Valuska, le postier boiteux, le pilier de café, est passionné par le soleil, la terre, la lune. Il regarde tantôt le ciel, avec des yeux « ravis», tantôt le sol. Chez lui, il trouve Mme Eszter et accepte sa mission : apporter une valise de vêtements chez son mari, chez qui elle a l’intention de retourner vivre. Valuska est éperdu d’admiration pour Eszter, « savant exceptionnel, auteur de recherches musicales », qui lui joue du Bach chaque après-midi pendant une demi-heure.
Eszter, « entouré de la plus grande considération générale », est indifférent à tout ce qui se passe en ville. Affaibli par sa vie recluse, il s’habille tout de même avec soin. Chaque jour, il parle et Valuska l’écoute, puis lui raconte « ses visions cosmologiques ». Eszter voit en lui non pas un « simple d’esprit » mais un homme pur et généreux, d’un « angélisme » détonnant dans ce monde. Il a chassé sa femme, bête et assoiffée de pouvoir, pour avoir la paix, « rester au lit » et « du matin au soir, composer des phrases comme autant de variations « sur une même et triste mélodie » ».
Son pessimisme est profond : « Nous avons totalement échoué dans notre façon d’agir, de penser, d’imaginer, et même dans nos piètres efforts pour comprendre les raisons de cet échec. » Ce maître en mélancolie finira tout de même par devoir sortir et découvrira la réalité de sa ville couverte de détritus. Valuska surprend des discussions entre des hommes qui traînent sur la place près des forains, décidés à tout saccager. Au long récit haletant de la nuit épouvantable qui va changer leur vie à tous succédera une dernière partie crépusculaire, pour ne pas dire plus.
La mélancolie de la résistance est un récit sombre et troublant. Impossible d’en indiquer toutes les facettes comme de tout voir de la baleine. Nous suivons l’histoire à travers les yeux de personnages tantôt veules ou avides, tantôt courageux et touchants, sans parler de ceux qui attisent la violence ou se laissent emporter dans son mouvement. Ce qui illumine néanmoins ce tableau terrible d’une ville livrée au chaos et m’a rappelé, d’une certaine façon, le lien entre Raskolnikov et Sonia dans Crime et châtiment, c’est la magnifique relation entre György Eszter et János Valuska, si dissemblables. Krasznahorkai, un « vrai Nobel de littérature ».
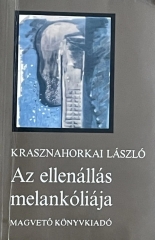 « Il errait insouciant dans ce paysage désolé, entre ces groupes d’hommes, entre ces autobus et ces voitures abandonnés à leur sort, comme il errait insouciant dans sa vie, telle une minuscule planète qui, sans chercher à comprendre la gravitation à laquelle elle est soumise, n’éprouve que du bonheur de pouvoir participer, ne fût-ce que d’un souffle, à un mécanisme si paisible et si bien réglé. »
« Il errait insouciant dans ce paysage désolé, entre ces groupes d’hommes, entre ces autobus et ces voitures abandonnés à leur sort, comme il errait insouciant dans sa vie, telle une minuscule planète qui, sans chercher à comprendre la gravitation à laquelle elle est soumise, n’éprouve que du bonheur de pouvoir participer, ne fût-ce que d’un souffle, à un mécanisme si paisible et si bien réglé. »