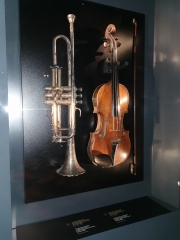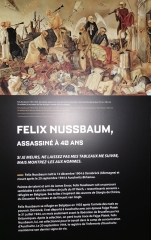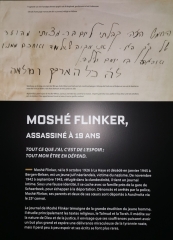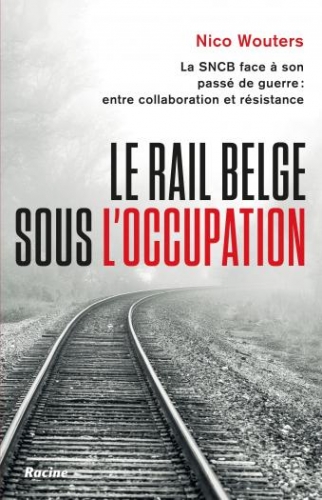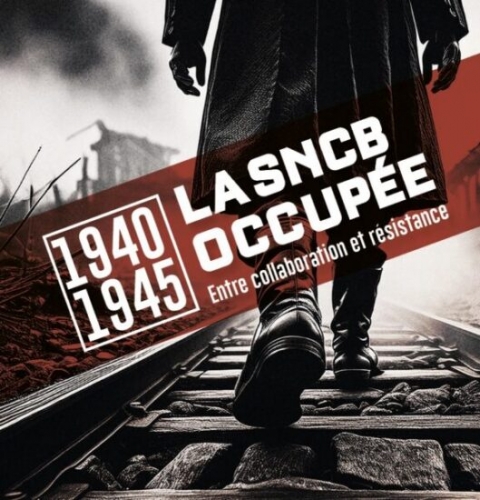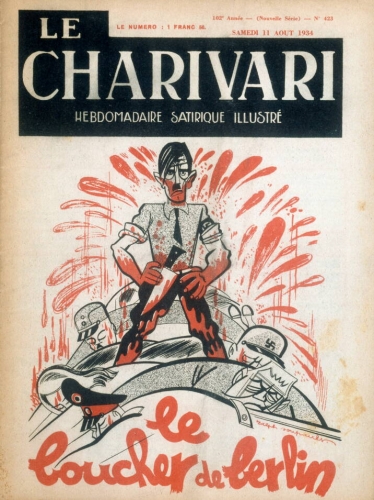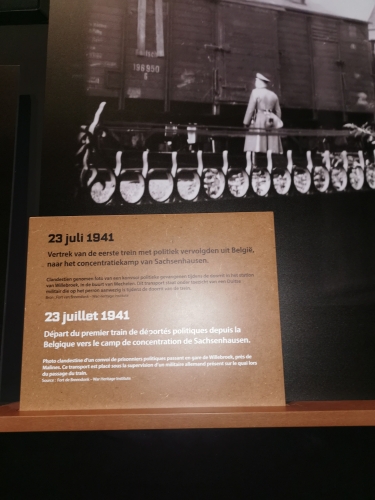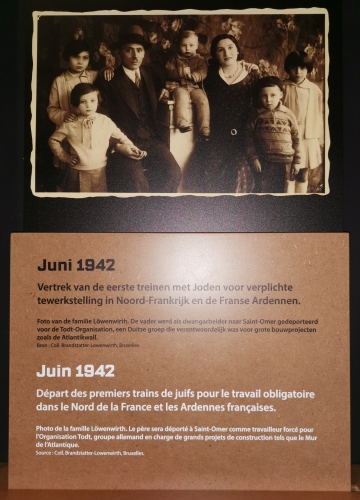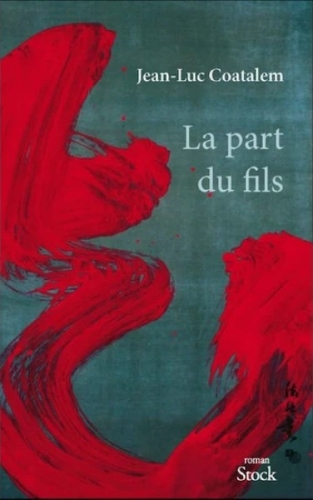La Fondation Roi Baudouin était l’invitée d’honneur de la Brafa 2026, à l’occasion de ses cinquante ans. Parmi ses différents objectifs au service du « vivre-ensemble », la FRB œuvre pour sauvegarder et pérenniser le patrimoine belge. Quelques-unes des pièces exposées sont présentées dans le communiqué de presse de la Brafa.

Cornelis de Vos, Portrait de Jan Vekemans, 1624,
Huile sur panneau, 122 x 79 cm (FRB /
J’en ai choisi trois, ce portrait du XVIIe siècle d’un enfant de cinq ans pour commencer. Acquis en 2006, le Portrait de Jan Vekemans par le célèbre portraitiste Cornelis de Vos a été confié en dépôt au Musée Mayer van den Bergh d’Anvers. Il complète là une importante série de portraits de famille, qui était reconstituée à la Brafa par projection autour de ce tableau des autres portraits. Vous les trouverez sur le site du musée anversois et leur histoire ici.

Elisabeth De Saedeleer, Tapis de style Art Déco, 1924, Laine et cellulose,
104 x 219 cm, FRB / Design Museum Brussels, Bruxelles
(au-dessus du Fauteuil S3 d’Alfred Hendrickx pour la Sabena, 1958)
La collection de la Fondation est riche de chefs-d’œuvre que vous pouvez admirer sur son site. Peinture, sculpture, orfèvrerie, bijoux, vases, objets d’art, mobilier, toutes les catégories de la création artistique y sont présentes, de l’art ancien à l’art moderne. J’ai aimé ce tapis de style Art Déco conçu par Elisabeth De Saedeleer (1902-1972), une artiste et designeuse que je ne connaissais pas.

Maquette du Palais chinois de Laeken, 1903-1904, H. 1,8 m, Chine,
Bois / Filaments à base de bois / Résine synthétique, restaurée en 2024-2025
Enfin, quel plaisir de découvrir la belle maquette du Palais chinois de Laeken restaurée en 2024-2025 à l’initiative de l’ASBL Palais chinois et des Pays des Routes de la Soie, avec le soutien de la FRB. Réalisée par des artisans de Shanghai à l’échelle 1/10, cette maquette en bois fait rêver. On aimerait tant que ce bâtiment jadis appelé le « pavillon chinois » ainsi que la « Tour japonaise » de Laeken retrouvent leur splendeur d’antan après des années d’abandon. Vous trouverez sur le site de la China House son histoire, des photos et la présentation de la restauration prévue de 2026 à 2028.