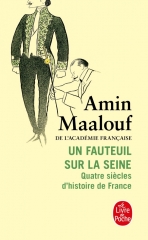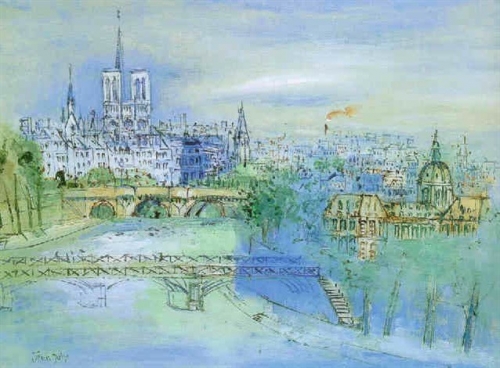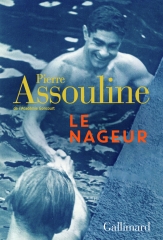C’est le titre donné par Pauline Baer de Perignon au premier chapitre de La collection disparue (2020), un récit qui m’a passionnée tout du long. Arrière-petite-fille de Jules Strauss, un grand collectionneur juif parisien dont elle ne savait pas grand-chose – son père ne lui a pas beaucoup parlé de son propre grand-père –, elle va mener l’enquête à sa manière, désireuse de comprendre ce qu’est devenue sa collection d’art, dont elle sait juste qu’il a vendu une grande partie en 1932.
« Ceux qui pouvaient raconter disparaissent, et les questions que je n’ai pas posées s’évanouissent avec eux. Et puis, sans que je sache vraiment pourquoi, le passé resurgit. » En novembre 2015, un ami antiquaire qui l’a invitée à un concert de musique brésilienne lui présente un homme qu’elle connaît : c’est Andrew, un cousin du côté paternel. Celui-ci prend de ses nouvelles – elle a trois enfants, anime des ateliers d’écriture, écrit – puis lui dit en se penchant vers elle : « Tu sais qu’il y a quelque chose de louche dans la vente Strauss ? »
Pauline Baer savait que la collection de toiles impressionnistes de Jules Strauss avait été vendue, mais n’avait jamais pensé plus loin. Andrew a retrouvé une liste de tableaux déclarés volés pendant la Seconde Guerre mondiale, qui n’auraient pas été vendus en 1932. Dans la famille, on disait souvent qu’une seule de ses toiles impressionnistes aurait suffi aujourd’hui à faire leur fortune. « Chaque famille a son paradis perdu, le mien s’appelle Jules Strauss. »
Henri, son mari, féru de généalogie, l’interroge sur son arrière-grand-père et fait des recherches sur internet : des catalogues de « Ventes Strauss » sont encore en vente, de 1932 et de deux autres en 1949 et en 1961 ! Etonné que Jules Strauss n’ait pas été déporté – il est mort de vieillesse en 1943 –, il encourage sa femme qui veut écrire depuis longtemps : « Tu le tiens peut-être, ton sujet ? »
D’abord, l’autrice interroge sa tante Nadine, la sœur de son père (l’arbre généalogique des personnes citées figure au début du livre). Celle-ci n’avait que sept ans en 1932, mais sait que Jules Strauss a vendu ses toiles parce que ses deux gendres étaient ruinés après le krach boursier de 1929. C’est pourquoi sa famille avait emménagé dans le grand appartement de Marie-Louise et Jules Strauss au 60, avenue Foch. Une photo d’avant la guerre les montre, « lui, grand, mince, élégant, et, à ses côtés, une femme plus petite coiffée d’un joli chapeau. »
Comment Jules Strauss a-t-il échappé à la déportation ? Où sont passés les trois Degas, quatre Renoir, deux Sisley, deux Monet qui figurent sur la liste des tableaux déclarés volés dont lui a parlé Andrew ? Prendre en charge des affaires « qui remontent à deux générations », mêlées à « des secrets de guerre et de spoliations nazies », voilà qui effraie a priori Pauline Baer. « Mais Jules me fait signe, il est sur le pas de la porte, je ne peux pas me détourner. »
Rappelez-vous 21, rue La Boétie (2012), où Anne Sinclair relate ses recherches sur la galerie Paul Rosenberg : son grand-père était un grand marchand d’art et l’arrivée des nazis avait mis fin à ses activités parisiennes. La façon dont Pauline Baer suit la piste de Jules Strauss est tout aussi passionnante. L’histoire familiale et celle des années de guerre s’y mêlent à l’histoire de l’art. Elle, ce qui l’intéresse avant tout, « ce sont les histoires des tableaux ».
On la suit dans les centres de documentation du musée d’Orsay, où elle reçoit l’aide d’une spécialiste des spoliations, la première d’une série de bonnes personnes qui conseillent la « débutante » ; du Louvre où demeure une formidable preuve de la passion de Jules Strauss pour l’art, sur les traces des tableaux de la liste et de leur « provenance ». Elle trouve des appuis dans sa famille. Ses recherches la mèneront aussi à La Courneuve (Archives de la spoliation) et jusqu’en Allemagne.
Pauline Baer raconte très simplement, sans dissimuler son ignorance, ses découragements, son absence de méthode – elle cherche plutôt « dans tous les sens ». C’est pour elle une manière de faire ses preuves dans une famille où les femmes étaient moins reconnues que les hommes. Elle s’y engage complètement, comme l’a fait Anne Berest dans La Carte postale. Pauline Baer apprend à mieux observer les photos, à lire plus attentivement les notices, à communiquer avec des spécialistes comme avec des fonctionnaires. Ses recherches ne seront pas vaines, je ne vous en dis pas plus. Vous aimez l’art ? les musées ? les salles de vente ? l’histoire ? le suspense ? Lisez La collection disparue, c’est captivant.