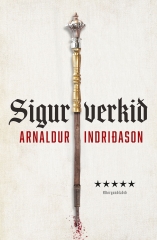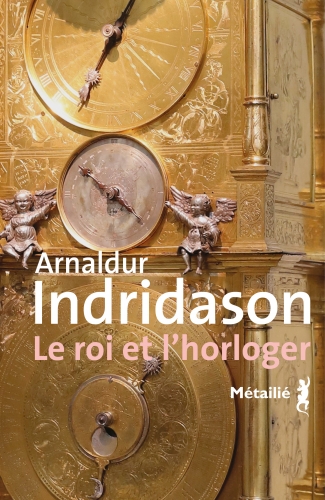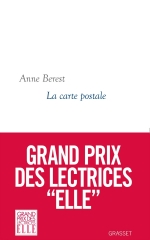« Stehen : tenir, se tenir, résister » (d’après Paul Celan), c’est la première citation sur laquelle s’ouvre Le nageur, un formidable récit de Pierre Assouline consacré à Alfred Nakache (1915-1983). En plus de raconter l’apprentissage et les triomphes de ce nageur français fameux, sa vie quasi détruite par les nazis (contrairement à lui, ni son épouse ni sa fille ne survivront à Auschwitz), Assouline décrit les rivalités de pouvoir et les enjeux politiques dans le sport – une lecture intéressante à moins d’un an des Jeux olympiques de Paris 2024.

En 1938, dans la piscine des Tourelles (Paris 20e), Alfred Nakache remporte le 100 mètres nage libre.
Né à Constantine, il a eu peur de l’eau jusqu’à l’adolescence. Après avoir assisté à un championnat de natation au bassin Aïn Sidi M’Cid, il va s’entraîner à la Jeunesse nautique constantinoise – « Dès lors, nager, ce n’est plus seulement se baigner. » Son style n’est pas conventionnel, mais on remarque sa puissance, on le fait concourir. Le voilà « espoir ». S’il veut progresser, il faut qu’Alfred Nakache aille à Paris.
Depuis le décret Crémieux en 1870, les « israélites d’Algérie » sont tous devenus citoyens français. Boursier comme interne en terminale, le garçon « poisson » intègre en 1933 le lycée Janson-de-Sailly et le Racing Club de France. Il nage avec plaisir à la piscine des Tourelles, l’eau est son élément. On le surnomme « Artem » (prénom slave, l’« énergique »). Nakache rencontre Cartonnet, de quatre ans son aîné, « long, haut, blond, blanc, fin, les traits réguliers, élégant, hautain » alors que lui est « mat, ramassé, râblé, musculeux, familier […], un éternel sourire accroché au visage ». Nakache sera plusieurs fois champion de France du 100 mètres nage libre.
Son modèle, c’est Jean Taris, qui lui apprend beaucoup. Repéré par la Fédération, par les journalistes sportifs qui voient dans le jeune nageur son successeur, Nakache n’est pourtant pas envoyé aux championnats d’Europe de 1934 en Allemagne – le règlement implique qu’il faut être né sur le sol français. En Algérie, le climat politique est tendu : les colons européens de Constantine veulent la mairie, mais sans les juifs. Un pogrom y éclate en août 1934. En 1936, lassé des remarques antisémites au Racing, Nakache intègre le Club des nageurs de Paris.
Avant même les Jeux olympiques de Berlin, les deux sphères de combat du nageur sont dessinées : les rivalités sportives, l’antisémitisme nazi. Alors que de nombreuses délégations ont exclu des juifs, la Fédération française envoie Nakache aux Jeux. Avec Le nageur, Pierre Assouline réussit à nous captiver, non seulement par le parcours personnel et sportif de Nakache, mais par toutes les composantes de sa vie : l’entraînement, la natation, l’art de concourir, les rapports avec les autres, sa relation au judaïsme, son sens de l’amitié, de l’engagement, sa solidarité…
« Tenir, se tenir, résister » : cela vaut pour le sport, cela vaudra pour la guerre. « Si je le revois je le tue. » Ce leitmotiv du récit – Nakache est pourtant « un doux dans son genre, bienveillant, maître de ses nerfs » – renvoie à Jacques Cartonnet (1911-1967), son coéquipier devenu son adversaire et pire, son ennemi. Condamné par contumace pour collaboration, celui-ci réussira à effacer sa trace.
En décembre 1943, accusé de « propagande antiallemande », Nakache a été arrêté à Toulouse où il s’était installé, on a cherché aussi sa femme et sa fille. On le suit à Auschwitz puis à Buchenwald. Lui seul en reviendra. Certains avaient annoncé sa mort. Alfred Nakache est devenu un autre homme, Pierre Assouline le suit jusqu’au bout, jusqu’à Cerbère où il va vivre après sa retraite. « Le récit de son existence pourrait tenir en une phrase : il est né, il a nagé, il est mort. » Comme les précédentes, si pas plus encore, cette nouvelle biographie, l’histoire d’un homme et de son époque, est solidement documentée (la liste des sources prend huit pages). C’est passionnant.