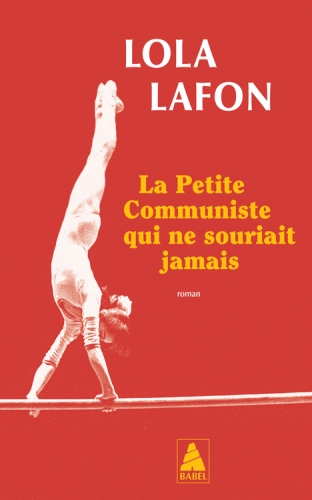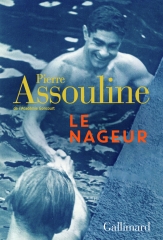Après une belle série de lectures voyageuses, voici un petit essai, philosophique sans trop en avoir l’air, une spécialité de Michel Serres (1930-2019). Mes profs de gym m’ont appris à penser est publié dans la collection « Homo ludens », des entretiens qui invitent à réfléchir sur la pratique sportive.

Passe pour un rugbyman (source)
« Pouls, souffle, sommeil, menstruation… le corps vit de rythmes. » C’est la première phrase. Des tempos sont à l’œuvre au cœur de « cette harmonie sublime que nous appelons la santé, mieux encore la forme, mieux encore la personne. » Le titre est repris à la dédicace de ses Variations sur le corps : « A mes professeurs de gymnastique, à mes entraîneurs, à mes guides de haute montagne, qui m’ont appris à penser. »
Pourquoi lier l’éducation physique à la pensée ? « Dans toutes les activités qui concernent la réflexion, c’est-à-dire l’adaptation, la sensation du nouveau, la perception ou la finesse, le corps, d’une certaine manière, anticipe. On ne sait que ce que le corps apprend, que ce qu’il retient, que ses souplesses ou ses plis… » Et Serres d’en donner des exemples, comme ce conseil d’un entraîneur : quand on apprend à plonger, il faut plonger tous les soirs en s’endormant, virtuellement.
Il y a donc « une intelligence du corps » : qui pratique une activité physique ou un métier manuel constate que les gestes sont « extrêmement différenciés et adaptatifs » et qu’« on peut toujours en inventer de nouveaux ». Si l’on réfléchit au geste à faire, on risque de le rater ; laissé à lui-même, le corps « est plus fluide, plus rond, il sait s’adapter plus rapidement. » D’où le titre choisi pour ce billet : « Savoir quelque chose par corps, comme le savoir par cœur, c’est quand le corps exécute un geste sans y penser, sans qu’intervienne la conscience. »
Michel Serres aime choisir un mot, une formule, une figure de style qui fasse mouche, quitte à nous dérouter. « La main, qui n’est propre à rien, est bonne à tout, bonne à tout et presque propre à rien ». On s’arrête, on relit, on réfléchit. Pour lui, « la main est intelligente, tout simplement », et voilà pour conclure une métaphore : « La main est un puits infini. » Donc « apprendre par corps » et « retrouver les vertus de l’apprentissage « par cœur » ».
Revenant sur la définition de la santé par René Leriche – « le silence des organes » –, le philosophe distingue « l’état de forme » et « l’état de grâce » des sportifs qui réussissent leur geste « sans effort apparent ». Dans l’aventure humaine, l’évolution de la technique ne lui fait pas peur, il est confiant dans le « rééquilibrage », dans « l’élan vital du corps » : « il y a un plaisir de sauter, de courir, d’être souple, d’être adapté ».
Son chapitre sur les sports de ballon s’intitule « Passes ». Il y décrit avec enthousiasme le rôle du ballon ou de la balle et l’adresse du corps qui s’y adapte. Il compare le football et le rugby, tant du point de vue des joueurs que des spectateurs, et dit l’importance du lien social dans le sport collectif. Bien sûr, il distingue le sport spectacle gangrené par l’argent et la drogue de la pratique sportive individuelle, en amateur (mot qu’il n’emploie pas, cela m’a surprise). Son optimisme réjouit.
Je me suis souvent arrêtée en lisant Mes profs de gym m’ont appris à penser – pour Yeux, il en avait été de même –, et à la fin, j’ai tout repris et mieux saisi la cohérence des propos de Michel Serres (tout en mettant quelques points d’interrogation dans la marge). Parfois j’ai l’impression qu’il s’emballe ou cherche le bon mot, la belle image, avec un certain goût pour la provocation. Objection, votre honneur ! est-on tenté de dire.
Mes profs de gym m’ont appris à penser est un bel hommage à l’éducation physique dont il rappelle l’objectif premier : « le soin de soi », à l’opposé des « grands dinosaures spectaculaires » auxquels il préfère le « petit », le « local », la pratique individuelle « en compagnie de ceux que l’on a choisis ». Michel Serres, comme un entraîneur, nous fait penser « par corps ».