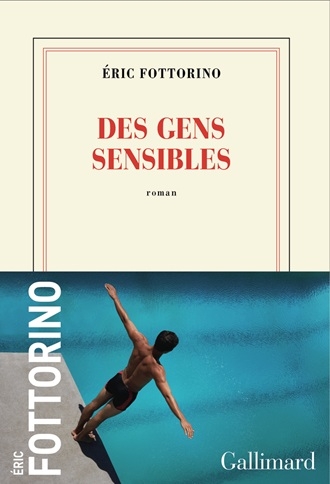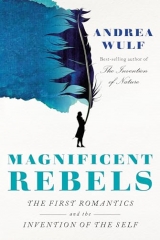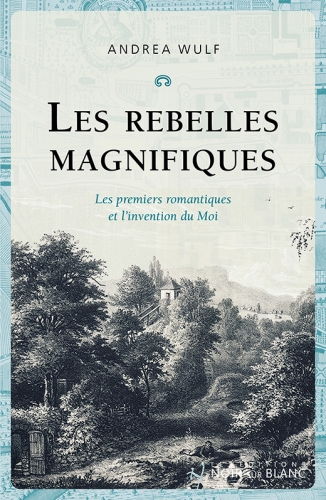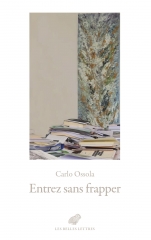Dans L’invention de la nature, Andrea Wulf a raconté les aventures d’Alexandre von Humboldt et sa vision du monde nourrie de sa curiosité et de ses voyages. Dans Les rebelles magnifiques (traduit de l’anglais par Marie-Odile Probst, 2024), elle nous emmène à Iéna, à la rencontre des « premiers romantiques » et de « l’invention du Moi », dans la dernière décennie du XVIIIe siècle.
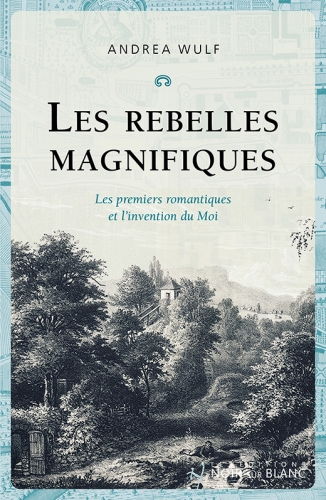
L’autrice elle-même s’est inventée, en quelque sorte (Prologue). En révolte contre ses parents, elle a d’abord refusé d’étudier à l’université, lu beaucoup, travaillé, aimé, eu une fille à vingt-deux ans, puis s’est tournée vers une université allemande, attirée par les séminaires de philosophie. Ensuite elle a quitté l’Allemagne pour l’Angleterre et a trouvé sa voie – « ma voix. Littéralement. Je l’ai trouvée dans une langue qui n’était pas la mienne par la naissance. Et je suis devenue écrivaine. »
Pour elle, nous sommes les héritiers de la façon d’appréhender le monde de ces « penseurs révolutionnaires » du cercle d’Iéna. Le goût profond de la liberté était leur quête obsessionnelle, à une époque où presque partout, des souverains décidaient de « maints aspects de la vie de leurs sujets ». Caroline Michaelis-Böhmer-Schlegel-Schelling, « une femme qui porta les noms de son père et de ses trois maris, mais qui refusa d’être cantonnée dans le rôle que la société réservait aux femmes » est au centre de leur histoire, où l’on rencontre Goethe, Schiller, Fichte, Hegel, les frères von Humboldt, Novalis, Schelling, les frères Schlegel, entre autres.
Goethe, « le Zeus des cercles littéraires allemands », habitait Weimar mais aimait chevaucher jusqu’à Iéna, « nichée au creux d’une large vallée, dans le coude de la rivière Saale », pour y superviser l’aménagement d’un jardin et d’un institut botaniques. Il y logeait au vieux château. En 1794, on y parle beaucoup du jeune philosophe Fichte qui a proclamé le Moi « maître suprême du monde ». Goethe suit une conférence de Schiller à Iéna et les premiers échanges entre ce « réaliste têtu » et l’idéaliste qui le contredit sont « le début de l’amitié littéraire la plus féconde du siècle » entre ces deux hommes très différents.
L’essai d’Andrea Wulf commence avec l’arrivée des principaux protagonistes dans les années 1794-1796. Caroline Böhmer, veuve à 24 ans, et le critique August Wilhem Schlegel qui l’a épousée en 1796 s’installent à Iéna. Elle l’assiste dans la rédaction d’articles bien rémunérés pour la revue Les Heures de Schiller, corrige son travail, publie des comptes rendus sous son nom à lui, comme cela se faisait le plus souvent à l’époque.
La présence d’Alexander von Humboldt stimule Goethe, qui s’intéresse aux sciences autant qu’aux lettres, et apporte encore plus d’énergie au Cercle d’Iéna. Ils se fréquentent tous les jours, passent des soirées en lectures et discussions, rivalisent dans leurs écrits. Ensemble, Caroline et August Schlegel traduisent Shakespeare, avec un immense succès qui fait redécouvrir le dramaturge anglais comme « l’esprit de la poésie romantique formulée de façon dramatique ».
Leur mariage est basé sur le respect mutuel, leur intérêt commun pour la littérature, l’amitié – et la liberté amoureuse qu’ils s’accordent l’un à l’autre. Pour le groupe d’Iéna, la poésie romantique se doit d’être « indocile, vivante et en perpétuelle évolution ». En juillet 1798, tous se rendent en vacances à Dresde, y admirent la Madone Sixtine de Raphaël, discutent sur l’importance et la compréhension de l’art. Un nouveau venu, Schelling, séduit tout le monde.
Ses idées renouvellent l’enseignement à Iéna, ses cours deviennent très populaires. Mais sa présence assidue auprès de Caroline dont il est amoureux fait jaser (il a douze ans de moins qu’elle). Le frère d’August, Friedrich Schlegel, fait scandale en s’affichant avec Dorothea Veit, au divorce prononcé par un tribunal juif de Berlin. Son mari y a consenti et lui a laissé la garde de leur plus jeune fils. Malgré sa disgrâce, Dorothea est heureuse de vivre librement en « amante, mère, muse, collaboratrice et amie » de Friedrich, comme Caroline auprès d’August.
Couples libres et scandaleux, accusations d’athéisme ou de mensonge, rivalités, disputes, maladies, drames : Andrea Wulf mêle habilement à l’histoire des idées le récit du contexte historique et la description des modes de vie ; c’est très vivant. J’ai aimé sa façon assez romanesque de présenter les personnalités du cercle d’Iéna, depuis leurs premières rencontres jusqu’à son déclin.
Au début du XIXe de Lagarde & Michard, on aborde le romantisme à travers des extraits du fameux essai de Mme de Staël, De l’Allemagne (1813). Elle apparaît dans Les Rebelles magnifiques quand, bannie par Napoléon, elle part à la rencontre des penseurs et écrivains allemands. August Willem Schlegel sera son guide. Ces « premiers romantiques » vont influencer toute l’Europe, en France, en Angleterre, puis aux Etats-Unis. « Le Cercle d’Iéna a transformé notre monde » en osant « mettre le Moi et le libre arbitre au centre de la scène. »
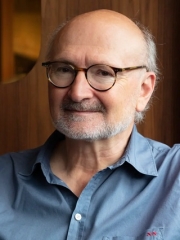 « Avec Clara, on s’était connus à peine une année, et pourtant j’avais sans cesse éprouvé cette exigence contenue dans son regard intense, qui me criait « ne me déçois pas », et surtout « ne te déçois pas ». A une expression infime de son visage, je devinais ce qui lui déplaisait, une facilité, une rapidité qui réclamait la lenteur, des mots inutiles. Je me souviens de sa question quand j’osai lui montrer les bribes d’un nouveau roman : « Et toi, Fosco, où es-tu, dans ces pages ? » Clara traquait la jolie écriture qui n’avait rien à dire, les postures ennemies, le paraître, l’esbroufe, la comédie. « Je ne sais pas si j’ai du goût, mais j’ai le dégoût très sûr » (c’était du Jules Renard), provoquait-elle, fustigeant ces écrivains qui ont écrit des livres mais n’ont pas écrit le livre. »
« Avec Clara, on s’était connus à peine une année, et pourtant j’avais sans cesse éprouvé cette exigence contenue dans son regard intense, qui me criait « ne me déçois pas », et surtout « ne te déçois pas ». A une expression infime de son visage, je devinais ce qui lui déplaisait, une facilité, une rapidité qui réclamait la lenteur, des mots inutiles. Je me souviens de sa question quand j’osai lui montrer les bribes d’un nouveau roman : « Et toi, Fosco, où es-tu, dans ces pages ? » Clara traquait la jolie écriture qui n’avait rien à dire, les postures ennemies, le paraître, l’esbroufe, la comédie. « Je ne sais pas si j’ai du goût, mais j’ai le dégoût très sûr » (c’était du Jules Renard), provoquait-elle, fustigeant ces écrivains qui ont écrit des livres mais n’ont pas écrit le livre. »