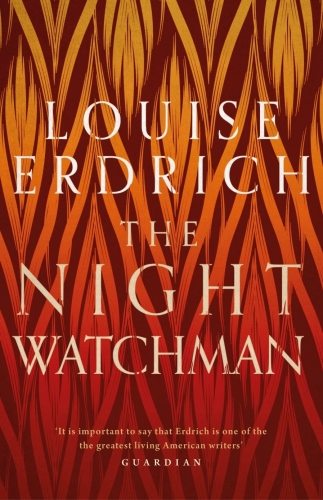Enchantée par Celui qui veille, le roman précédent de Louise Erdrich, je me suis laissé tenter par son dernier roman, La Sentence (traduit de l’américain par Sarah Gurcel), à la Librairie de l’Olivier (Nyons). J’en avais lu de bonnes critiques et caressé la belle couverture. La romancière l’a dédiée « à toutes celles et tous ceux qui ont travaillé à Birchbark Books, à nos clients, à nos fantômes » – c’est le nom de sa librairie à Minneapolis.

Birchbark Books & Native Arts / Minneapolis, Minnesota
« Quand j’étais en prison, j’ai reçu un dictionnaire. » Condamnée en 2005 à soixante ans de prison, Tookie, la narratrice, a cherché en premier dans le livre offert par Jackie, son ancienne professeure, le mot « sentence ». Alors dans la trentaine, elle buvait et se droguait comme à dix-sept ans. Amoureuse de Danae, son « crush » (son béguin, selon Reverso consulté plus d’une fois pour ces termes non traduits qui émaillent le roman), elle se laisse entraîner par sa « chère chavirée » dans un invraisemblable transport de cadavre qui tourne mal.
Tookie a fini par se faire arrêter par Pollux, de la police tribale, un « ancien boxeur au regard perçant », son « autre crush ». Dix ans plus tard, son avocat a pu prouver qu’on lui avait tendu un piège et la voilà « dehors ». Entretemps, Tookie a beaucoup lu et suivi un cursus universitaire. En 2015, elle tente sa chance et se présente dans la librairie où Jackie travaille.
« La porte bleue protégée par un store ouvrait sur un parfum de sweet grass, l’avoine odorante qui sert d’encens pendant les cérémonies, et sur soixante-quinze mètres carrés remplis de livres » consacrés à la culture « autochtone ». « J’ai réalisé que nous, Indiens d’Amérique, sommes plus brillants que je ne le pensais. » Tookie se montre pleine d’aplomb commercial et Louise (l’autrice) l’engage, même si sa librairie n’est pas au mieux financièrement.
En vivant chichement, en résistant aux tentations d’autrefois, en travaillant beaucoup, Tookie revit et savoure sa liberté. Quand Pollux la retrouve et lui demande de l’épouser, elle « fonce » vers une nouvelle vie – une petite maison, un jardin mal entretenu, du travail, de l’amour, le ventre plein – une vie ordinaire qu’elle juge « paradisiaque ».
En novembre 2019, « cinq jours après sa mort, Flora venait encore à la librairie. » Quand la boutique est vide et Tookie seule, celle-ci l’entend murmurer, remuer près du rayon Littérature, elle entend le léger bruit de ses boucles d’oreilles ou de ses bracelets. C’était une cliente assidue et agaçante. Persuadée d’avoir été « indienne dans une vie antérieure », Flora montrait à tout le monde la photo d’une « femme austère enveloppée dans un châle », sa prétendue arrière-grand-mère qui avait honte d’être indienne.
La fille adoptive de Flora apporte à Tookie le livre qui était ouvert à côté de sa mère quand elle est morte. Elle l’emporte chez elle, sans en parler aux autres vendeuses : Penstemon, passionnée par les écrivains et troublée d’être tombée amoureuse d’un blanc, et Asema, étudiante à l’université. Tookie (Ojibwé) n’en dit rien à Pollux (Potawatomi) qui, en plus de ses fonctions dans la police, est maître du feu dans les cérémonies traditionnelles, bricole, pêche, cuisine (il prépare la viande, elle le poisson), prend soin de sa nièce Hetta comme un père.
Peu avant Noël, Tookie finit par évoquer la présence de Flora tous les jours dans la librairie et apprend que « Louise a un fantôme chez elle depuis des années, mais c’est une présence propice. Personne qu’elle ait connu », quelqu’un qui « l’aide peut-être à écrire ». Tookie se sent harcelée, menacée même. Afin d’y voir plus clair, elle finit par ouvrir le « très vieux journal intime » que lisait Flora – « La Sentence. Une captivité indienne 1862-1883 » – puis le pose sur une des deux piles de livres près de son lit : la « laborieuse » (en attente d’énergie mentale) et non la « paresseuse » (lecture facile).
Voilà le cadre de La sentence de Louise Erdrich : une librairie hantée et ses employées, la vie privée et les tumultes intérieurs de Tookie, toute à ses émotions et à ses croyances, le mode de vie d’Amérindiens mêlant traditions et modernité. Bientôt les personnages seront confrontés à deux événements contemporains majeurs : la pandémie (qui transforme la boutique en stock de livraison) et la mort de George Floyd (qui bouleverse la ville de Minneapolis, ses communautés, le monde entier).

Le Monde des Livres traduit « birchbark » : « écorce de bouleau » (jadis en rouleaux comme support d’écriture, ou pour fabriquer les canoës, comme celui suspendu dans la librairie). Le Figaro littéraire loue la grâce, la tendresse et la lucidité de Louise Erdrich. Pour ma part, j’ai préféré Celui qui veille, un roman plus structuré que La Sentence. Ici, l’impulsive Tookie est plutôt foutraque, mais son amour des livres est fabuleux. Cadeau final : Louise Erdrich donne une « Liste totalement partiale des livres préférés de Tookie », et invite à fréquenter et à soutenir les librairies indépendantes comme la sienne.
 « Gil nourrissait pour sa famille une sorte d’attachement désespéré, car il savait que sur un plan fondamental tous se dérobaient à lui. Leurs sourires câlins, leurs compliments, leur rire forcé. Parfois il les croyait sincères. Parfois il savait qu’ils avaient peur de lui. Il leur avait à tous fait du mal, mais pas vraiment de façon durable. Il avait porté la main sur chacun d’eux, sans pourtant jamais laisser de marque physique. Ce n’était pas rien. Il était taciturne, déprimé, sarcastique, charmant. Il souriait quand Irène s’attendait à ce qu’il hurle, devenait affectueux en un éclair. Et il n’avait pas toujours été tellement en colère. En vérité, il avait besoin de toute l’attention d’Irène. Il l’avait eue, avant l’arrivée des enfants. Ceux-ci la lui avaient prise, et il avait été jaloux dès le début. »
« Gil nourrissait pour sa famille une sorte d’attachement désespéré, car il savait que sur un plan fondamental tous se dérobaient à lui. Leurs sourires câlins, leurs compliments, leur rire forcé. Parfois il les croyait sincères. Parfois il savait qu’ils avaient peur de lui. Il leur avait à tous fait du mal, mais pas vraiment de façon durable. Il avait porté la main sur chacun d’eux, sans pourtant jamais laisser de marque physique. Ce n’était pas rien. Il était taciturne, déprimé, sarcastique, charmant. Il souriait quand Irène s’attendait à ce qu’il hurle, devenait affectueux en un éclair. Et il n’avait pas toujours été tellement en colère. En vérité, il avait besoin de toute l’attention d’Irène. Il l’avait eue, avant l’arrivée des enfants. Ceux-ci la lui avaient prise, et il avait été jaloux dès le début. »