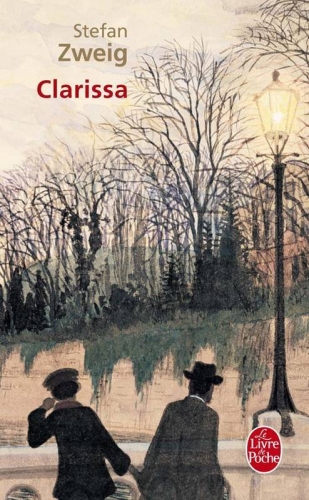De Stefan Zweig (1881-1942), j’ai retrouvé dans ma bibliothèque Clarissa (traduit de l’allemand par Jean-Claude Capèle), dont j’avais tout oublié. Posthume, ce récit inachevé porte dans les archives de l’écrivain autrichien cette mention : « Entrepris la première version d’un roman, le monde entre 1902 et le début de la [Seconde] Guerre [mondiale], vu à travers l’expérience d’une femme. »
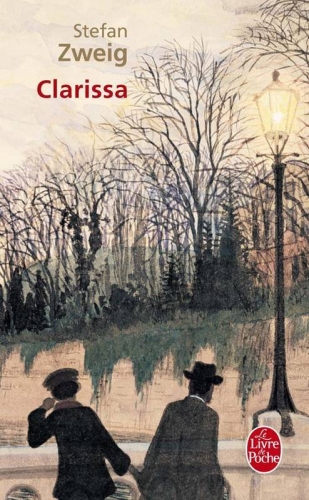
Sa mère étant morte à sa naissance, Clarissa a peu de souvenirs d’enfance. Son frère et elle ont été placés ensemble puis séparément dans la famille de leur père, attaché militaire à Pétersbourg. En 1902, elle a huit ans quand il l’inscrit dans une pension religieuse près de Vienne, et son frère chez les Cadets. Léopold F. X. Schuhmeister, lieutenant-colonel, travaille au service de renseignements, il a la manie des fiches et oblige sa fille à faire de même en tenant un rapport de ses études.
Clarissa se sent seule, surtout le dimanche. Son père ne vient la voir que le quatrième dimanche du mois, il a belle allure dans son uniforme. Il ne lui pose que des questions pratiques, sans exprimer d’affection. Parfois elle reçoit une visite rapide de son frère. Aussi elle apprécie l’arrivée de Marion, une nouvelle, très enjouée, qui a beaucoup voyagé. Comme elle aussi passe l’été à la pension, elles se rapprochent et Marion se confie à Clarissa. Mais en classe, on tend un méchant piège à Marion. Furieuse, elle s’en va. Clarissa aussi, rappelée à Vienne par son père en 1912.
Coup de théâtre : Schuhmeister a dû présenter sa démission, après que son rapport confidentiel à l’Empereur sur la faiblesse de leur artillerie et le danger de guerre s’est ébruité. A cinquante-huit ans, il décide de quitter Vienne et communique ses dispositions à ses enfants : ils jouiront du patrimoine de leur mère à leur majorité. A présent, il les pousse à s’engager dans une activité utile. Clarissa suit différents cours de psychologie avant de devenir l’assistante du professeur Silberstein, un neurologue. Il apprécie sa manière de prendre des notes, de rédiger des synthèses, et son style calme et réservé aux antipodes de sa propre nervosité. Bien qu’elle ait du mal à nouer des relations, il l’envoie à sa place au Congrès de Lucerne en juin 1914, à ses frais, l’occasion pour elle de voyager.
Dès l’accueil qu’elle y reçoit à son arrivée, Clarissa est sensible à la gentillesse de Léonard, un professeur français qui s’occupe de l’organisation des logements, des conférences, des soirées. Lorsque survient l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand à Sarajevo, des tensions divisent les participants et l’Autrichienne chargée de la communication de clôture rentre chez elle. Léonard est ravi lorsque Clarissa lui propose de s’en charger. L’excursion finale sur le lac Léman les rapproche encore davantage. Elle accepte de le revoir et de voyager un peu avec lui.
Léonard lui parle de ses convictions, c’est un « socialiste radical » qui vit séparé de sa femme, partie six ans plus tôt. Aux endroits touristiques, il préfère les petites villes et les « petites gens ». Ils sont heureux ensemble. Une lettre du père de Clarissa va les séparer : il est rappelé au service et lui demande de rentrer. Les journaux sont de plus en plus alarmants, l’Autriche déclare la guerre à la Serbie. Chacun doit rentrer dans son pays.
A Vienne, le père demande à ses enfants de servir leur patrie : le fils, dans l’armée, la fille auprès des blessés, près du front. Clarissa passe l’automne 1914 à se dévouer dans les hôpitaux, consciente du réconfort qu’elle apporte aux soldats, pensant à Léonard qu’elle imagine lui-même engagé dans la guerre de son côté. Un jour, surmenée, elle s’évanouit en apprenant la mort de son frère. Mais bientôt la jeune femme modèle découvre qu’elle est enceinte de Léonard et n’a plus qu’une obsession : trouver un médecin qui veuille bien interrompre sa grossesse avant que les autres la découvrent et que son honneur soit entaché. Cette fois, Clarissa est seule à prendre ses décisions, elle doit se débrouiller.
Le personnage de Léonard serait inspiré de Romain Rolland et de son humanisme, voire de Zweig lui-même, qui s’exprime aussi à travers le professeur Silberstein. La personnalité de Clarissa, d’abord limitée par son éducation, évolue au contact du Français, puis face à sa situation imprévue. Elle veut rester maîtresse de son destin, sans trahir ses valeurs. Mais le pourra-t-elle ? Sans nouvelles de Léonard, la guerre, qui fragilise toutes les existences, l’oblige à faire ses propres choix. On regrette, bien sûr, que le roman soit inachevé, et ne laisse que quelques pages pour résumer l’après-guerre.
 « A mi-chemin entre la grande falaise et la prairie de la Cloche, se trouvait une large pierre plate sur laquelle Tiburius aimait à se reposer. Là, le sol était sec et sur les grands troncs élancés, le soleil faisait de magnifiques jeux d’ombre et de lumière.
« A mi-chemin entre la grande falaise et la prairie de la Cloche, se trouvait une large pierre plate sur laquelle Tiburius aimait à se reposer. Là, le sol était sec et sur les grands troncs élancés, le soleil faisait de magnifiques jeux d’ombre et de lumière.