Le nom d’Hildegard von Bingen (1098-1179) m’a attirée la semaine dernière à la cathédrale des Saints Michel & Gudule (elle porte les deux noms des saints patrons de Bruxelles). Je m’attendais à une exposition sur la célèbre « sainte du XIIe siècle, à la fois bénédictine, poétesse, musicienne, compositrice, botaniste, linguiste, tacticienne, herboriste », « figure marquante de la médecine monastique (à qui l’on doit même d’avoir inventé la bière !) », selon le feuillet de présentation.

En réalité, les deux expositions de mai annoncées par Ars in Cathedrali sont reliées aux seules études botaniques d’Hildegard, qui a observé et dessiné les plantes, étudié leur qualités nutritionnelles et médicinales. Ce sont des installations de Françoise Lesage sur « Hildegard et le règne végétal » et d’Anne Mortiaux, « Flore, terre et eau du marais Wiels ». L’hommage à Hildegard von Bingen comprendra aussi trois concerts et deux conférences (du 24 au 26 mai).

Bannières : plantes d'Hildegard von Bingen par Françoise Lesage
En entrant dans la cathédrale, le regard est attiré par les bannières suspendues entre les colonnes : des dessins de plantes avec leurs racines (pastel gras sur toile de lin). Mis à l’échelle de l’espace d’exposition par Françoise Lesage, ces dessins de plantes d’Hildegard sont présentés dans un style majestueux.

Anne Mortiaux, installation dans le baptistère d'eaux puisées et mélangées.
L’allée latérale de gauche (côté nord) mène au baptistère, où l’on découvre une installation très particulière près des fonts baptismaux (ci-dessus) : Anne Mortiaux y a mis dans des jarres et clepsydres de l’eau puisée au marais Wiels (une zone humide près d’une ancienne brasserie bruxelloise), à la roselière de La Louvière (friche des faïenceries Boch) et à l’étang de Ladrée à Ohey (ancienne fosse d’extraction d’argile). Ce rapprochement entre l’eau du baptême et la défense de ces zones de biodiversité à protéger est pour le moins inattendu.

Le marais Wiels, de formation récente, est apparu au début du siècle en région bruxelloise dans la commune de Forest, quand un chantier préparatoire à la construction de bureaux (obsession immobilière) a percé la nappe phréatique, engendrant un étang de près de neuf mille mètres carrés, où la vie a peu à peu repris : son histoire et son importance sont parfaitement présentées sur le site de Natagora Bruxelles.

Herbier du marais Wiels (Anne Mortiaux)
En continuant, on découvre sur le sol, dans le déambulatoire qui longe le Trésor de la cathédrale, les herbiers d’Anne Mortiaux : ce sont ses cueillettes entamées au marais Wiels en octobre, identifiées sur une liste. Disposées en accordéon, elles illustrent le passage des saisons : automne, hiver et printemps. Ces herbiers font écho à ceux d’Hildegard von Bingen, qui avait inventé une langue, « la lingua ignota », pour renommer les plantes (elle compte mille dix mots). A la fin de l’article en lien, vous trouverez quelques-uns des noms qu’elle leur a donnés.

Françoise Lesage, 182 plantes (n° 752 à 935 de la "lingua ignota"), 2024 (détail ci-dessous)

Françoise Lesage s’en est inspirée. Une longue bande de soie et chanvre présentée sur la dernière colonne de la nef, du même côté, un travail d’aquarelle et broderie, reprend « 182 plantes » inventoriées par Hildegard. L’artiste a brodé ton sur ton sur le bord inférieur l’alphabet qu’elle avait conçu. L’autre tissu suspendu sur la colonne de l’autre côté de la nef a été tissé à partir de laine teinte avec ces plantes. Les bandes colorées suivent l’ordre des plantes indiqué dans l’herbier d’Hildegard, chacune étiquetée avec son nom et son numéro.

Françoise Lesage, 182 plantes (n° 752 à 935 de la "lingua ignota"), 2024 - teintures (détail)
Sur la bannière du chœur, d’après le feuillet explicatif de Françoise Lesage, la grande ortie symbolise la célèbre bénédictine. Cette femme puissante « piquait » les puissants de son époque en s’exprimant en public, ce qui était interdit aux femmes, comme cette plante qui repousse après avoir été coupée.

Bannière du choeur : la grande ortie pour symboliser Hildegard von Bingen
D’abord déconcertée par l’absence d’un panneau explicatif ou d’un petit guide pour les visiteurs, j’étais tout de même heureuse de revisiter la belle cathédrale des Saints Michel & Gudule. Une rencontre providentielle nous a permis d’en apprendre un peu plus sur place et de mieux comprendre le sens de ces expositions. Merci à notre guide, grâce à qui mon compagnon de visite et moi avons fait une autre découverte. Je vous en parlerai la prochaine fois.
P.-S. Ces deux expositions restent visibles à la cathédrale jusqu'au 27.06.2024 (entrée libre).
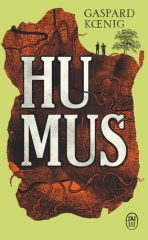 « En achetant Libé au kiosque le jour de sa parution, une première pour lui qui lisait rarement la presse et jamais en format papier, Kevin ressentit une gêne étrange. Le personnage qui y était décrit en dernière page lui ressemblait incontestablement. A s’y méprendre. Mais il dégageait une cohérence qui n’était jamais venue à l’esprit de Kevin, lui qui s’était toujours laissé happer par les événements. C’était comme si on l’avait soudain mis dans la prison de papier d’un destin. Et puis, quelle inconvenance de s’étaler ainsi dans les foyers partout en France ! Il imaginait sa tronche sous les pelures de patate ou consumée par les flammes dans une cheminée. Il aurait voulu mettre une bulle sur sa photo, comme dans les BD : « Désolé, je ne fais que passer, demain je m’en vais. »
« En achetant Libé au kiosque le jour de sa parution, une première pour lui qui lisait rarement la presse et jamais en format papier, Kevin ressentit une gêne étrange. Le personnage qui y était décrit en dernière page lui ressemblait incontestablement. A s’y méprendre. Mais il dégageait une cohérence qui n’était jamais venue à l’esprit de Kevin, lui qui s’était toujours laissé happer par les événements. C’était comme si on l’avait soudain mis dans la prison de papier d’un destin. Et puis, quelle inconvenance de s’étaler ainsi dans les foyers partout en France ! Il imaginait sa tronche sous les pelures de patate ou consumée par les flammes dans une cheminée. Il aurait voulu mettre une bulle sur sa photo, comme dans les BD : « Désolé, je ne fais que passer, demain je m’en vais. »













