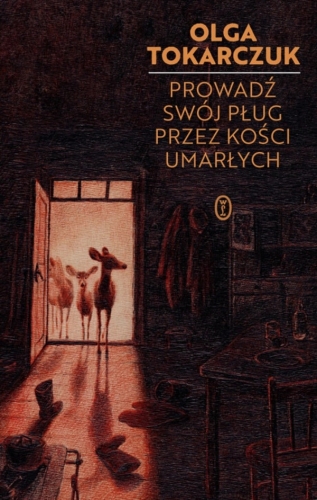« D’une certaine façon, les gens comme elle [l’Ecrivaine], ceux qui manient la plume, j’entends, peuvent être dangereux. On les suspecte tout de suite de mentir, de ne pas être eux-mêmes, de n’être qu’un œil qui ne cesse d’observer, transformant en phrases tout ce qu’il voit ; tant et si bien qu’un écrivain dépouille la réalité de tout ce qu’elle contient de plus important : l’indicible. »
« D’une certaine façon, les gens comme elle [l’Ecrivaine], ceux qui manient la plume, j’entends, peuvent être dangereux. On les suspecte tout de suite de mentir, de ne pas être eux-mêmes, de n’être qu’un œil qui ne cesse d’observer, transformant en phrases tout ce qu’il voit ; tant et si bien qu’un écrivain dépouille la réalité de tout ce qu’elle contient de plus important : l’indicible. »
écologie - Page 3
-
L'indicible
-
La gardienne et eux
Le titre du roman d’Olga Tokarczuk Sur les ossements des morts, publié en 2010 (traduit du polonais par Margot Carlier), est tiré du livre de William Blake, Le Mariage du Ciel et de l’Enfer (1793) – « Conduis ta charrue par-dessus les ossements des morts » – et les épigraphes des chapitres, de ses Proverbes de l’Enfer.
« Je suis à présent à un âge et dans un état de santé tels que je devrais penser à me laver soigneusement les pieds avant d’aller me coucher, au cas où une ambulance viendrait me chercher en pleine nuit. » L’autodérision rassure à l’entrée du récit. Je ne m’attendais pas à tant d’humour dans cette histoire qui commence avec des coups frappés à la porte au milieu de la nuit. Son voisin, Matoga, demande à la narratrice de s’habiller : « Grand Pied est mort. »
« Comment ça, « il est mort » ? » ai-je fini par demander, la gorge serrée, en rouvrant la porte. Mais Matoga ne m’a pas répondu.
En général, il est très peu loquace. Selon moi, il doit avoir Mercure en Capricorne, un signe de silence, ou bien en conjonction, en carré ou peut-être en opposition avec Saturne. Cela pourrait être aussi un Mercure rétrograde – ce qui est typique pour un introverti. »Mme Doucheyko (Janina, qui déteste son prénom et donne un surnom de son choix à chaque personne qu’elle rencontre) est une astrologue passionnée et la gardienne du hameau : elle veille sur les maisons vides durant l’hiver. Grand Pied, Matoga et elle sont les seuls à y vivre toute l’année. Matoga a entendu la chienne de Grand Pied aboyer, vu de la lumière dans la cuisine et il la prévient : « Ça n’est pas beau à voir. » Se frayant un chemin dans la neige derrière lui et sa lampe torche, elle remarque les yeux brillants de deux biches qui les suivent, des « Demoiselles » comme elle les appelle.
Ils n’arrivent pas à joindre la police par téléphone, juste à capter « la voix tchèque d’un répondeur automatique » (Luftzug n’est pas loin de la frontière). Matoga la convainc de déplacer le cadavre sur le divan et de l’habiller plus dignement, même si elle lui rappelle qu’ils devraient attendre l’arrivée de la police. Apparemment l’homme s’est étouffé avec un os coincé dans la gorge – il reste une tête de biche tranchée et des restes de repas dans sa cuisine.
L’hiver est difficile sur le plateau avec la neige, le vent, le grand froid, et la route est mauvaise, qui mène jusqu’à Wroclaw ou en Tchéquie. Bien que voisins, Matoga et Mme D. ne sont pas très proches : il est aussi ordonné qu’elle ne l’est pas. Elle n’aimait pas Grand Pied et avait même déposé plainte contre lui pour braconnage ; la police n’y avait pas donné suite, excédée par cette « folle à lier » qui prend la défense des animaux et tient tête aux chasseurs. La gardienne et eux ne sont pas en bons termes.
Passionnée par la chaîne météo et ses annonces qui divisent la population en « skieurs, allergiques et conducteurs », la narratrice observe les étoiles, enterre les animaux morts, surveille les maisons des Professeurs, de l’Ecrivaine, des Dupuits. Quand elle fait sa ronde dans le paysage noir et blanc, son œil est chaque fois blessé de se poser sur les « ambons », huit tribunes érigées par les chasseurs pour appâter le gibier.
Le jour, elle fait ce qu’elle a à faire, malgré ses maux douloureux. Le soir, elle s’occupe de thèmes astrologiques à l’aide d’éphémérides et de livres pour étudier « les ordres de la mort » selon les planètes. Son ancien élève Dyzio, informaticien de la police, lui a offert un ordinateur et vient chaque vendredi lui raconter son travail en cours : il traduit William Blake.
Une nuit au temps particulièrement exécrable, elle le reconduit en voiture (son « Samouraï ») et ils remarquent une lumière inhabituelle près du col ; ils y découvrent la voiture du chef de la police et son cadavre dans un vieux puits, entouré d’empreintes de sabots. « Dyzio, ce sont les animaux qui se vengent des hommes. » – « Tu es sous le choc. Tu racontes n’importe quoi. »
Sur les ossements des morts n’est pas un roman policier, mais il s’y produit une série de meurtres mystérieux sur lesquels Mme Doucheyko a sa propre idée. Très observatrice de la nature, du ciel, des animaux et des humains, elle commente tout sous un angle original, inattendu, attentive aux subtiles « corrélations » entre les choses. Matoga lui conseille de ne pas trop ébruiter ses théories, qui pourraient lui causer du tort, elle s’en fiche. Elle ne s’est jamais remise de la disparition de ses deux chiennes, ses « Petites Filles ».
Olga Tokarczuk campe ici un personnage de vieille excentrique très attachant, malgré ses lubies, voire à cause d’elles. Ingénieure des ponts et chaussées puis institutrice, elle donne encore des cours d’anglais une fois par semaine en ville. Ce roman nous apprend des noms d’oiseaux et d’insectes, des proverbes de Blake et décrit la vie quotidienne d’une retraitée dans ce coin perdu de Pologne où la Tchéquie toute proche semble le pays idéal. S’il y est question essentiellement de la vie et de la mort, c’est à travers une succession de péripéties désolantes et de remarques désopilantes que je me garderai bien de vous dévoiler.
(Un roman apprécié aussi par Dominique, Claudialucia, Keisha, Marilyne - entre autres.)
-
Le khejri
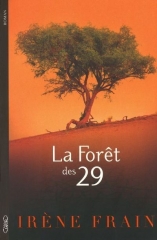 « Il voudrait être l’arbre qu’elle rejoint quand elle est fatiguée. Son tronc. Ses feuilles. Son ombre. Et cette écorce râpeuse qu’elle caresse toujours, d’un geste aussi rituel que fugace, avant d’aller s’asseoir à son pied. Karma ne choisit jamais un acacia ni un figuier, mais cet arbre-là, le khejri. « Les dieux se reposent sous ses feuilles, explique-t-elle en pointant son généreux cercle d’ombre. Même la terre, sous ses branches, reprend des forces, regarde comme elle est grasse ! Le khejri, c’est un arbre qui allaite le monde. »
« Il voudrait être l’arbre qu’elle rejoint quand elle est fatiguée. Son tronc. Ses feuilles. Son ombre. Et cette écorce râpeuse qu’elle caresse toujours, d’un geste aussi rituel que fugace, avant d’aller s’asseoir à son pied. Karma ne choisit jamais un acacia ni un figuier, mais cet arbre-là, le khejri. « Les dieux se reposent sous ses feuilles, explique-t-elle en pointant son généreux cercle d’ombre. Même la terre, sous ses branches, reprend des forces, regarde comme elle est grasse ! Le khejri, c’est un arbre qui allaite le monde. »Irène Frain, La forêt des 29
-
Djambo et sa légende
Il n’est pas écrit « roman » sous La forêt des 29 d’Irène Frain, un récit qui se lit comme un roman. Ce n’est pas un roman historique, bien qu’elle se soit très bien documentée sur la légende de Djambo, né en 1451 à Pipisar, dans le nord du Rajasthan, cette région d’Inde appelée alors « le Pays de la Mort », le désert du Thar, à cause des sécheresses à répétition. L’histoire de Djambo le sauveur y est colportée par les Charans, des vagabonds qu’elle appelle aussi « sourciers de la mémoire ». L’eau et la mémoire sont leurs biens les plus précieux.

Une femme Bishnoï arrose un arbre dans sa cour au Punjab. Les murs et le sol sont recouverts de bouse de vache et balayés deux fois par jour. La bouse est renouvelée deux fois par an.
Photo par courtoisie de © Franck Vogel, Les Bishnoïs.Comment la vie d’un gamin devient-elle une « splendide rivière d’histoires » ? Quand sa mère Hansa avait accouché à presque quarante ans, alors qu’une tempête de sable se rapprochait, les anciens annonçaient la fin du monde en cette troisième année de sécheresse. Son arrivée ne suscite guère l’enthousiasme de sa mère, comblée par les jumeaux qui l’ont précédé, d’autant plus que Djambo naît avec six orteils dont trois palmés. Le bébé se nourrit à un autre sein. Mais son père, un éleveur de chevaux, lui a souri et s’est occupé des rites à accomplir. Peu après, ils ont une averse, quelques orages, les choses se mettent à aller mieux.
A quatre ans, l’enfant qu’on croit mutique se met à parler aux animaux, aux arbres, et même sous l’arbre des anciens. Sa mère, devenue entre-temps la matriarche, le dit fou et monte ses frères contre lui, mais il échappe à tous les pièges, court comme une gazelle. Il cultive l’art de se faire oublier, d’être invisible. Quand on lui confie la garde des vaches, il les emmène dans une pâture éloignée à la lisière de la forêt. Il aime se cacher dans l’arbre des anciens pour apprendre le plus de choses sur le village et sur les gens.
C’est de là qu’il entend son père décréter un jour que cela suffit de tolérer les excès des Bhils, leurs voisins chasseurs insatiables, qui se sont mis aussi à abattre des arbres pour satisfaire les caravaniers avides de bois à vendre ailleurs à ceux qui n’en ont plus, depuis que le village le leur refuse. A treize ans, quand sa nourrice meurt, Djambo ne trouve plus de petit bois pour le bûcher. Il en veut aux Bhils jusqu’à vouloir en tuer un en l’attirant dans un piège où il a planté un pieu sous une trappe. Il en repère un qui a abandonné une antilope blessée, mais le garçon est pris soudain dans un nuage de poussière.
Quand il rouvre les yeux, c’est une scène-clé de sa vie qui se produit : un chef guerrier ne peut ranimer la femme couverte d’or et enceinte qui l’accompagne, mourante. Djambo donne sa gourde, elle n’arrive pas à boire. Désespéré, l’homme l’achève puis lui ôte tous ses bijoux. Il laisse une chaînette d’argent à Djambo pour l’enterrer. Le piège préparé pour le Bhil fera une tombe pour la femme et l’antilope, à l’abri des prédateurs.
Ce guerrier fameux s’appelle Bika, il devient le « Rao », le roi des tribus de la région qui se soumettent à lui pour vivre en paix. Il parle peu, ne se confie à personne à part son masseur. Bika a été chassé par les siens, le clan des Rathores, qui ont rejeté sa femme, Noor, de basse extraction. Sa mort et celle de l’enfant qu’elle portait le hantent. Aussi s’est-il juré de construire un palais fabuleux dans le désert, malgré le désaccord de son oncle qui l’adjure de ne pas devenir l’ennemi de l’eau et de la forêt.
Djambo, de son côté, devient à douze, treize ans le responsable des terres familiales. Ses frères jumeaux sont morts, sa mère est dévastée. Heureusement il peut compter sur sa jeune tante Karma dont la famille s’est réfugiée chez eux après avoir été volée et violée par des soldats de Bika. Elle apprend à son neveu tout ce qu’elle connaît du désert : le ciel, les vents, le sable, les arbres, les animaux.
L’harmonie avec la nature sera à jamais, pour Djambo, liée aux femmes : tenir compte de la lumière et de l’ombre pour savoir où semer et quoi, recueillir les gouttes de rosée dans une gourde, respecter les insectes, les reptiles, élever une dune et la fixer par des buissons pour protéger le champ contre les poussiers, attirer les oiseaux avec des graines et un peu d’eau. L’arbre le plus utile à planter dans le désert, c’est le khejri. Par grande sécheresse, ses cosses donnent de quoi manger.
Ce n’est qu’à quinze ans que le dernier fils d’Hansa et Lohat sera appelé Djambo, qui veut dire « Merveille ». Sa mère continue à le maudire et il se décide à partir. Un vieux magicien au turban jaune vif, Sawant (« Soleilleux »), qui appartient au Peuple des Chemins, accepte de l’initier d’abord à son art de vivre, fait de discipline et d’exactitude, de parole aussi, puis à son art qui fascine ceux qui y assistent au crépuscule. Le jeune magicien fera plus tard une autre rencontre décisive, celle de Binji, une danseuse ambulante qui rêve de se produire devant le Rao de Bikaner, la cité fabuleuse de Bika que tout le monde vante sur les chemins.
C’est dans les « Annales du désert » que les Charans content l’histoire de Djambo, entre réalité et légende, riche en rebondissements. En 1485, celui-ci, devenu prophète malgré lui, revient dans sa région natale. Il y ramène l’eau et les arbres, et fonde le mode de vie des Vingt-Neuf, appelés ainsi pour les 29 principes respectés dans ce village de cultivateurs d’un nouveau genre, sans castes, où les hommes sont tous habillés de blanc, les femmes de rouge. Ils plantent et protègent les arbres, ils vivent en bonne entente avec les animaux sauvages.
Irène Frain conclut son récit romanesque en résumant les siècles qui ont suivi l’épopée de Djambo et en racontant l’incroyable « Massacre et Immolation de Khejarli » où 363 hommes, femmes et enfants ont donné leur vie pour protéger une forêt. Elle fait le point sur la situation actuelle des Bishnoïs (« 29 » en hindi), qui sont actuellement près de huit cent mille en Inde, principalement au Rajasthan, entre Jodhpur et Bikaner. Irène Frain s’est appuyée entre autres sur le travail de Franck Vogel qui leur a consacré un reportage photographique en 2009 et a fondé l’association « S’inspirer des Bishnoïs ».
-
Nouveau-né
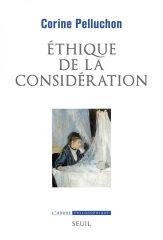 « En faisant du nouveau-né l’emblème de la considération, en insistant sur le potentiel et l’imprévisibilité liés à la venue au monde de chaque personne, mais aussi sur son inscription dans un monde déjà-là, avec ses traditions et ses codes, nous mettons en évidence le fait que chaque naissance est nouveauté et continuité. Toute personne qui porte un nouveau-né dans ses bras devrait penser aussitôt à ce dont ce dernier a besoin pour s’épanouir. Cela signifie réfléchir au type d’organisation politique pouvant lui permettre de s’accomplir et comprendre que les nouveaux arrivants doivent être accueillis dans un monde stable qui les aide à se situer par rapport au passé et à créer quelque chose de neuf susceptible de faire évoluer ce monde. C’est en ce sens que le nouveau-né peut nous mettre sur le chemin de la considération. »
« En faisant du nouveau-né l’emblème de la considération, en insistant sur le potentiel et l’imprévisibilité liés à la venue au monde de chaque personne, mais aussi sur son inscription dans un monde déjà-là, avec ses traditions et ses codes, nous mettons en évidence le fait que chaque naissance est nouveauté et continuité. Toute personne qui porte un nouveau-né dans ses bras devrait penser aussitôt à ce dont ce dernier a besoin pour s’épanouir. Cela signifie réfléchir au type d’organisation politique pouvant lui permettre de s’accomplir et comprendre que les nouveaux arrivants doivent être accueillis dans un monde stable qui les aide à se situer par rapport au passé et à créer quelque chose de neuf susceptible de faire évoluer ce monde. C’est en ce sens que le nouveau-né peut nous mettre sur le chemin de la considération. »Corinne Pelluchon, Ethique de la considération