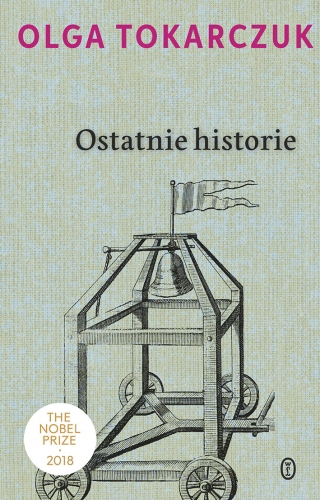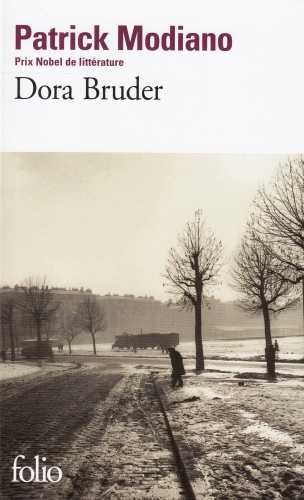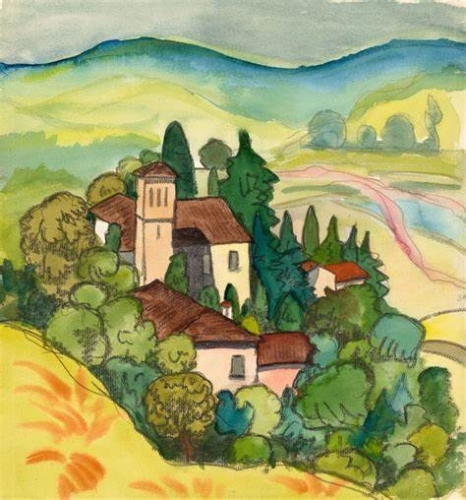Klara et le soleil (2021, traduit de l’anglais par Anne Rabinovitch) : le titre de Kazuo Ishiguro était noté depuis assez longtemps pour que j’aie perdu son sujet de vue. Aussi ai-je hésité en début de lecture : allais-je vraiment m’embarquer dans un roman qui donne la parole à Klara, une AA, à savoir une amie artificielle, un robot qui fonctionne à l’énergie solaire ? S’il n’y avait pas eu la signature de l’auteur des Vestiges du jour et d’Un artiste du monde flottant, prix Nobel de littérature 2017, je ne sais si j’aurais continué.

Octave Soudan (1872-1947), Rayon de soleil sur la ferme
Auprès de moi toujours était déjà un roman d’anticipation (autour des dons d’organes). D’une manière ou d’une autre, Ishiguro explore les relations que nous avons avec nos proches et l’expérience de la solitude. Dès le début, quand elle est encore neuve, Klara est une excellente observatrice de ce qui se passe dans la boutique et au-dehors (ce qu’elle peut apercevoir de la vitrine). Elle assiste au succès de la nouvelle génération Boy AA Rex, mais Gérante la rassure : un jour, l’un des enfants qui entrent dans la boutique la choisira, elle, Klara, si douée pour regarder et apprendre, voire comprendre les humains.
Ce sera Josie, « une fille pâle et frêle » de quatorze ans, qui la salue à travers la vitre et à qui Klara rend son sourire. Heureuse de ses réactions, Josie lui promet de revenir. Après quelques jours, elle réapparaît et lui confie qu’elle ne se sent pas très bien parfois ; si elle accepte de devenir son amie, il faut que ce soit en toute connaissance de cause. Quelque temps plus tard, Josie revient avec sa mère. Pour tester l’AA, celle-ci lui demande d’imiter la démarche de sa fille – « Très bien. Nous la prenons. » (Fin de la première partie du roman qui en compte six.)
Ishiguro raconte l’arrivée de Klara dans la maison où Josie vit avec sa mère et une gouvernante qui s’occupe d’elle quand sa mère est au bureau. Klara aura pour tâche de veiller sur Josie dont elle partagera la chambre, de la distraire et de donner l’alarme en cas de besoin. L’amie artificielle découvre leur univers, leurs habitudes, et peu à peu les choses et les gens qui comptent aux yeux de Josie. Elle observe ce qui lui fait plaisir, reçoit ses confidences. Quand elle doit assister aux rencontres de socialisation entre Josie et d’autres jeunes, elle est beaucoup moins à l’aise ; certains la traitent comme un jouet sophistiqué.
On découvrira peu à peu des secrets, un drame sous-jacent, des tensions. Comment affronter la maladie, la nôtre ou celle d’un proche ? Klara n’a pas seulement été acquise pour tenir compagnie à Josie. Sa sensibilité est telle qu’elle développe des compétences très proches des sentiments humains. Qu’est-ce qui nous humanise ou nous déshumanise ? Jusqu’où iront nos rapports avec les machines ?
L’addiction au numérique est déjà bien visible. Ishiguro va encore plus loin en prêtant à l’amie artificielle de surprenantes qualités d’empathie – une version romanesque de l’intelligence artificielle. Klara et le soleil questionne les comportements et la manière dont les relations interpersonnelles évoluent, dans cette dystopie où la frontière entre être humain et robot semble de plus en plus poreuse.