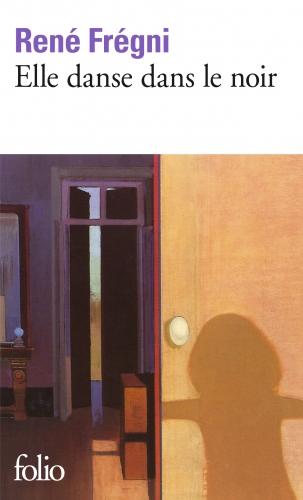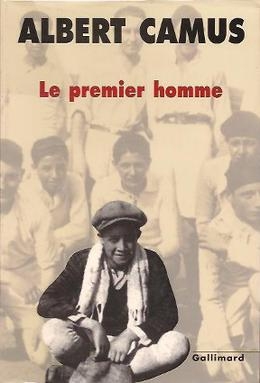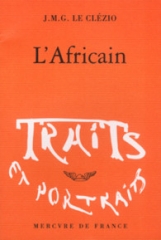Le titre semble s’accrocher à ma lecture précédente, mais rien d’Elle danse dans le noir (1998) de René Frégni ne ressemble à La danseuse de Modiano. « A ma mère morte. A ma mère vivante » : en lui dédiant son récit, Frégni amorce ce que j’appellerais un lent adieu à celle qui l’a le plus aimé, qui lui a tout donné.
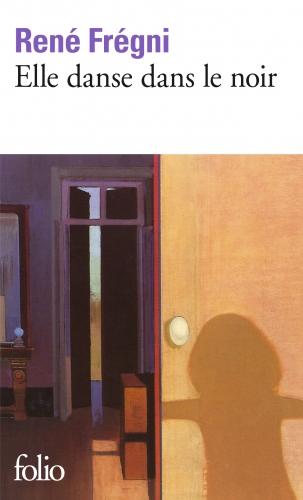
« En quatre ans, j’ai perdu ma mère, puis mon père, la femme avec qui j’ai vécu vingt ans m’a dit un soir : « Je n’ai plus de désir pour toi », le lendemain elle partait. » L’été a heureusement commencé en compagnie de sa fille de six ans, mais depuis le premier août, Marilou est partie avec sa mère. « Dans mon appartement silencieux je vis seul, comme ma mère a vécu les dernières années de sa vie, alors que mon père paralysé était dans une maison de retraite. » Son amour pour sa fille est son rempart contre la tristesse. Alors il se remet à écrire « pour apaiser son cœur ».
Il rêve d’une femme qui partagerait ses nuits. Mais il lui faut raconter le début, ce matin de juillet, cinq ans auparavant, où sa mère, qui était infirmière, lui a dit sa peur. Le gastro-entérologue chez qui il l’avait accompagnée lui avait chuchoté à l’écart la gravité du mal, il fallait l’opérer rapidement, mais à sa mère il avait parlé, rassurant, d’un simple polype à enlever. « J’ai senti que c’était notre dernier été. » Sa mère n’était pas dupe, elle se laissait guider par lui « comme une enfant s’abandonne ».
Quand lui échoit la dernière chambre disponible à la clinique d’Avignon où on l’a hospitalisée en urgence et où sur l’autre lit, souffre une femme « en phase terminale », un premier cri de révolte de René Frégni ouvre le récit des douloureuses vicissitudes qui ont marqué les derniers mois de sa mère. Tout ce qu’il peut faire pour l’en distraire, la consoler, il le fait, avec une grande tendresse. Sa mère lui raconte son enfance à Moustiers-Sainte-Marie, elle veut le rassurer comme elle l’a toujours fait.
Il en est malade, perd l’appétit, passe des nuits sans trouver le sommeil, imagine une femme qu’il rencontrerait dans les rues désertes et qui lui parlerait, à qui il ferait l’amour. Ou bien il hurle, met la musique à fond, s’effondre, puis ouvre un cahier, attrape un stylo : « Chaque cahier qui s’ouvre est un berceau calme et blanc. Chaque cahier fait de nous un enfant. »
René Frégni revient sur les séances d’écriture avec les détenus des Baumettes à Marseille – « les hommes que je comprends le mieux. » Pour Polo, un Corse de cinquante ans sorti de prison il y a quelques mois et qui comptait sur sa visite, il traverse la ville jusqu’au Bar César qu’il tient avec sa femme. Tournée générale. Un Polo bouleversé le présente à tous, et c’est parti pour une série de pastis sans eau, jusqu’à la fermeture. Après, il lui prépare des pâtes et ils restent « sans parler, égarés et heureux dans une nuit et une ville qui n’existaient plus. »
Tant qu’elle peut marcher, il se promène dans le parc avec sa mère, de plus en plus maigre. Elle le supplie de la ramener chez elle, convaincue que la radiothérapie lui brûle le ventre. Lui, « aveuglé par la peur de la perdre », résiste jusqu’au jour où on la transporte en ambulance à Manosque avec une brûlure au troisième degré dans le dos. Grande colère contre les médecins qui maltraitent les malades et contre ceux qui parlent à leurs proches sans humanité.
Chez lui, il retrouve cette année-là Marilou dans son petit lit blanc, son bébé qui ramène la paix en lui. Mais près de sa mère, malgré quarante ans de tendresse, il n’ose lui caresser les cheveux ni lui prendre la main. « J’étais devenu un homme ; une forteresse de pudeur. » Les pages les plus douces d’Elle danse dans la nuit décrivent les tendres moments de l’enfance, de la sienne avec sa mère, de sa fille avec lui. Elles alternent avec le récit de la bataille contre la maladie.
Lors d’un bref séjour à Paris, à la demande de son éditeur, Frégni trompe sa solitude un soir chez un marchand de vin, invite une jeune femme seule à partager sa bouteille ; sensible à son accent du Sud, celui de son enfance, elle accepte et il découvre de près le petit tatouage noir sur sa paupière droite – un cafard ! Elle l’invitera dans sa minuscule chambre de bonne et chantera pour lui en jouant du tampura avant de lui faire l’amour, avec une lenteur inédite.
L’œuvre de René Frégni est une traversée de la nuit et un chant d’amour. L’histoire d’un fils, l’histoire d’un père. Chaque matin, il conduit Marilou à l’école. Dans leur petite ville, il apercevait régulièrement sa femme avec son nouveau compagnon, le cœur à vif ; elle finit par décider d’elle-même de déménager. On lit le cœur serré le récit de la fin d’une mère aimée, les mots d’un fils qui perd pied, qui vit ce qu’il a toujours craint le plus, sa mort. Elle danse dans le noir lui rend hommage, comme l’avait fait Minuit dans la ville des songes. Comment se perdre et se retrouver, comment continuer à aimer.
 « Ce sont les mots qui reviennent les premiers, non les femmes qui sont parties. Les mots reviennent à pas de loup, aussi silencieux que des papillons noirs. Les mots ne nous trahissent pas. Ils nous effraient, ils nous fuient. Lorsqu’on a vraiment besoin d’eux, ils entrent dans la maison par les fenêtres et par les portes, par le soleil et par la lune, par toutes les lumières des saisons. Ils se glissent partout, dans les chemises, dans les placards, dans les draps. Violemment ils vous accrochent le ventre, vous poussent vers la table. On ouvre un cahier, on attrape un stylo. Ils sont là, précis et rassurants comme une mère.
« Ce sont les mots qui reviennent les premiers, non les femmes qui sont parties. Les mots reviennent à pas de loup, aussi silencieux que des papillons noirs. Les mots ne nous trahissent pas. Ils nous effraient, ils nous fuient. Lorsqu’on a vraiment besoin d’eux, ils entrent dans la maison par les fenêtres et par les portes, par le soleil et par la lune, par toutes les lumières des saisons. Ils se glissent partout, dans les chemises, dans les placards, dans les draps. Violemment ils vous accrochent le ventre, vous poussent vers la table. On ouvre un cahier, on attrape un stylo. Ils sont là, précis et rassurants comme une mère.