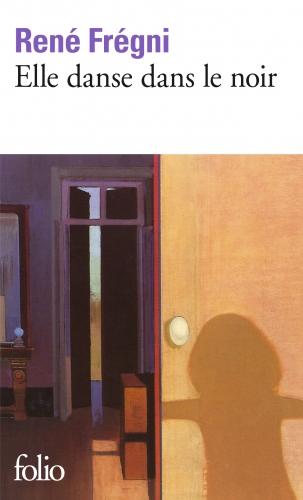Lire Frantumaglia. L’écriture et ma vie d’Elena Ferrante m’a poussée à ouvrir son deuxième roman, Les jours de mon abandon (2002, traduite de l’italien par Italo Passamonti, 2004). Un jour d’avril, Mario, le mari d’Olga, « tandis que les enfants se chamaillaient comme à l’ordinaire dans une autre pièce », lui annonce qu’il veut la quitter et il s’en va.

Olga (la narratrice) se souvient de deux moments où leur vie, en quinze ans de mariage, a déjà été troublée de cette façon, du fait de Mario : après six mois de vie commune et puis cinq ans plus tôt, quand ils habitaient Turin depuis quelques mois et que son mari était attiré par Gina, sa collègue à l’Institut polytechnique, qui leur avait trouvé « un bel appartement donnant sur le fleuve » et avait une fille de quinze ans.
Au début, Mario revient régulièrement rendre visite à leurs enfants, Gianni et Ilaria. A trente-huit ans, Olga fait front ; il n’est pas question pour elle de ressembler à cette voisine de Naples complètement ravagée par le départ de son mari que sa mère appelait toujours « la pauvrette ». Elle est convaincue, puisque Mario a dit n’avoir rien à lui reprocher, que tout finira par rentrer dans l’ordre. Mais ses visites aux enfants s’espacent, elle sent monter la rancœur et l’angoisse.
Son désarroi la rend désordonnée, maladroite, et elle décide de mettre son mari « au pied du mur » en l’interrogeant. Elle prépare un repas qu’il aime, mais nerveuse, elle laisse une bouteille de vin lui échapper des mains, puis le sucrier ; elle se coucher avant d’aller chercher les enfants à l’école. Ce soir-là, elle insiste pour savoir s’il y a une autre femme dans sa vie : Mario finit par reconnaître que oui. Puis la situation dégénère : il se blesse la bouche à cause d’un morceau de verre tombé dans la sauce tomate des pâtes et s’en va en hurlant.
Bouleversée, Olga veut réagir et d’abord sauver les apparences : ne pas laisser voir son désespoir comme « la pauvrette », éviter « de ressembler aux femmes rompues d’un livre célèbre » (La femme rompue de Simone de Beauvoir) que lui avait fait lire son prof de français quand elle avait proclamé, vingt ans plus tôt, qu’elle voulait « être écrivain ».
Malgré elle, Olga commence à se négliger, se surprend à utiliser un langage obscène, elle qui a toujours veillé à s’exprimer de façon soignée. Elle observe avec terreur comment les choses lui échappent, jusqu’à lui faire craindre d’oublier ce qu’elle a à faire et même ses enfants. Pour se calmer, la nuit, elle écrit des lettres à Mario, et dort le jour. Sa vie devient de plus en plus confuse et les enfants s’en rendent compte.
Après un appel de Mario sur son portable – la ligne fixe est sans cesse en dérangement –, elle tâche de s’arranger un peu et met l’appartement en ordre pour sa visite, mais la dispute éclate. Il lui faut trouver où il vit Mario avec qui, même si les amis à qui elle a téléphoné sont restés évasifs. Olga se met à errer la nuit, observe leur voisin Carrano rentrer tard dans leur immeuble et trouve par terre son permis de conduire.
Tous les problèmes domestiques dégénèrent, que ce soit une invasion de fourmis ou qu’Olga se fasse insulter au parc où elle promène Otto, leur chien-loup, qui fait peur aux gens. Après que les enfants, oubliés, sont rentrés seuls de l’école et disent avoir trouvé la porte entrouverte, elle fait changer la serrure. Elle est de plus en plus confuse et sans patience.
Lorsqu’elle aperçoit un jour Mario et sa nouvelle compagne devant la vitrine d’une bijouterie et qu’elle reconnaît Carla, la fille de Gina, à présent majeure, elle frappe violemment son mari, déchire sa chemise, sans se soucier des gens qui regardent la scène. « Que pouvais-je faire après tout, j’avais tout perdu, tout ce qui était à moi, tout, irrémédiablement tout. »
Cette dernière phrase du chapitre quinze, à peu près au milieu des Jours de mon abandon, marque le début d’une dérive dans le comportement d’Olga : vis-à-vis de son voisin, de ses enfants, du chien, d’elle-même – qui s’abandonne. Il ne s’agit plus seulement de distraction, d’oubli, mais d’hallucinations, d’une sorte de cauchemar éveillé à côté de sa vie, aux franges de la folie.
Comme Elena Ferrante l’explicite dans Frantumaglia, il n’était pas question pour la romancière de laisser son héroïne se dissoudre dans l’abandon : au contraire d’Anna Karenine ou d’Emma Bovary, Olga souffre mais lutte, résiste. On ne lâche pas le récit de plus en plus intense de ses débordements et au bout du compte, on verra comment, peu à peu, elle trouve une issue.
 « Ma mère disait à voix basse à ses ouvrières, l’une brune, l’autre blonde : « La pauvrette avait cru que son mari se repentirait et accourrait aussitôt à son chevet pour se faire pardonner. » Au contraire, il était resté loin, prudemment, avec cette autre femme que maintenant il aimait. Et ma mère riait amèrement de l’acrimonie de cette histoire et d’autres en tous points semblables qu’elle connaissait. Les femmes sans amour mouraient vives. C’est ce qu’elle disait tandis qu’elle cousait des heures et des heures et, entre-temps, elle coupait des vêtements sur ses clientes qui, à la fin des années soixante, venaient encore chez elle faire tailler leurs habits sur mesure. Récits, médisances et couture : j’écoutais. Le besoin d’écrire des histoires, c’est là que je l’ai découvert, sous la table, tandis que je jouais. »
« Ma mère disait à voix basse à ses ouvrières, l’une brune, l’autre blonde : « La pauvrette avait cru que son mari se repentirait et accourrait aussitôt à son chevet pour se faire pardonner. » Au contraire, il était resté loin, prudemment, avec cette autre femme que maintenant il aimait. Et ma mère riait amèrement de l’acrimonie de cette histoire et d’autres en tous points semblables qu’elle connaissait. Les femmes sans amour mouraient vives. C’est ce qu’elle disait tandis qu’elle cousait des heures et des heures et, entre-temps, elle coupait des vêtements sur ses clientes qui, à la fin des années soixante, venaient encore chez elle faire tailler leurs habits sur mesure. Récits, médisances et couture : j’écoutais. Le besoin d’écrire des histoires, c’est là que je l’ai découvert, sous la table, tandis que je jouais. »