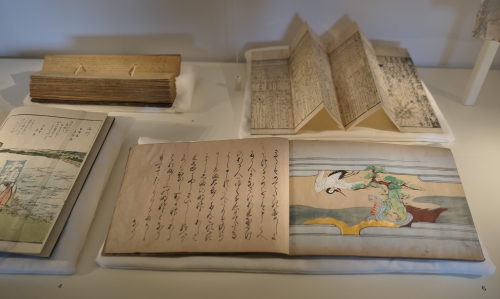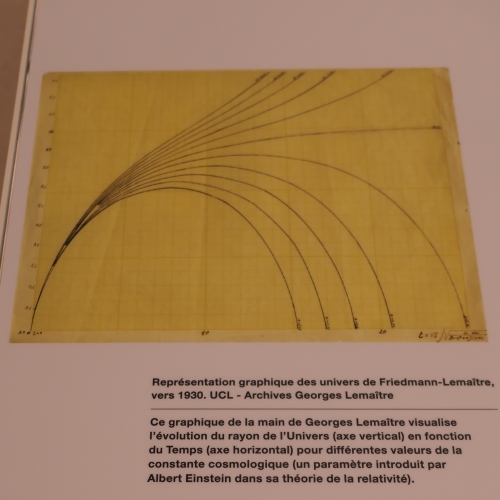Le mât de Lalaing était le point de ralliement pour cette Estivale dans le quartier des Azalées, « l’autre quartier des fleurs », dixit Yves Jacqmin, notre guide pour cette promenade guidée en haut du parc Josaphat. Près de l’arrêt « Azalées » du bus 66, il attire notre attention vers l’aigle héraldique sous l’oriel d’une maison de style beaux-arts – le « culot » – au 15 de l’avenue Paul Deschanel ; nous en verrons un autre plus loin sur le parcours.
C’est en 1900 que cette section du boulevard Vande Putte a reçu le nom du président français, dans la continuité de la première, rebaptisée avenue Voltaire. (Choix francophiles qu’on retrouve dans ces résidences dont je vous ai un jour montré les portes.) Paul Deschanel, fils d’un républicain condamné à l’exil après le coup d’Etat du 2 décembre 1851, est né à Schaerbeek en 1855. « Il a Victor Hugo pour parrain spirituel qui le présente comme le « premier-né de l’exil » » (Wikipédia). La Belgique a aussi été une terre d’accueil pour les communards.
L’immeuble à appartements de style Art Déco, de l’autre côté de l’avenue Deschanel (ci-dessus), date de la fin des années 1920. On a construit ici pour la classe moyenne, la bourgeoisie aisée. L’avenue des Azalées, le long du parc, accueillait des notables (photo 1). Nous passons sur le pont du chemin de fer, dont l’ancien tracé « passait à l’air libre à l'emplacement des actuelles avenues Deschanel et Voltaire » ; en 1902, on a déplacé la ligne de quelques dizaines de mètres vers l’est et construit des ponts sur tout son parcours. Nous allons observer dans ce quartier bâti de 1911 à 1913 une tendance bien belge à l’individualisme : il faut se différencier de son voisin. Même dans les ensembles de cinq ou six maisons parfois du même architecte, on se distingue par le style ou par l’ornementation. L’éclectisme domine.
Le glacier Cocozza (photo 1 et ci-dessus) occupe l’ancien Palace Josaphat : c’était, très bien située en début d’avenue près du parc, une brasserie fort fréquentée, aux nombreuses terrasses dont une sur le toit. Cet immeuble « de style éclectique d’inspiration Art nouveau » conçu par Gustave Strauven a été fort transformé dans les années vingt. On retrouve encore les initiales « PJ » dans les sgraffites.
Nous obliquons à droite dans la rue des Pâquerettes. Au 118, une façade atteste du goût vivace pour le néo-Renaissance : pignon en cloche, briques rouges et pierre blanche, décor de losanges. Le balcon du premier étage l’alourdit, celui du dernier est plus réussi. Notre guide fait remarquer le manque d’alignement entre les maisons, les hauteurs variées reflètent une grande tolérance urbanistique ; les dérogations obtenues par les uns constituent des précédents pour les suivants.
Une participante habite le 114 et aimerait une explication des initiales de part et d’autre de la porte de garage aménagée au milieu du siècle dernier, bien intégrée et respectueuse des matériaux d’origine avec sa porte en bois. Cette maison bourgeoise porte le monogramme de l’architecte Adolphe Puissant. La façade du 102 a été sablée récemment, de style néo-éclectique d’inspiration Art nouveau. L’entrée asymétrique est originale, ainsi que les fenêtres au-dessus de la porte séparées par un sgraffite et l’oculus à bec sous une corniche ornée d’une frise.
Dans un style plus géométrique, plus épuré, avec un beau contraste entre les briques et la pierre bleue, le 94 (Jean de Ligne) aussi a été bien rénové en conservant les petits-bois aux fenêtres. Le 86, avec son bow-window, rompt l’alignement entre les étages de maisons mitoyennes. Que de choses à observer dans cette rue : une curieuse imposte oblongue au 68, des encadrements de fenêtres, des châssis à fines baguettes, des sgraffites…
A l’entrée de la rue Fontaine d’amour, l’architecte René Bartholeyns a donné beaucoup de caractère aux numéros 1 et 3 (un immeuble de rapport et sa propre maison). Yves Jacqmin fait remarquer l’étroitesse des quatre maisons suivantes (à partir de celle au drapeau, à gauche) et la façon dont elles se distinguent les unes des autres, quoique dues au même architecte. « Étroitesse compensée en façade par la polychromie de l’ensemble, l’originalité renouvelée des décrochements et le jeu des corniches. » (Inventaire du patrimoine architectural)
Une évolution vers l’Art Déco se dessine au 48 de la rue des Pâquerettes, avec son décor de fruits ; il est suivi d’une enfilade de maisons à la fois semblables et différentes. Nous nous arrêterons aussi en face du 16, une façade où la fantaisie, en particulier dans le jeu des briques, relève du kitsch – qui appartient aussi à l’histoire de l’art, déclare notre guide. Au 12, il signale de beaux amortissements en pierre bleue (éléments décoratifs au sommet d’une élévation) d’inspiration Art nouveau, détails que l’on ne voit pas quand on n’y est pas attentif !
Nous voici à l’avenue Général Eisenhower (depuis 1944), anciennement avenue des Hortensias : ses habitants avaient à cœur d’y planter des hortensias dans leurs jardinets ornés de grilles, comme on peut le voir sur une photo ancienne (IPA). La façade du 19 en rappelle une autre de l’avenue Louis Bertrand, du même architecte, dans le style néo-Renaissance. Son jardinet a disparu au profit d’un emplacement de voiture.
Du côté pair, d’inspiration pittoresque, le 24 (Jean Coppieters) a belle allure après une rénovation très récente. La maison a obtenu la médaille d’argent au Concours de façades de 1913 organisé par Schaerbeek. Elle arbore son nom, « Villa des Hortensias », sur un décor de fleurs très réussi. Ses boiseries précédemment blanches ont été peintes en vert, le rez-de-chaussée n’est pas encore terminé ; l’ensemble est recherché, avec un décor au sol soigné devant les portes.
Après de belles maisons au 29 et au 31, nous observons au 41 les choix nouveaux de l’Art Déco : des formes polygonales, des fenêtres plus modernes. Ce style peut revêtir des apparences très différentes, comme le montre la comparaison entre le 69, avec ses vitraux et ses bandeaux qui échappent à l’abstraction, et l’immeuble à appartements en face, avec ses bas-reliefs. L’Art Déco géométrise les formes mais ne renonce pas à l’ornement, contrairement à l’architecture héritière du Bauhaus.
Pendant que notre guide commente une maison Art nouveau au 94, un des participants attire mon attention vers une maison blanche un peu plus loin, avec de belles sculptures aux extrémités des balcons du dernier étage et au pied des pilastres. Et revoici, au 105-107, un aigle sous oriel, très stylisé cette fois, sous une baie vitrée à angles coupés. On ne remarque pas tout de suite qu’il s’agit de deux maisons (Jean Marchal, 1927-1928) avec une seule porte d’entrée, l’entrée carrossable donnait accès à des magasins.
La promenade guidée se termine sur l’avenue des Azalées, avec ses belles maisons donnant sur le parc Josaphat, très recherchées. Styles beaux-arts, néo-Renaissance, Art Déco, moderniste s’y côtoient. Après le 66 et le 60 – ici tous les numéros se suivent sur un seul côté –, nous nous arrêtons devant la maison personnelle de Louis Bertrand, au 51.
Ce vendeur de journaux puis apprenti marbrier s’est élevé dans la société en suivant des cours du soir ; en plus du Parti Ouvrier belge et du journal Le Peuple, l’homme politique est un des fondateurs du Foyer schaerbeekois, première société de logements sociaux en région bruxelloise. Joseph Diongre a conçu cette maison bourgeoise aux garde-corps originaux. A côté, deux immeubles de rapport « en miroir », de style éclectique, ont été achevés après la première guerre mondiale par le Foyer schaerbeekois.
A l’angle de la rue Fontaine d’amour, l’ancien café des Azalées, aujourd’hui le sympathique café Central Park, occupe le rez-de-chaussée d’un immeuble néo-Renaissance de Jean Teughels, où figurent une étoile de David (par association avec « Josaphat » ?) et, plus haut, une statue non identifiée. Pour ce qui est des sculptures, on ne peut manquer les numéros 33 et 32 au décor d’inspiration médiévale (ce sera pour le billet suivant).
Derniers coups d’œil de notre belle balade estivale : au 31, un des premiers sgraffites restaurés par Monique Cordier, qui en a redécouvert la technique, malheureusement déjà noirci après quelques années ; au 27, une façade moderniste de 1929 aux carreaux gris ; au 22, joli point final, non pas un sgraffite mais une remarquable mosaïque représentant des enfants… et des fleurs d’azalées !