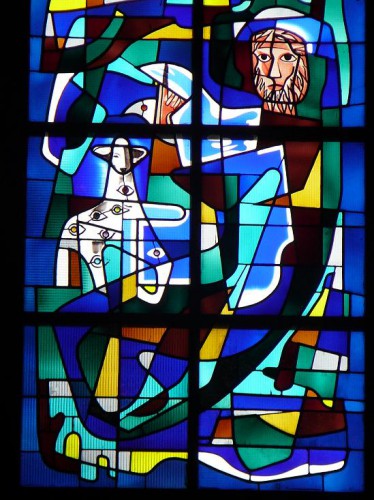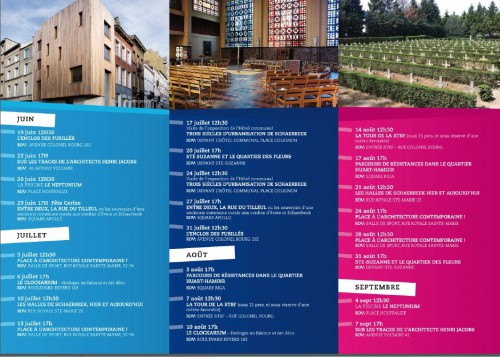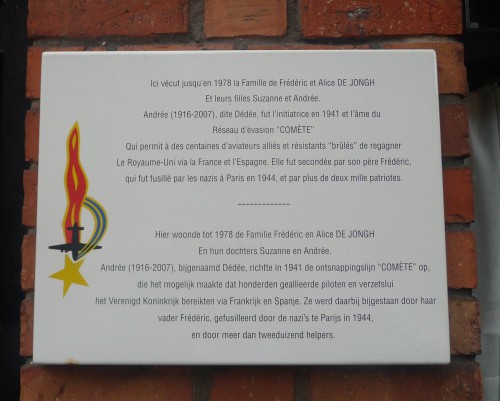Un sentier « au fil de l’eau », voilà de quoi tenter sous un ciel d’azur parfait : en route pour La Valette-du-Var, près de Toulon. « Autrefois, La Valette a bâti sa prospérité sur une activité maraîchère et horticole intense, elle-même rendue possible par l’eau qui abondait et abonde encore au pied du Coudon. » (Citations tirées du prospectus de la mairie, disponible à l’entrée de l’Hôtel de Ville). La promenade est aussi présentée dans la brochure Escale à Toulon Provence Méditerranée (Office du tourisme).
Nous laissons la voiture au parking souterrain Jean Jaurès (gratuit) : de la place Charles de Gaulle, nous empruntons la rue du Char Verdun pour commencer le parcours à la fontaine de la Convention, près de l’église Saint Jean. Une baignoire enveloppée dans un drap y sert de fonts baptismaux ! Les terrasses, les platanes, c’est un endroit très agréable pour prendre un café au soleil par ce matin frais d’avril.
De la fontaine aux robinets sculptés, une ruelle nous mène à une autre, très moderne avec son plan d’eau à fleur de pierre, où les pigeons qui s’abreuvaient s’envolent quand je m’empare de l’appareil photo – soit, ce sera sans eux. La rue de la Résistance remonte vers un ancien lavoir devenu salle d’exposition où l’eau s’écoule le long de murs moussus.
Plus haut, nous voici au pont Sainte-Cécile (XVe siècle) qui « reçoit sous son arche l’eau descendue de la Foux », une belle cascade fleurie. Le sentier suit le ruisseau à partir du square de l’Europe – à partir de là son sympathique glouglou accompagne la promenade, ce qui nous rappelle l’ambiance d’un tout autre pays, celui des bisses.
C’est « le sentier de desserte des domaines riverains » : les propriétaires y détournaient les eaux du ruisseau pour arroser leurs cultures de fruits et de fleurs. Avant de traverser l’avenue de la Libération, un coup d’œil à la superbe grille d’entrée de la résidence des Volubilis, puis nous suivons « la serve des Icards » dont le grand bassin de rétention a été consolidé au fil des ans par des contreforts, grâce aux Amis du Coudon qui les ont restaurés ainsi que les canaux d’irrigation.
En haut, la fontaine Jeanne, installée sans doute bien avant 1661 (date gravée sur la pierre) par la reine Jeanne, « comtesse de Provence et reine de Naples », servait d’abreuvoir aux animaux, « notamment aux moutons qui partaient en transhumance ». Je reviendrais volontiers pour une balade guidée le long du « ruisseau chantant », seule manière d’accéder à « la Maïre des eaux », la source abritée dans un caveau du XVIIe siècle.
Mais une autre récompense attend là les promeneurs (on peut aussi y arriver en voiture) : un jardin remarquable, celui du domaine de Baudouvin (deux euros l’entrée). Depuis la Saint Valentin et jusqu’au 10 juin prochain, il décline le thème du « Jardin Romantique » – des cœurs en veux-tu en voilà et même une petite exposition dédiée aux romans d’amour les plus célèbres, à l’intérieur de la bastide en restauration dans la partie haute du domaine.
« Les hautes grilles s’ouvrent sur un monde réellement merveilleux, alternant carrés potagers traditionnels et vergers d’agrumes », le long d’une magnifique allée de platanes, puis de terrasses déclinant divers décors et ambiances, « multipliant les points de vue sur le lieu » (Prospectus Parcs, squares et jardins valettois). Près du jardin japonais, la sono est assurée par les grenouilles en pleine période de reproduction : elles sont partout près des bassins animés par une fontaine aux arrosoirs, des passerelles, des sculptures en métal.
Le blason du jardinier André Le Nôtre, rappelle un écriteau, portait trois limaçons, censés rappeler au roi Louis XIV que la lenteur dont il se plaignait était une loi de la nature. On retrouvera des limaçons parmi les sculptures de ce grand jardin de Provence (la plupart contemporaines), plus vaste qu’il ne paraît à l’entrée. Les terrasses se succèdent et mènent à un bosquet : des dessins de Peynet sont accrochés le long d’une allée, variations sur le thème amoureux.
Baudouvin offre toutes sortes de recoins à découvrir : une prairie de pâquerettes près d’un hôtel à insectes, un solarium garni de chaises longues d’où l’on peut goûter pleinement l’esprit du lieu au pied de la montagne, et des fauteuils suspendus, des « toi et moi », une petite bambouseraie…
En ce mois d’avril, les iris, les strelitzias, les églantiers fleurissent déjà, mais c’est surtout la diversité des décors, le site et la fantaisie bon enfant qui m’ont charmée.