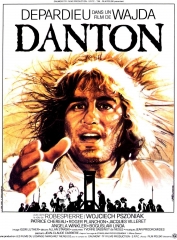D’abord j’ai aimé le film de Jane Campion, Portrait de femme (1996, avec Nicole Kidman et John Malkovich), dont je ne manque jamais les rediffusions télévisées : une adaptation magnifique du chef-d’œuvre de Henry James, The Portrait of a Lady (1881). C’est en lisant le billet de Christian Wéry sur Mme Osmond (2017) de John Banville, qui a prolongé l’histoire d’Isabel Archer, que j’ai eu envie d’enfin lire Un portrait de femme cet été (dans la traduction de Philippe Neel).
Portrait of a Lady de Jane Campion : Nicole Kidman dans le rôle d'Isabel Archer (AlloCiné)
« Il y a, dans la vie, et sous certaines conditions, peu de moments plus aimables que l’heure consacrée à la cérémonie connue sous le nom de goûter. Que l’on participe ou non au repas, dont certains s’abstiennent toujours, il y a telles circonstances qui rendent le moment exquis en soi. Et celles que j’envisage au début de ce modeste récit formaient un cadre admirable pour un passe-temps innocent. Les éléments du petit festin étaient disposés sur la pelouse d’une vieille maison de campagne anglaise, à l’heure que l’on pourrait appeler le cœur véritable d’un magnifique après-midi d’été. » (Incipit)
A Gardencourt, un « vieux gentleman », Mr Touchett, « venu d’Amérique trente ans auparavant », prend le thé en compagnie de Ralph, son fils, l’air intelligent et maladif à la fois, et de Lord Warburton, trente-cinq ans, au « visage remarquablement beau, coloré, clair et franc » qui contraste avec celui des « deux canards boiteux ». La conversation va bon train.
Au début des années 1870, Lord Warburton est encore célibataire, faute d’avoir rencontré une femme « intéressante » – « Trouvez-en une, épousez-la, et votre vie en deviendra bien plus intéressante » lui dit le vieillard, bien que son propre mariage n’ait pas été des plus heureux. Mais il lui déconseille de s’éprendre de la nièce de sa femme, une jeune Américaine que Mrs Touchett (elle a passé l’hiver à Albany) amène en Angleterre. Isabel Archer fait alors son apparition, sans sa tante montée tout droit à sa chambre, comme à son habitude, sans saluer sa famille.
Arriveront ensuite Henrietta Stackpole, une amie d’Isabel ; Caspar Goodwood, un prétendant américain qu’Isabel a repoussé ; Mme Merle, une amie de Mrs Touchett qui deviendra bientôt celle de sa nièce. Quand le riche et charmant Lord Warburton, amoureux à son tour, demande Isabel en mariage, la jeune femme l’éconduit : elle n’est pas sûre du tout de vouloir se marier, elle tient à sa liberté et veut d’abord découvrir le monde. Sa tante va l’emmener à Londres puis lui faire visiter l’Europe.
Ralph et son père sont tous les deux enchantés d’Isabel, belle et spirituelle, spontanée. Quand Mr Touchett, malade, lui parle de son héritage, Ralph, secrètement amoureux de sa cousine mais miné par la tuberculose, lui suggère de léguer la moitié de sa propre part à Isabel qui n’a pas de fortune, pour « donner un peu de vent à ses voiles » – sans mentionner à qui elle le doit. Son père y consent. Quand il meurt, la jeune femme accède à une aisance financière qui lui donne un statut enviable dans le monde.
Six mois plus tard, au début du mois de mai, Mme Merle retrouve à Florence Gilbert Osmond, un grand ami, qui a une fille, Pansy. Lettré, cultivé, philosophe, il a un goût parfait en art mais ne possède pas grand-chose. Mme Merle veut lui faire rencontrer la jeune Américaine « très intelligente, très aimable, et pourvue d’une belle fortune ». Sans ambiguïté, elle déclare à Osmond : « Je sais seulement ce que je veux en tirer. »
Ralph séjourne aussi en Italie, pour sa santé et pour Isabel. Curieux de voir ce que sa cousine va devenir, il est devenu son grand confident. Elle aime discuter de tout avec lui. Quand elle lui demande son avis sur Mr Osmond, sa réponse est sage : « Ne vous arrêtez jamais à ce qu’une personne vous dit d’une autre. Jugez les êtres et les choses par vous-même. » En revanche, il ne cache pas sa méfiance pour Mme Merle qui « ne connaît que les gens du meilleur ton ». Elle est « trop tout » d’après lui, mais Isabel prend sa défense.
Nous n’en sommes pas encore à la moitié du roman, qui compte près de mille pages. Comme Ralph, tout en goûtant les charmes du tour en Italie, nous nous demandons comment Isabel va se comporter en présence de Mr Osmond, comment elle va réagir quand ses autres amoureux vont réapparaître sur son chemin. Comme lui, nous souffrirons de la voir user de sa liberté pour faire un choix malheureux, sans s’en rendre compte.
« Tous les romans de James sont des allégories de la déception », écrit Mona Ozouf dans « L’été avec Henry James » (La Cause des livres). Ce qui fascine, en lisant Un portrait de femme, c’est l’art avec lequel James dépeint les situations, dit les dessus et les dessous des conversations, en explorant la psychologie des personnages à travers leurs perceptions, leurs réactions. Du grand art.