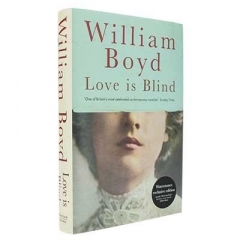Aurais-je emprunté ce roman si j’avais lu plus attentivement la quatrième de couverture ? Imagine que je sois parti d’Adam Haslett (traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Christophe Mercier) raconte l’histoire d’une famille où l’on s’aime, mais où rôde l’anxiété. Depuis Face aux ténèbres de William Styron, c’est sans doute le texte le plus terrible que j’aie lu sur la dépression.

Les cinq membres d’une famille racontent des séquences de leur histoire. Alec, en premier, le plus jeune, sorti du chalet dans le Maine où il séjourne avec son frère, si bouleversé qu’il n’arrive pas à téléphoner à ses proches – « Dès que je parlerais, ça deviendrait réel ». Le marchand de homards qui le voit lui demande s’il a besoin d’aide. « Il est arrivé quelque chose, ai-je dit, à voix haute pour la première fois. C’est mon frère. » Michael, son frère aîné, a laissé sur la boîte vocale un dernier message, absurde et sincère comme il aime en écrire, disant qu’il a vraiment tout essayé et aimé sa famille du plus profond de son cœur.
Flash-back. C’est par Margaret, la mère, qu’on découvre l’histoire de cette famille, installée dans le Maine depuis que John, le père, y a été envoyé pour son travail. Ses tenues impeccables, son sérieux, ses manières l’avaient séduite en Angleterre et, malgré un séjour de John à l’hôpital où elle avait retrouvé son fiancé dans un état méconnaissable, le visage inexpressif, fatigué, à son retour de New York, elle l’avait épousé. Quinze ans avaient passé, ils avaient trois enfants : Michael, Celia et Alec.
Celia se rappelle une sortie en mer avec son père et son petit frère. En revenant vers l’île, John avait coupé le moteur et s’était allongé dans le fond du bateau en fermant les yeux : « Imaginez que je sois parti, imaginez que vous êtes seuls tous les deux. Qu’est-ce que vous faites ? » Un test ? Un jeu ? Celia avait tout de suite pris une rame, mais Alec, trop petit pour tenir l’autre, l’avait laissé partir dans l’océan. Seule, Celia n’y était pas arrivée, Alec pleurait – « le jeu était presque terminé. »
La tension entre leurs parents, les enfants la ressentent tous les trois. Ils savent à quel point leur mère est exaspérée par l’attentisme de leur père au sujet d’un retour en Europe, qu’elle voudrait leur faire découvrir. John, lui, s’en fait surtout pour Michael, malheureux à l’école, inquiet de tout, parti étudier à Londres et qui s’éloigne à présent « dans des mondes parallèles ». Le père a l’impression de leur voler leur vie à tous. « Ce que j’essaie de faire est impossible. Leur dire adieu sans les prévenir que je m’en vais. »
C’est après le suicide de John (à la fin de la première partie) qu’on va en apprendre davantage sur le monde intérieur de Michael, à travers ses réponses à un questionnaire médical sur sa santé mentale. Les goûts musicaux et les tenues vestimentaires comptent énormément à ses yeux, il sait quoi porter pour être à la hauteur et entrer dans les meilleures boîtes de nuit où la musique répond à son besoin de se tenir « au cœur de l’ouragan ». Refusé ailleurs à cause de ses piètres résultats scolaires au lycée, il est finalement admis à l’université de Boston. Là, « à l’aube de la techno », il obtient de tenir une plage horaire de deux à quatre heures du matin et d’y diffuser de la musique électronique, avec de plus en plus de succès.
La musique est le ressort principal de sa vie et lui vaut ses plus belles rencontres. Mais ses tentatives de « vraie liaison » ne résistent pas au fil du temps. L’injustice sociale et la mémoire de l’esclavage le hantent. Michael s’est mis à voir le Dr Gregory qui soignait son père et « dégainait facilement l’ordonnance ». La première dose de Klonopin lui a fait un effet inoubliable, tout son corps s’est mis à sourire – « j’ai rarement été plus heureux ». L’inquiétude l’a quitté, un long « sursis ». Puis d’autres médicaments ont suivi, dont il raconte les effets dans des pages sidérantes.
On découvrira la vie de Celia, thérapeute sociale, avec Paul, auteur de scénarios ; il travaille à la maison et s’occupe de l’intendance. On suivra la vie d’Alec, gay, journaliste en matière financière, et sa vie amoureuse. Michael écrit un compte rendu désopilant de la thérapie familiale qu’ils ont fini par tenter tous ensemble, préoccupés par leur mère qui manque d’argent pour conserver la maison familiale, ce qui leur donne à tous un sentiment de culpabilité, amplifié par les souffrances et les addictions de leur frère aîné.
Adam Haslett avait déjà traité de la maladie mentale dans un recueil de nouvelles remarqué, Vous n’êtes pas seul ici (You Are Not A Stranger Here), et des problèmes sociaux et financiers dans un roman, L’intrusion (Union Atlantic). Imagine que je sois parti (Imagine me gone) est inspiré par sa propre vie familiale, son père s’est suicidé quand il avait quatorze ans. Un roman bouleversant, écrit sur un ton original, que je suis contente de ne pas avoir laissé de côté.
 « De quoi a-t-on peur quand on a peur de tout ? Du temps qui passe et du temps qui ne passe pas. De la mort et de la vie. Je pourrais dire que mes poumons n’étaient jamais assez remplis d’air, quel que soit le nombre de bouffées que j’inhalais. Ou que mes pensées étaient trop rapides pour aboutir, tronquées par des accès de vigilance. Mais même dire ça serait encourager le mensonge selon lequel on peut décrire la terreur, alors que tous ceux qui l’ont connue savent qu’elle n’a pas de composants, mais se trouve partout en vous en même temps, jusqu’à ce qu’on n’arrive plus à se reconnaître autrement que par les tensions qui enchaînent une minute à la suivante. Et pourtant je continue de mentir en la décrivant, car comment pourrais-je, sinon, éviter cette seconde, et celle qui va suivre ? Et c’est en ça que consiste cet état : le besoin incessant d’échapper à un instant qui n’a jamais de fin. »
« De quoi a-t-on peur quand on a peur de tout ? Du temps qui passe et du temps qui ne passe pas. De la mort et de la vie. Je pourrais dire que mes poumons n’étaient jamais assez remplis d’air, quel que soit le nombre de bouffées que j’inhalais. Ou que mes pensées étaient trop rapides pour aboutir, tronquées par des accès de vigilance. Mais même dire ça serait encourager le mensonge selon lequel on peut décrire la terreur, alors que tous ceux qui l’ont connue savent qu’elle n’a pas de composants, mais se trouve partout en vous en même temps, jusqu’à ce qu’on n’arrive plus à se reconnaître autrement que par les tensions qui enchaînent une minute à la suivante. Et pourtant je continue de mentir en la décrivant, car comment pourrais-je, sinon, éviter cette seconde, et celle qui va suivre ? Et c’est en ça que consiste cet état : le besoin incessant d’échapper à un instant qui n’a jamais de fin. »