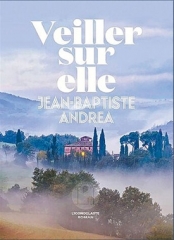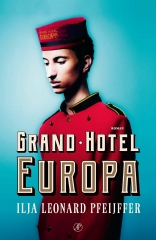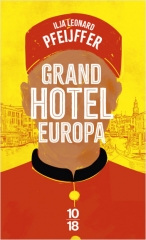Gabriella Zalapì a intitulé son roman Ilaria d’après le prénom de sa narratrice, une fillette de huit ans, et ajouté « ou la conquête de la désobéissance ». Ce récit d’enfant à la première personne rejoint un souvenir de lecture marquant, avec une héroïne un peu plus âgée, Ellen Foster de Kaye Gibbons. Il a reçu le prix Femina des Lycéens en 2024.

© Alice Frey, Fillette et chien
En mai 1980, Ilaria attend sa sœur Ana pour rentrer de l’école à la maison ; elle aime se suspendre à la barre en position « cochon pendu », elle admire Nadia Comaneci (La petite communiste qui ne souriait jamais). Mais « la voix de Papa » la surprend : « Le programme a changé. » Une fois par mois, depuis la séparation de ses parents et l’installation de son père à Turin, ils se retrouvent à quatre au restaurant Chez Léon. Sa mère et sa sœur les rejoindront sur place.
Mais au lieu d’y aller, voilà que son père arrête la voiture près d’une cabine téléphonique où elle l’entend parler fort. Puis il lui annonce que sa mère « a changé d’idée » et qu’ils vont passer le week-end ensemble, Ilaria et lui. Tunnel du Mont-Blanc, passage de la frontière : il l’emmène à Turin. En découvrant sa chambre, elle reconnaît des draps aux motifs de tournesols qu’ils avaient à Florence – « Deux ans et pourtant j’ai l’impression que cela fait des siècles que Maman, Ana et moi avons emménagé en Suisse. » Elles habitent Genève.
A Turin, dans un magasin de jouets, il lui laisse se choisir un nounours – il s’appellera « Birillo » – et une poupée pour sa sœur. « A huit ans, je suis une enfant taciturne, docile, plutôt maigrichonne. » La fillette ne se plaint pas quand son père la laisse seule à l’appartement, il a toujours des coups de fil à donner au bar, il n’a pas d’emploi.
Puis ils reprennent la route, il continue à s’arrêter aux cabines téléphoniques ou bien à la poste, d’où il envoie des télégrammes à la maman d’Ilaria, rassurants (« la petite va bien ») et plaintifs (« je désire entendre ta voix »). Il voudrait que leur vie recommence comme avant. Dans les bars, il lui faut un whisky (son « médicament ») et des cigarettes. La fillette ne sait pas où ils vont. Dans les petits hôtels où ils passent la nuit, elle déteste les soirées au comptoir où son père a toujours des tas d’histoires à raconter et les chambres impersonnelles et froides.
Très vite elle remarque ses mensonges, les professions qu’il s’invente. Il veille à sa propre élégance et, ne sachant quoi lui acheter, la confie à une vendeuse dans un grand magasin : « Ilaria a besoin de tout, y compris d’un costume de bain. » Quand ils entendent à la radio l’annonce d’un attentat en gare de Bologne, son père décide d’éviter les grands axes, les barrages de police – « Ta mère nous cherche. […] Tu ne veux pas que j’aille en prison ? » Il l’emmène au bord de la mer Adriatique – « dix jours de vacances ».
« On rentre quand ? » Son père esquive la question, critique la mère qui a changé, qui s’est enfuie en Suisse avec ses filles sans un mot. Ilaria se souvient de leurs disputes, des cris, et ose lui répondre : « A moi, Maman me manque beaucoup. » Arrêts dans les Autogrills, puis à nouveau sur la route. « Plus nous nous éloignons de Genève, plus j’ai le sentiment d’avancer les yeux fermés dans un couloir. »
Dans un bar de Trieste, un homme a montré sa montre au père, il avait oublié la sienne dans un train. Aux objets trouvés de la gare, il a eu l’embarras du choix, sans difficulté. Le père n’hésite pas à faire de même, donnant un faux nom ; il s’arrête dans les gares, embobine les employés, choisit des objets perdus qu’il pourra revendre facilement. Ils dorment désormais dans des hôtels trois étoiles, Ilaria commence une collection de savonnettes.
Plus le temps passe, plus la fillette plonge dans ses souvenirs avec sa mère, avec sa sœur. Elle aurait tant voulu passer Noël avec elles ! Mais son père n’a aucune intention de la ramener à Genève et la confie tantôt à l’un, tantôt à l’autre, la met dans un pensionnat, puis la conduit chez sa grand-mère, en Sicile. Un jour Ilaria, bien qu’elle craigne les colères de « Papa », osera lui tenir tête, un jour cette fuite prendra fin.
Le roman de Gabriella Zalapì réussit à tenir le point de vue d’Ilaria tout du long, dans une succession de fragments et de blancs : « Souvent, j’utilise des blancs, et c'est vraiment une façon de laisser une place physique à une respiration, à l'autre, au silence. » (Geneviève Simon, LLB) La fillette observe, entend, souffre, apprend : « l’enfance, prise dans l’impuissance face aux adultes et à leurs passions délirantes, possède pourtant une puissance de vie incommensurable » (Gabrielle Napoli, EaN).