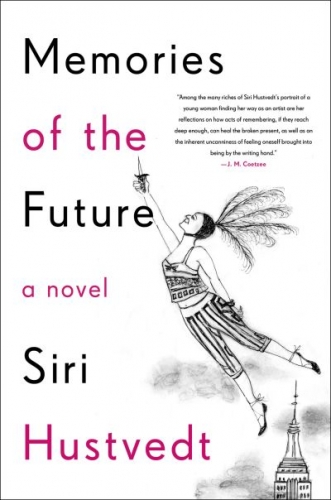Pour Minuit dans la ville des songes, René Frégni a reçu en 2022 le Prix des lecteurs du Var. C’est le formidable récit de l’itinéraire d’un petit voyou de Marseille que rien ne prédestinait à devenir un grand lecteur et un écrivain. Mercredi dernier, vous l’avez peut-être entendu lire un extrait de Marseille de Jean-Claude Izzo sur le plateau de La Grande Librairie installé au Mucem (une belle émission).

A droite, René Frégni lisant à voix haute à LGL, France 5, 24/1/2024 (vidéo France.tv)
Sa mère l’avait ému en lui lisant « la solitude et les souffrances d’Edmond Dantès, de Jean Valjean et du petit Rémi de Sans famille », mais l’enfant fuyait l’école, volait, mentait. Pour rêver, il y avait aussi l’histoire du bohémien de la crèche de Noël que lui racontait son père. Ce temps est loin, mais il lui reste, à la septantaine, les sentiers et la lumière du Midi, le bonheur de lire et d’écrire malgré « la sensation de n’avoir plus rien à dire ».
« J’ai passé toutes ces années à ramasser des mots partout, au bord des routes, dans les collines, sur les talus du printemps, le banc des gares, le quai des ports, dans la rumeur sous-marine des prisons, les petits hôtels dans lesquels je dors parfois, les villes que je traverse, les mots que j’aimerais prononcer lorsque je regarde, ébloui, certains visages de femmes, ceux que soulèvent en moi l’injustice et l’humiliation, les mots qui font bouger mon sommeil, la nuit, et qui sont sans doute la clé de tous les mystères. »
« Acoquiné » avec de jeunes vauriens de Marseille, il a partagé avec eux cinq ans de vols et de transgressions en essayant de ne pas inquiéter sa mère. Puis vint le temps des boîtes de nuit, des filles et du be-bop, avant de s’aventurer dans le quartier chaud. Après son renvoi du lycée, sa mère fit une dernière tentative en l’envoyant au Cours Florian, un établissement privé. Peine perdue.
« Sans culture, pas d’hommes libres ! » avait tranché sa grand-mère communiste. C’est seulement quand arrive la grande enveloppe des cours par correspondance pour lesquels il doit lire La Cousine Bette que sa mère comprend pourquoi il fuyait « tout ce qui pouvait ressembler à un livre ». L’oculiste constate sa faible acuité visuelle (hypermétropie sévère) et lui fait accepter, enfin, de porter des lunettes pour lire. Il ne lit pas le roman de Balzac jusqu’au bout, mais dévore une biographie de Lucky Luciano, « le plus célèbre gangster d’Amérique ».
Il travaille par-ci par-là pour aider sa famille, rate le concours de la Poste, récolte une bonne note en rédaction pour entrer à la SNCF, mais est recalé à cause de sa mauvaise vue. Il décide alors de partir en Angleterre, fait la plonge, le serveur. Le soleil lui manque : va pour l’Andalousie (en stop). Il y reste jusqu’à ce qu’une lettre de sa mère lui annonce qu’il doit rentrer, incorporé au 150e régiment d’infanterie à Verdun.
A dix-neuf ans, il s’y présente avec un mois de retard et se retrouve au cachot. « En quelques secondes, j’étais passé de l’insouciance au Moyen Age. » Lors de sa première promenade, il reconnaît quelqu’un qui le fixe, Ange-Marie Santucci. A Marseille, ils faisaient les quatre cents coups ensemble, puis se sont perdus de vue. L’autre est là depuis trois ans, si rétif au règlement qu’il est le plus souvent au cachot. Il conseille à René d’en faire autant : « Ne rampe pas ! »
En prison, Ange-Marie lit un livre par jour : l’aumônier, « un type bien », lui procure des livres, il s’occupera de faire rendre ses lunettes à René. Il lui apporte Colline de Giono, « un Provençal, comme vous », puis un dictionnaire de poche, un carnet rouge, un stylo. « Bientôt, il n’y eut plus de murs autour de moi, j’étais sur ces chemins, dans ces hameaux abandonnés, je sentais la chaleur sur mes épaules et la lente infiltration de l’inquiétude… Jamais je n’avais ressenti une chose pareille, en lisant. » Sa « seconde vie » commence.
Ange-Marie, « cette borne obscure du destin », guide ses lectures, prêche la révolution, le persuade de se préparer à faire la guérilla en Bolivie. Ensemble, ils s’évadent de la caserne, volent une voiture, prennent la route de Forcalquier pour retrouver le soleil – « cinq jours hors du temps ». Puis ils rentrent à Verdun, à temps pour échapper au statut de déserteur. On les sépare. René poursuit son éducation littéraire : Maupassant, Rousseau, Alain… On lui donne un boulot de plongeur au mess, ce qui lui laisse du temps pour lire. Jusqu’à ce qu’un nouvel élan de rébellion le renvoie au cachot. Une fois de plus, il escalade le mur et s’enfuit en Corse, à Bastia, la ville de son grand-père.
Les rencontres jouent un rôle énorme dans la vie de René Frégni qui se débrouille pour subsister : lecture, travail dans une boîte de nuit, et finalement, grâce au patron, une petite maison sur la colline, un jardin en terrasse : « La beauté gifla mon visage. Pure, simple, brutale ! » A la poste, les lettres de sa mère sont de plus en plus inquiètes : il est recherché pour désertion. Où se cacher, s’enfuir ? René Frégni mettra du temps à se sortir de là, finalement grâce à son excellent travail d’infirmier dans un asile d’aliénés, à qui il fait entre autres la lecture à voix haute.
Minuit dans la ville des songes est un plaidoyer pour la lecture qui émancipe, libère, et finalement le mène à l’écriture : quand, à 40 ans, on publie son premier roman, sa mère en est bouleversée, ravie. Une nouvelle vie commence alors pour René Frégni, écrivain.
 « Le passé peut-il servir à se cacher du présent ? Ce livre que vous lisez maintenant est-il ma quête d’une destination nommée Alors ? Dites-moi où finit la mémoire et où commence l’invention ? Dites-moi pourquoi j’ai besoin de vous pour m’accompagner dans mon voyage, pour être mon autre, tantôt ravi, tantôt grincheux, ma moitié pour la durée du livre. Qu’est-ce qui fait que je peux sentir votre foulée à mes côtés pendant que j’écris ? Qu’est-ce qui fait que je vous entends presque siffloter pendant que nous marchons ? Je ne sais. Je ne sais. Je ne sais. Mais si : Mon amour des inconnus.
« Le passé peut-il servir à se cacher du présent ? Ce livre que vous lisez maintenant est-il ma quête d’une destination nommée Alors ? Dites-moi où finit la mémoire et où commence l’invention ? Dites-moi pourquoi j’ai besoin de vous pour m’accompagner dans mon voyage, pour être mon autre, tantôt ravi, tantôt grincheux, ma moitié pour la durée du livre. Qu’est-ce qui fait que je peux sentir votre foulée à mes côtés pendant que j’écris ? Qu’est-ce qui fait que je vous entends presque siffloter pendant que nous marchons ? Je ne sais. Je ne sais. Je ne sais. Mais si : Mon amour des inconnus.