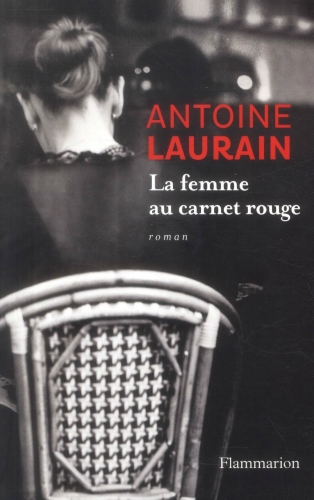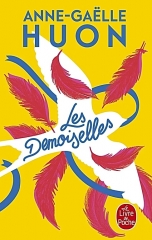La femme au carnet rouge (2014) d’Antoine Laurain est, comme l’indique la quatrième de couverture, « une délicieuse comédie romantique ». L’histoire est très simple : à Paris, une femme se fait agresser juste devant son immeuble, aux petites heures du matin, on lui vole son sac à main ; le lendemain, un homme le trouve sur une poubelle, vidé de ses objets de valeur.
Il n’en faut pas plus au romancier pour mettre en place une intrigue qui va bouleverser la vie des deux personnages. Laure, qui a reçu un coup à la tête, qui n’a plus ses clés, ne veut déranger personne : elle passe la nuit à l’hôtel en face de chez elle. Quand Laurent Letellier, libraire, va vers son café habituel et remarque le sac en cuir mauve abandonné, il décide de le porter au commissariat où on lui demande de patienter – une heure d’attente au moins. Il lui faut ouvrir la librairie, il remet ça au lendemain.
A l’hôtel, on s’est inquiété de ne pas revoir l’occupante de la chambre 52 qui n’a pas été libérée pour midi comme prévu. En y entrant avec son passe, le concierge découvre la jeune femme inconsciente, du sang sur la serviette éponge sous sa tête. Il appelle les secours – Laure est dans le coma.
Laurent habite juste au-dessus de sa librairie, Le Cahier rouge, c’est pratique. Il sait qu’un homme « ne fouille pas dans le sac d’une femme », mais espère y trouver un indice sur sa propriétaire. « En fait, il me faudrait une amie comme moi, je suis sûre que je serais ma meilleure amie. / Rêve de cette nuit : j’ai rêvé que Belphégor était un homme, cela me surprenait beaucoup et en même temps pas tant que ça, je savais que c’était lui, il était plutôt bel homme. » Voilà ce qu’il lit dans un carnet Moleskine rouge rempli d’une écriture « élégante et souple ».
Un flacon de parfum, un petit agenda sans nom ni adresse ou numéro de téléphone, une trousse de maquillage, des objets divers et variés, des clés… L’inventaire du sac mauve ne livre aucune identité mais révèle une personnalité – pour beaucoup de femmes, le sac à main renferme un petit monde personnel.
Le libraire y trouve Accident nocturne (!) de Modiano, qui contient une dédicace – « L’écriture dansait devant ses yeux. Modiano, le plus insaisissable des écrivains français. Qui ne participait plus à aucune dédicace depuis des lustres et n’accordait que de très rares interviews. » Et voici qu’il lui livrait un prénom ! « Pour Laure, souvenir de notre rencontre sous la pluie. Patrick Modiano »
Laurent n’a pas envie de partager ce mystère avec son amie Dominique très jalouse, une journaliste économique, mais quand celle-ci arrive chez lui, elle déclare immédiatement qu’une femme y est passée avant elle. Elle a senti des effluves d’Habanita – « il avait eu la mauvaise idée d’appuyer sur le pulvérisateur ». Il dément. Quand elle découvrira une épingle à cheveux sur le tapis, le lendemain matin, il tentera de lui expliquer l’affaire, mais elle reste sceptique et part fâchée.
Antoine Laurain distille joliment les ingrédients de son roman, à commencer par l’univers d’une librairie (qui vaut bien celui d’une papeterie japonaise). Ajoutez-y un chat (Belphégor, le chat de Laure) et même deux (avec Poutine, le chat de Chloé, la fille du libraire), un atelier d’art, un déchiffreur de hiéroglyphes, des références et des clins d’œil littéraires, le plaisir de marcher dans Paris et de s’y asseoir en terrasse, des courriels et des messages, des repas entre amis, une rupture… Et Modiano, à qui le roman rend hommage tout au long de l’enquête du libraire dans son quartier.
Le carnet où Laure note ses réflexions joue un rôle clé. Malgré sa délicatesse habituelle et ses principes, Laurent y cherche des indices et accède du même coup à ce moi intime que très peu de ceux qui tiennent un journal ou prennent ce genre de notes livrent à d’autres, même proches. La femme au carnet rouge : Antoine Laurain a bien choisi le titre de cette histoire charmante, où un homme se laisse séduire d’abord par les mots d’une femme.