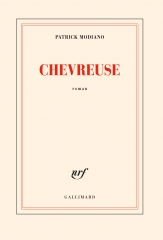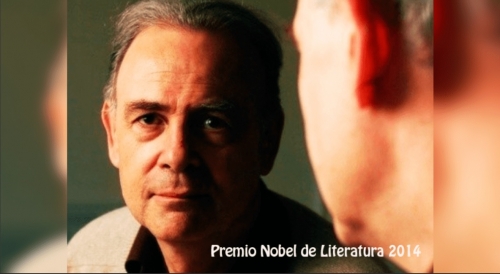Entre ciel et terre de Jón Kalman Stefánsson (Himnariki og Helviti - littéralement Le paradis et l’enfer, 2007, traduit de l’islandais par Eric Boury, 2010) suscite un grand enthousiasme et j’étais impatiente de découvrir ce premier roman d’une trilogie, suivi par La Tristesse des anges et Le Cœur des hommes – des titres qui donnent le ton. Ici la première partie intitulée « Nous sommes presque uniquement constitués de ténèbres » nous invite dans un univers quasi en noir et blanc.
Qui est ce « nous » ? Qui raconte comment vivaient il y a plus de cent ans ces gens devenus des noms sur des pierres tombales ? Il s’agit « d’arracher des événements passés et des vies éteintes au trou noir de l’oubli ». Début du premier chapitre : « C’était en ces années où, probablement, nous étions encore vivants. »
Dans le Village de pêcheurs, « notre commencement et notre fin, le centre de ce monde », des maisons blotties sur une langue de terre dans une cuvette surplombée de montagnes, deux personnages sont en route et s’éloignent : Bárður et le gamin. Ils vont rejoindre les baraquements des pêcheurs par « un étroit sentier qui ondule comme un serpent gelé dans la neige », un chemin périlleux « tout au bord des falaises ».
« D’un côté, la mer, de l’autre, des montagnes vertigineuses comme le ciel : voilà toute notre histoire. » La mer est magnifique, sauf quand elle élève ses vagues si haut qu’elle noie les marins « comme de misérables chiots ». Une fois « l’Infranchissable » franchi, sans que la corde ne se rompe, les deux amis peuvent regarder la mer, lever les yeux vers le ciel d’où tombe une obscurité de moins en moins bleue. Après deux heures de marche, le solide Bárður aux yeux sombres n’a pas l’air fatigué, observe le gamin qui souffle « comme un vieux chien ».
Il y a quinze jours qu’ils ne sont plus sortis en mer à cause de la tempête, de la pluie et de la neige. Le monde retrouve sa forme, on voit la ligne d’horizon. La pêche à la morue va pouvoir reprendre, par barques de six rameurs. Bárður et le gamin aiment être à deux, à l’écart des autres – « il y a tant de choses à dire qui ne sont destinées qu’à eux, à propos de la poésie, des rêves et de ce qui nous tient éveillés ».
Quand ils ont rejoint les baraquements, sur le lit où ils dormiront tête bêche, Bárður vide son sac : trois journaux, des vivres, plusieurs livres dont l’un lui a été prêté par un vieux capitaine devenu aveugle, Kolbeinn – Le paradis perdu de Milton, dans la traduction d’un pasteur islandais. « Nous passons notre existence à la recherche d’une solution, d’une chose qui nous console, nous apporte le bonheur et éloigne de nous tous les maux. »
Chaque équipage a sa cantinière, Andrea prend soin d’eux. Avant de prendre la mer, le gamin boit plusieurs gorgées d’élixir de Chine censé protéger du mal de mer ; Bárður rouvre Le Paradis perdu pour lire quelques vers qu’il a l’intention de se rappeler. La lune a « ses voiles toutes gonflées de lumière blanche » : la mère du gamin lui a souvent parlé de la lune dans ses lettres. Ses parents avaient soif de lire, d’apprendre, puis son père est mort en mer, les enfants ont été séparés ; la mère du gamin lui a beaucoup écrit avant de mourir de la grippe.
Entre ciel et terre campe un monde ancien et lointain, celui de pêcheurs islandais dont la survie dépend de la mer et qui ne savent pas nager. Bárður estime que son ami et lui qui aiment les mots, les poèmes, ne sont « pas nés pour être pêcheurs ». Il envie le rédacteur en chef du journal et trouve « merveilleux d’avoir pour emploi d’écrire ». Après quatre heures à ramer vient le moment de jeter les lignes à la mer et d’attendre dans le froid de plus en plus intense que le poisson morde. Puis c’est le drame : Bárður a oublié de prendre sa vareuse et personne ne pourra lui venir en aide. Le gamin, désespéré, se répète le vers de Milton écrit par son ami à celle qu’il aime : « Nulle chose ne m’est plaisir, en dehors de toi »,
« L’enfer, c’est de ne pas savoir si nous sommes vivants ou morts ». Le gamin qui n’a pu sauver son ami n’a plus qu’une idée en tête : s’éloigner de la mer, aller rendre le précieux Paradis perdu au capitaine aveugle qui possède près de quatre cents livres dans sa bibliothèque, et mourir à son tour. Entre ciel et terre suit l’errance d’un garçon qui a perdu son ami et le goût de vivre.
En même temps, Jón Kalman Stefánsson continue à décrire comment ces hommes et ces femmes vivent entre mer et montagne, en particulier l’entourage du capitaine Kolbeinn chez qui le gamin a fini par échouer, happé par l’incertitude, « un oiseau qui tournoie ». J’ai mis du temps à entrer dans cet univers sombre, à en percevoir la lumière. La structure est parfois déroutante, mais les images étonnantes, poétiques. Les morts y accompagnent les vivants. Les mots, « poissons immémoriaux », eux, ne meurent pas.