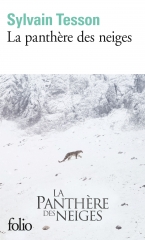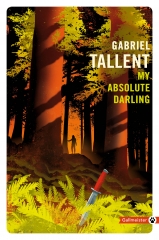En contraste total avec Le lys dans la vallée, My Absolute Darling de Gabriel Tallent est un roman choc (2018, traduit de l’américain par Laura Derajinski, 2019). Amour incestueux contre amour platonique, marginalité contre convenances sociales, violence contre douceur, vie sauvage contre campagne civilisée... On pourrait allonger la liste des contraires et pourtant, il y a chez Tallent comme chez Balzac une volonté de dire vrai, de montrer et de faire ressentir les choses telles qu’elles sont.

Rencontre avec Gabriel Tallent dans le parc national de Joshua Tree (Californie)
François Busnel a rencontré ce jeune romancier américain en Californie, je vous recommande la vidéo de cet entretien (ci-dessus) pour faire connaissance avec Gabriel Tallent dont il a préfacé le roman : « Il y a des romans comme ça. Atroces et magnifiques. Dangereux. Dévastateurs. Qui vous nouent l’estomac dès les premières pages et vous poursuivent durant des années. Turtle, alias Croquette, alias My Absolute Darling, a quatorze ans et manie les armes à feu en virtuose de la gâchette. Sous sa carapace, la tortue est une boule de nerfs. Lorsque son père abuse d’elle, elle ne dit rien, ne se révolte pas. Elle endure. »
Julia Alveston, de son véritable nom, n’est pas à l’aise à l’école, en particulier avec les exercices de vocabulaire. Martin, son père, tient à l’accompagner tous les matins jusqu’à l’arrêt du bus scolaire, même si elle lui rappelle chaque fois qu’il n’est pas « obligé ». Un signe parmi d’autres du contrôle absolu qu’il veut garder sur elle et, indice de son mépris des femmes, occasion de raillerie rituelle envers la conductrice du bus, « cette gouine » en salopette et chemise de bûcheron.
Anna, la jeune prof de Turtle, lui propose son aide, mais l’adolescente répond que son « papa » l’aide à réviser et la repousse. « Misogynie, repli sur soi et méfiance. Voilà trois gros signaux d’alerte », explique Anna chez le proviseur, elle voudrait que Turtle voie un psy, soupçonne la maltraitance. Convoqué, Martin rejette toutes leurs propositions et leur oppose un discours de survivaliste : dans ce monde qui va s’autodétruire, leur inquiétude pour sa fille lui semble inappropriée – Julia, interrogée devant lui, n’a plus qu’à les rassurer et à promettre de faire plus d’efforts.
Aussitôt dans le pick-up, l’insulte fuse : « pauvre petite moule illettrée » ! Martin lit beaucoup de son côté, il tient à ce que sa fille « joue le jeu » à l’école. Même si d’autres enjeux lui paraissent plus graves, il ne faut pas qu’on les sépare : elle est sa raison de vivre – « C’est ma fille, c’est pour elle que j’existe. » Le soir même, il vient la chercher dans sa chambre, elle se laisse faire, elle ne dit rien.
Papy, le père détesté de Martin, vit dans un mobile home avec sa chienne Rosy. Quand Turtle vient le voir, il lui propose une petite partie de cartes et joue tout en observant le fusil de chasse qu’elle a posé sur la table, admiratif de son état de propreté parfait. Turtle l’entretient elle-même, obsessionnellement. Aussi il lui offre son vieux couteau Bowie qu’il porte toujours à la ceinture, dont il ne se sert plus – il sait qu’elle en prendra soin et lui montre comment l’aiguiser.
Martin vient la chercher, fâché de voir son père boire trop devant sa fille, « un vrai fils de pute ». A la maison, il veut qu’elle lui donne le couteau de son grand-père et l’abîme en le lançant contre la porte. Quand il la sent mécontente de voir la lame si bien entretenue depuis des années à présent ébréchée, il veut la réparer avec son affûteuse – « Tu l’as bousillé », proteste Turtle, tandis que son père prétend en avoir fait un couteau « fait pour égorger », qui ouvrira « la chair comme du beurre ». Ce ne sont que les préliminaires d’une scène atroce.
Gabriel Tallent veut « essayer de parler honnêtement » de la douleur, pour montrer à quel point elle est intolérable. J’avoue avoir survolé certaines pages, trop dures à lire. La situation de Turtle est abominable, son silence et sa soumission sont insupportables. Le roman raconte « le combat d’une jeune fille pour préserver son âme » (G. T.). Martin l’éduque pour se défendre dans un monde sauvage, elle doit trouver comment survivre aux abus sexuels, à l’amour-haine d’un père, comment affirmer sa dignité et son innocence.
Elle rencontrera plusieurs personnes bienveillantes qui se soucient de l’arracher à son emprise, mais elle veut s’en sortir seule, par elle-même, et choisir ce qu’elle veut devenir. Sa solitude est si « humaine », dit le romancier, que nous devrions tous éprouver de la compassion pour cette jeune fille qui aime son père comme son meilleur ennemi. Intelligent, érudit, trop « aimant », il n’est pas présenté comme un monstre, et pourtant c’est contre lui qu’elle devra se dresser.
Son grand-père lui a appris qu’il ne suffit pas de nommer, il faut « observer pour comprendre » et tant pis si elle ressemble « à une fille élevée par les loups ». Dans le danger, elle se dira : « Tu vas avoir confiance en ta propre discipline, en ton propre courage, et tu n’y renonceras jamais et tu ne les abandonneras jamais, et tu seras plus forte, inébranlable et impitoyable […] ». My Absolute Darling est « le récit d’une émancipation » (F. B.) sans rien d’autobiographique à part les difficultés scolaires et la relation avec la nature, selon Gabriel Tallent, élevé par deux femmes, qui n’a quasi pas connu son père. Ce premier roman sous haute tension est bouleversant. Il m’a rappelé une autre héroïne inoubliable, aussi dans un premier roman : Ellen Foster (1987) de Kaye Gibbons.