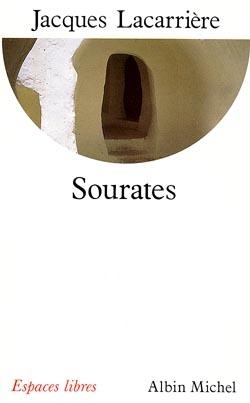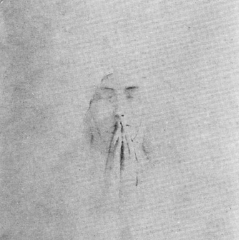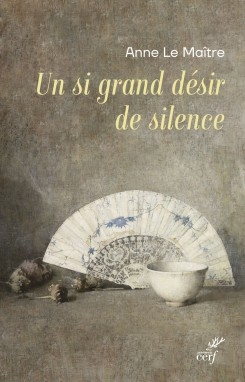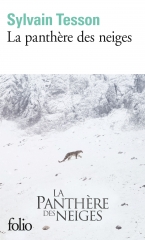Pour éclairer l’esprit dans lequel il a écrit Sourates (1982), Jacques Lacarrière (1925-2005) évoque un « concert de voix », voix « intérieures d’abord, puis voix de la maison, de la colline, de la rue, du village, de la radio, de la télévision, de l’horizon, du ciel ». « Sourate », de l’arabe sura pour désigner un chapitre du Coran, a pris à la longue « le sens – ou la connotation – de : révélations, voix perçues, voix reçues de l’homme-dieu qui est en nous ». Etre à l’écoute de toutes les voix du monde : « Je ne connais pas d’autre voie pour vivre en moi la spiritualité que de l’affronter chaque jour aux aléas du monde. » (Prélude)
Voilà une bonne lecture pour ce temps de Noël : trente sourates, en commençant par La sourate du village. Installé à Sacy, dans une maison « ancrée dans la terre de Bourgogne » où il vit depuis dix ans, Lacarrière décrit ce territoire devenu son « rocher » pour « une vie sédentaire entre deux nomadismes » ou plutôt « une évasion immobile, une halte dans [ses] errances et aussi un voyage dans une durée autre ». On se souvient d’avoir voyagé avec lui en découvrant L’été grec.
Dans La sourate du grenier, la pièce qu’il a aménagée pour écrire et à laquelle il accède par une échelle de meunier, il se souvient de l’île de Patmos où il a habité longtemps une pièce nue, blanchie à la chaux, donnant sur la mer – « Je rêve depuis ce temps d’un tel dépouillement pour l’écriture. » Quelques objets y sont les témoins de ses « ailleurs », d’une pierre cathare à une grande photo de Sylvia prise dans le désert du sud tunisien, comme « un résumé de l’espace extérieur et intérieur de [sa] vie ».
Pays cathare, montagnes yougoslaves, Vallée des Rois, Patmos… Ces objets portent en eux paysages et lumières, rencontres, interrogations. « A quoi donc servirait de parcourir le monde si j’ignore tout de la colline qui jouxte ma maison ? » Des herbes. Des arbres. « Egypte ou Bourgogne, sable ou herbe, on trouve toujours autour de soi de quoi occuper son besoin d’infini. » (La sourate de la colline)
« Oiseleur du Temps. C’est la seule définition que j’oserais donner de l’écrivain » écrit Jacques Lacarrière dans La sourate de l’oiseleur, la plus centrée sur sa pratique. Du sable du désert dans une bouteille à une réflexion sur la vie des villages changée par les télécommunications – « Et chaque habitant devient le contemporain – dans le temps et dans l’espace – de chaque événement important de ce monde », d’une cave où l’on s’enivre de bon vin à la phalène du bouleau qui tournoie autour de sa lampe, ses pages allient toujours des éléments concrets de sa vie à une interrogation sur le sens profond de l’existence humaine.
Dans les derniers chapitres de Sourates consacrés à la figure humaine et au corps – dont un face à face vertigineux avec son visage dans le miroir –, il y a La sourate des mains et aussi cette « sourate du sourire » où Lacarrière dit son éblouissement devant sa préférée des korè de l’Acropole que je vous ai montrée hier, pour illustrer un extrait de La sourate du vide. Et c’est ce qui nous conduit au dernier mot du livre, « silence », un mot qui dit à la fois le vide et le plein.