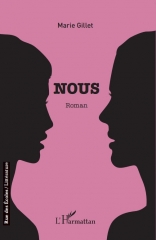Avec Nous, Marie Gillet entre de plain-pied dans le genre romanesque. Ce roman vient d’être publié chez le même éditeur qu’Avec la vieille dame paru l’an dernier. J’ai eu le plaisir de lire en avant-première l’histoire de ces retrouvailles entre deux femmes. Marie, la petite-nièce, a décidé de rendre visite à la « tante Marie du Var », sa dernière parente en vie après de trop nombreuses disparitions dans la famille : « Treize enterrements. Treize ans. »

C’est dans un paysage provençal inondé de soleil après l’orage que commence la première journée du récit et du séjour de la jeune femme chez sa grand-tante. Avant d’arriver, « Marie avait été impressionnée de l’immensité de ce qu’elle voyait, face à elle. Elle avait pourtant l’habitude de regarder l’horizon puisqu’elle habitait au bord de l’océan de l’autre côté du pays, à Ste-Anne-de-la-Mer et que de ses fenêtres elle le voyait aller et venir du matin au soir et du soir au matin. Mais l’impression était toute différente ici. »
Hésitante sur le chemin à prendre pour se rendre à La Rouvraie (la maison, elle le sait, est entourée de chênes rouvres), elle est contente de voir la camionnette du facteur s’arrêter à sa hauteur. Il la renseigne, elle s’étonne de ce qu’il lui dit : « vous lui ressemblez tellement…. Si je ne la connaissais pas depuis si longtemps, je dirais que vous êtes sa fille, ou sa petite-fille, plutôt. »
Marie trouve sa tante dehors avec son chien, occupée à trier des abricots sur une table. Son étreinte chaleureuse lui rappelle un soir d’enfance, quand elle l’avait prise dans ses bras pour lui montrer le spectacle des étoiles filantes. Après s’être bien regardées toutes les deux, émues, Marie du Var a repris sa préparation des fruits tout en parlant avec sa nièce. Un mot la déstabilise soudain : « Nous, ce n’était pas seulement elle préparant de la confiture d’abricots et Marie assise à califourchon sur le banc. Ce qu’il voulait, aussi, c’était lui faire dire ce qu’elle ne voulait pas dire, ne voulait plus dire. Dire nous tous […]. Nous, c’était eux. Pas elle. »
Les monologues intérieurs de la plus âgée des deux femmes alternent avec les dialogues. Profondeur, surface. La jeune Marie se rebiffe quand sa tante lui parle de visites probables pour la rencontrer : « C’est faux, ce que tu dis, tout ne se sait pas si bien que ça. La preuve, le facteur ne savait pas que tu avais de la famille ! » – « Cette voix. Ce ton. Ces yeux. Depuis combien de temps ne lui avait-on pas parlé sur ce ton ? Le ton du conflit qui s’annonce. Le ton du n’oublie pas à qui tu t’adresses. »
« Elle n’a plus que moi ! C’est ce que Marie avait dit la veille à l’amie qui était partie de la Rouvraie après un séjour de quelques semaines. » Après avoir montré à sa petite-nièce de vingt-trois ans sa chambre à l’étage – la sienne avant son opération –, elle remarque son étonnement en découvrant le séjour dont elle n’avait pas de souvenir. La jeune femme ne voyait sa tante qu’aux enterrements ; elle ne l’imaginait pas dans ce décor simple et accueillant, un peu bohème.
« On pourrait faire comme ça : je viens un peu de temps chez toi, tu viens un peu de temps chez moi… On est de la même famille. Il n’y a plus que nous deux alors il faut qu’on se serre les coudes, hein ? » Marie est prête à pallier l’équipement minimaliste de la maison à l’aide de tout ce dont elle a hérité et qui se trouve au garde-meubles. « Tu sais, la maison est grande, à Ste-Anne. Tu pourrais venir t’y installer, comme ça tu serais moins seule. »
D’emblée, on saisit le malentendu entre les deux Marie : la plus âgée a reconstruit sa vie librement, loin de la famille, dans la proximité du ciel d’azur, des arbres et du pré apaisant ; la plus jeune, en deuil et esseulée, projette de la ramener près d’elle. Elle a tant de choses à lui demander, sur ses parents, sur le passé familial, les morts ; aussi est-elle plutôt réticente en apprenant que le lendemain, elles participeront à un repas au village.
Marie Gillet fait monter lentement la tension. On la ressent à travers la réserve de la grand-tante, recourant à ses mantras personnels pour garder son calme. Elle s’est éloignée des atmosphères mortifères, mais la présence de sa petite-nièce réveille les souvenirs, y compris les plus terribles. La plus jeune la met en demeure de raconter, voire de se justifier, alors qu’il lui a fallu des années pour réinventer sa vie ailleurs. Saura-t-elle éviter l’affrontement ? garder son cap ?
On retrouve dans Nous, fascinant roman de la résilience, des thèmes de Bonheur du jour : la contemplation (de très belles pages sur la nature), le goût des autres, la foi, l’écriture. Mais ici, le bonheur fait face à la douleur, la patience à l’agressivité, la lumière aux ténèbres, la vie à la mort – des questions graves. La romancière m’a troublée par les silences et les cris, le tranchant des souvenirs, la violence qui réapparaît d’une génération à l’autre, comme les prénoms. En poussant ses personnages jusqu’à leurs limites, elle fait ressentir le travail constant que représente, face au désir de l’autre, celui d’être soi-même et de choisir sa vie.
 « Bon, bref, pour le rituel du feu de joie, l’initiation de Romuald avait été parfaitement réussie. Ça se passait à la plage, à quelques mètres à vol d’oiseau de la Table. C’était un moment extrêmement élaboré et que nous prenions très au sérieux. Enfin, c’est ce qu’on se disait, mais en fait ça ne l’était pas tant que ça. L’initié devait se rendre sur la plage, fringué comme son paternel et sa daronne en même temps. Par exemple, un chemisier de la mère et le pantalon du père. Nous allumions un feu sur le sable, ce qui était totalement interdit, et nous demandions à l’initié ceci :
« Bon, bref, pour le rituel du feu de joie, l’initiation de Romuald avait été parfaitement réussie. Ça se passait à la plage, à quelques mètres à vol d’oiseau de la Table. C’était un moment extrêmement élaboré et que nous prenions très au sérieux. Enfin, c’est ce qu’on se disait, mais en fait ça ne l’était pas tant que ça. L’initié devait se rendre sur la plage, fringué comme son paternel et sa daronne en même temps. Par exemple, un chemisier de la mère et le pantalon du père. Nous allumions un feu sur le sable, ce qui était totalement interdit, et nous demandions à l’initié ceci :