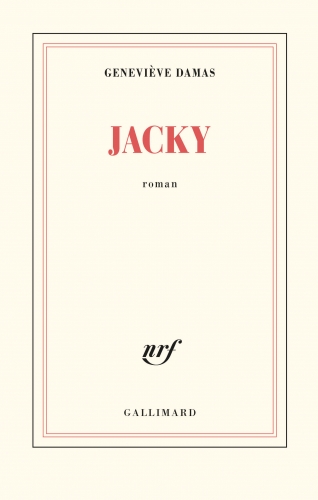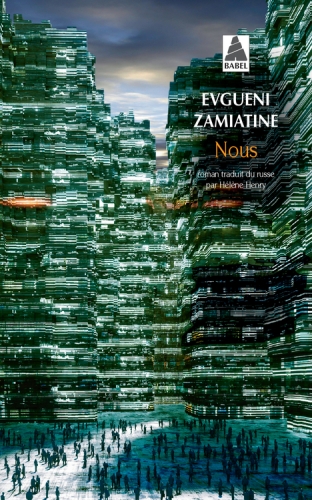Geneviève Damas – beaucoup d’entre nous ont aimé son premier roman, Si tu passes la rivière (2011) – signe cette année Jacky, un roman qui sonne juste sur un sujet délicat, sans tomber dans les stéréotypes : la rencontre entre un jeune musulman (revenu du djihad) et un garçon juif de son âge. Jacky est aussi le titre donné par Ibrahim Bentaieb, dix-huit ans, à son travail de fin d’études (TFE) secondaires. Son professeur titulaire de classe a bien insisté : pour obtenir son diplôme, il lui faudra non seulement réussir ses trois examens de passage, mais aussi lui remettre un travail sur n’importe quel sujet qui l’intéresse, avant la délibé du mois d’août.
Rien ne l’inspire, à part Jacky, qu’il a rencontré en janvier. A la fin du premier trimestre, la prof de français avait annoncé à ses élèves, musulmans pour la plupart, que pour lutter contre la montée des intolérances à la suite des attentats de Paris et de Bruxelles, ils participeraient à une journée d’activités avec une classe de catholiques et une classe de Juifs, pour « éprouver la tolérance » entre eux. (Damas a animé un atelier d’écriture sur ce thème : « Oser l’espoir ».) Peu enthousiastes, certains garçons avaient d’abord pensé à se procurer un certificat médical pour y échapper, mais ils étaient tout de même arrivés au Centre culturel laïc juif, « un lieu sous surveillance militaire au centre de Bruxelles ».
Arielle, écrivain et organisatrice, les avait accueillis un par un, distribué des autocollants avec leur prénom, puis les élèves avaient été répartis en groupes dans différents locaux, ensuite en « binômes » : « Ibrahim ira avec Jacky ». Il espérait tomber sur un catholique, mais « un minus aux cheveux noirs » lui avait alors souri et tendu la main : ils avaient trois quarts d’heure pour faire connaissance. « C’était juste un garçon comme moi. Disons qu’il n’était pas différent de ce que j’aurais été si cela [qu’on découvrira plus tard] ne m’était pas arrivé. »
« Mon portrait de Jacky » – chacun devait rédiger le portrait de son interlocuteur sans le nommer, texte qui serait lu par quelqu’un d’autre – permet au lecteur de situer le personnage éponyme ; celui qu’il a fait d’Ibrahim ne viendra qu’à la fin du roman, comme indiqué sur le plan qui précède l’introduction. Quand Jacky Apfelbaum lui propose de rester en contact sur les réseaux sociaux, il lui a répondu qu’il ne pouvait plus les utiliser et donné son numéro de téléphone.
Pour participer au voyage de fin d’année, Ibrahim a dû d’abord parler avec son assistante de justice et attendre l’autorisation de la juge. A son retour de Rome, il reçoit un texto de Jacky : « On se voit ? » Il file en vélo à leur rendez-vous au Bois de la Cambre, la première d’une série de rencontres où ils font connaissance et se découvrent plus proches qu’ils ne l’auraient cru ; ils deviennent amis. Ensemble, ils s’inscrivent aux vingt kilomètres de Bruxelles, vont « graffer » à Doel (la passion de Jacky). L’un habite Schaerbeek, l’autre Uccle, mais le jeune Juif de milieu aisé envie « Ibra » dont les parents sont plus présents que les siens.
Geneviève Damas fait raconter par Ibrahim, étape par étape, le développement d’une amitié a priori improbable. Tout n’est pas idyllique dans leur relation, mais l’émotion surgit à maintes reprises et on s’attache aux deux protagonistes. Ibra et Jacky ont chacun leurs problèmes personnels et on se prend à espérer, quand les embûches se présentent, qu’ils arrivent à surmonter ce qui pourrait les éloigner l’un de l’autre.