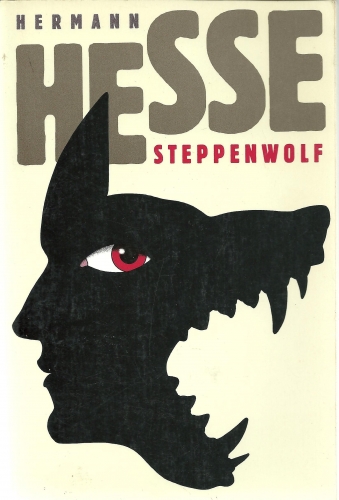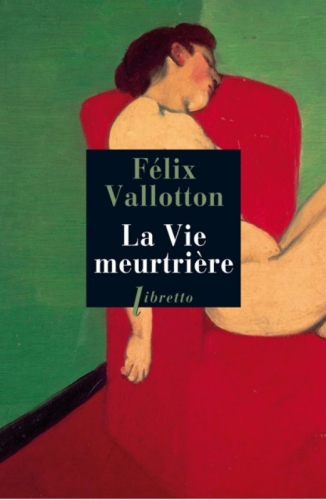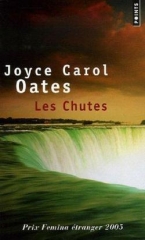Il y a presque un siècle que Le Loup des steppes de Hermann Hesse (1877-1962) a été publié, en 1927. L’écrivain suisse de langue allemande, qui prête ses initiales à Harry Haller, l’homme-loup, y exprime entre autres sa haine du nationalisme – pour lui, un ferment de guerre : l’histoire lui a donné raison.
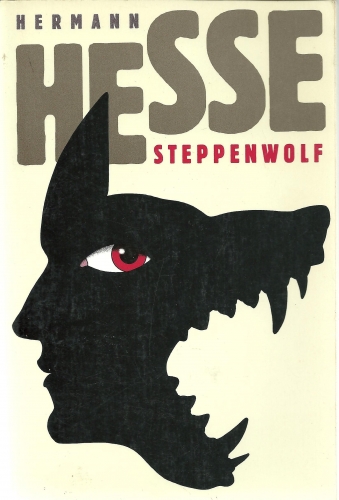
La traduction française du roman (ici par Alexandra Cade) est précédée d’une réponse en 1931 à la critique de « R. B. » : « […] il n’est pas exact de dire que l’on ne peut pas vivre d’après les principes dont je me suis fait le défenseur. Je ne prends fait et cause pour aucune doctrine constituée dont les formules seraient définitives, je suis l’homme du devenir et des métamorphoses […]. »
Dans une longue préface, « l’éditeur » présente des carnets que lui a laissés un homme dit « le Loup des steppes », la cinquantaine, locataire d’une mansarde chez sa tante. Il l’a rencontré, ils se sont parlé, ce qui permet à l’éditeur-neveu de décrire le décor particulier de son logement : tableaux, dessins, illustrations de journaux, livres débordant d’une grande bibliothèque, posés partout, cendriers, bouteilles, bref « un désordre pittoresque ».
Sous « Les carnets de Harry Haller », un récit à la première personne, figure une mention : « Réservé aux insensés », dont la signification apparaîtra plus loin. « J’avais passé le temps, je l’avais doucement tué grâce à mon art de vivre primitif et farouche » : ni exaltante ni mauvaise comme quand il souffre de la goutte, sa journée médiocre éveille en lui « un désir sauvage d’éprouver des sentiments intenses, des sensations ». Aussi, plutôt que de se coucher, il préfère enfiler son manteau pour aller boire « un petit verre de vin » à la taverne.
Lui, « le Loup des steppes apatride et l’adversaire solitaire du monde des philistins », a horreur du contentement bourgeois, bien qu’il apprécie ces foyers de propreté paisible pour y loger. Au premier étage, il s’arrête devant un araucaria sur une sellette : ce palier « plus impeccable » que les autres lui semble « un petit temple éclatant de l’ordre ». Mais il ne supporte pas le mode de vie, la mentalité, les distractions bourgeoises et se sent comme « un animal égaré dans un monde qui lui est étranger et incompréhensible. »
Harry le noctambule apprécie la tranquillité du quartier dans l’obscurité. Sur un vieux mur de l’autre côté de la ruelle, il remarque un « petit portail en ogive » auquel il n’a jamais prêté attention et traverse pour déchiffrer l’annonce de son panneau lumineux : « Théâtre magique / Tout le monde n’est pas autorisé à entrer » puis « Réservé----aux----insensés ! »
La porte ne s’ouvrant pas, il continue son chemin vers le petit café vieillot dont il est un habitué depuis son premier séjour dans cette ville, vingt-cinq ans plus tôt. Un « havre de paix » pour une heure ou deux, à boire du vin d’Alsace et à manger, ce qui le met de bonne humeur et réveille les images accumulées dans son cerveau : des anges de Giotto, Hamlet et Ophélie, un temple…, comme s’il cherchait « à retrouver, sur les ruines de sa vie, un sens volatilisé ».
Au retour, il croise une espèce d’homme sandwich. Sa pancarte promet une soirée anarchiste, du théâtre magique, en écho à l’annonce antérieure sur le portail ; quand il l’interpelle, l’homme se contente de lui donner un petit ouvrage. Rentré chez lui, Harry en découvre le titre sur la couverture : « Traité sur le Loup des steppes. Tout le monde n’est pas autorisé à lire. »
C’est son portrait : un être « insatisfait », loup et homme, qui comme beaucoup d’artistes commence à vivre le soir, libre mais seul, suicidaire, antibourgeois menant une existence bourgeoise. Un homme divisé, dont le moi n’est pas un, mais cent, voire mille ! Lui qui adore Mozart et déteste le jazz, lui qui a perdu sa réputation, son argent, sa femme, ne voit presque plus sa maîtresse, guetté par l’hallucination voire la démence, s’est souvent promis dans le désespoir d’en finir un jour avec la vie – cette porte de sortie le rassure.
Harry se révèle au lecteur lors des rencontres qu’il raconte ensuite : un dîner chez un ancien collègue, une conversation avec une jeune femme pâle et aimable à la taverne qui partage ses pensées sur la vanité de l’existence mais goûte la vie à pleines dents. C’est elle, Hermine, qui va l’entraîner dans son sillage au théâtre magique et l’initier au véritable jeu de la vie et de la mort.
Le loup des steppes est le récit tourmenté d’un homme cultivé jadis idéaliste, qui rejette la société et souffre de ses propres contradictions, de l’absurdité de son existence, qui rejette toute morale imposée. Ce roman fantasmagorique et d’une mélancolie profonde n’a pas fini d’interpeller ses lecteurs. Toute l’œuvre de Hesse est une « variation sur un même thème » : « quelle est la clef de l’homme ? ou encore : l’homme n’a qu’une seule vie, qu’en faire ? » (Encyclopedia Universalis)
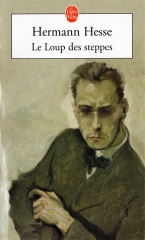 « Comment ne pas devenir un loup des steppes et un ermite sans manières dans un monde dont je ne partage aucune des aspirations, dont je ne comprends aucun des enthousiasmes ? Je ne puis tenir longtemps dans un théâtre ou dans un cinéma ; je lis à peine le journal et rarement un livre contemporain ; je suis incapable de comprendre quels plaisirs et quelles joies les hommes recherchent dans les trains et les hôtels bondés, dans les cafés combles où résonne une musique oppressante et tapageuse, dans les bars et les music-halls des villes déployant un luxe élégant, dans les expositions universelles, dans les grandes avenues, dans les conférences destinées aux assoiffés de culture, dans les grands stades. Non, je ne suis pas capable de comprendre et de partager toutes ces joies qui sont à ma portée et auxquelles des milliers de gens s’efforcent d’accéder en se bousculant les uns les autres. »
« Comment ne pas devenir un loup des steppes et un ermite sans manières dans un monde dont je ne partage aucune des aspirations, dont je ne comprends aucun des enthousiasmes ? Je ne puis tenir longtemps dans un théâtre ou dans un cinéma ; je lis à peine le journal et rarement un livre contemporain ; je suis incapable de comprendre quels plaisirs et quelles joies les hommes recherchent dans les trains et les hôtels bondés, dans les cafés combles où résonne une musique oppressante et tapageuse, dans les bars et les music-halls des villes déployant un luxe élégant, dans les expositions universelles, dans les grandes avenues, dans les conférences destinées aux assoiffés de culture, dans les grands stades. Non, je ne suis pas capable de comprendre et de partager toutes ces joies qui sont à ma portée et auxquelles des milliers de gens s’efforcent d’accéder en se bousculant les uns les autres. »