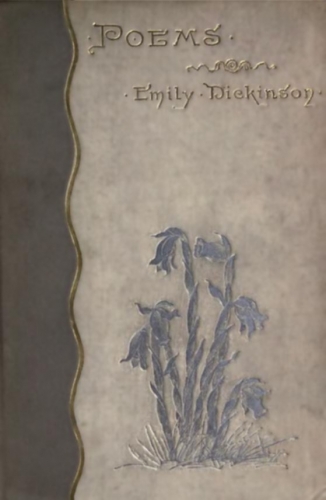Hasard des emprunts à la bibliothèque, l’intrigue de Rétrospective, un roman d’Avraham B. Yehoshua (2011, traduit de l’hébreu par Jean-Luc Allouche), se déroule dans sa plus grande partie à Saint-Jacques-de-Compostelle. Yaïr Mozes, un réalisateur israélien, y est invité à une rétrospective de trois jours en son honneur. Ruth l’accompagne, l’actrice qui fut sa muse et la compagne du scénariste de ses premiers films, devenue « la compagne de voyage attitrée de Mozes ou, plus précisément, une « figure » qu’il a prise sous son aile. »

Mattheus Meyvogel, Charité romaine, Rome, vers 1628
Juan de Viola, le directeur des archives cinématographiques (un prêtre consacré, découvrira-t-il avec étonnement), lui annonce un programme chargé : deux films au moins par jour, plus les repas et les débats, qui devraient être nourris, vu l’abondance des questions déjà formulées par des professeurs et des étudiants curieux du « cinéma de l’Etat juif », sans compter celles des amateurs.
Mozes et Ruth logent au luxueux parador en face de la cathédrale où on leur a réservé une grande chambre avec un lit double au lieu de deux chambres – cela leur est déjà arrivé, ils s’en accommodent chastement. Fatiguée, Ruth s’est vite glissée sous l’énorme édredon. Mozes s’inquiète pour elle, qui refuse de faire de nouveaux examens sanguins prescrits par son médecin traitant. Quand il se couche, il remarque au mur un tableau étrange : « un homme chauve au torse dénudé, assis ou agenouillé aux pieds d’une jeune fille à la poitrine découverte ». Puis il ôte ses lunettes et ses appareils auditifs et finit par s’endormir.
Au réveil, il examine de plus près la « mystérieuse scène mythologique » et découvre son titre, « Caritas romana, Charité romaine ». Mozes se demande si Trigano connaissait ce sujet, si proche de la raison de leur rupture brutale, à la suite d’une scène qu'il avait annulée à la fin d’un film. Une jeune femme (jouée par Ruth), qui venait de quitter la clinique après avoir accouché d’un enfant donné à l’adoption, était censée allaiter un vieillard dans la rue. L’actrice était si mal à l’aise au moment du tournage, malgré le paravent placé pour la soustraire aux regards, qu’elle s’était réfugiée dans le camion de la production. En l’apprenant, Trigano avait voulu la convaincre de reprendre la scène, mais Ruth n’avait pas cédé. Furieux, le jeune scénariste, « jadis le disciple bien-aimé et fidèle de Mozes », avait rompu définitivement avec le réalisateur et avec sa compagne.
Rétrospective raconte par le menu le déroulement de ces trois journées à Saint-Jacques-de Compostelle. Il y est abondamment question de cinéma, forcément. Yaïr Mozes est étonné du choix des films – uniquement ses premières réalisations, celles dont Trigano avait écrit le scénario – et du doublage particulièrement soigné des projections en espagnol. Il apprendra par la suite que celui-ci a été supervisé par Trigano lui-même, qui hante véritablement les pensées du cinéaste.
Saint-Jacques-de-Compostelle constitue un fabuleux décor pour cette histoire, la cathédrale en particulier, qu’ils voient de leur chambre donnant sur la place et qu’ils visitent. Avraham B. Yehoshua explore la mémoire du réalisateur, ses souvenirs des tournages et de ses relations avec Trigano, avec Tolédano, son directeur de la photographie décédé, tombé lui aussi amoureux de Ruth. La Charité romaine (peinte par Mattheus Meyvogel, a-t-il appris) l’obsède jusqu’à son retour en Israël, où tout ce que la rétrospective a réveillé en lui va se prolonger : préoccupations, rencontres, questions intimes.
Rétrospective aborde également la situation en Israël, évoquée métaphoriquement dans les films du réalisateur, et de façon très concrète lorsque Mozes se déplace dans des zones troublées par le conflit israélo-palestinien. Il veut savoir quel rôle a joué Trigano dans cette rétrospective espagnole et se demande si son scénariste, l’ancien complice, l’ami devenu son ennemi (il refuse tout contact), connaît les véritables raisons pour lesquelles Ruth a refusé de jouer la scène proche de La Charité romaine, raisons qu’elle a révélées à Mozes durant leur séjour.
Le titre en hébreu, « חסד ספרדי », signifie « Grâce espagnole » (Wikipedia). Il faut aller au bout des cinq cents pages du roman pour découvrir la scène finale extraordinaire conçue par le romancier. Mozes, malgré son âge, veut continuer son œuvre cinématographique et il retournera à Saint-Jacques. Yehoshua, né à Jérusalem en 1936, met en scène dans Rétrospective (prix Médicis étranger 2012) un trio de personnages particulièrement intéressants. Mozes, en retrouvant les intentions de ses premiers films ; Ruth, encore belle, troublée de se revoir dans sa jeunesse ; Trigano, avec sa rébellion. Le temps, l’âge les met tous à l’épreuve, sans éteindre en eux la flamme qui les fait souffrir, qui les fait vivre.