« Ce qui me semble important, c’est ce que nous faisons de ce qui nous arrive. »
Anne Le Maître, Faire refuge en un monde incertain (2025)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
« Ce qui me semble important, c’est ce que nous faisons de ce qui nous arrive. »
Anne Le Maître, Faire refuge en un monde incertain (2025)
Un nouvel essai d’Anne Le Maître, autrice et aquarelliste, vient de paraitre, au titre en phase avec nos préoccupations actuelles : Faire refuge en un monde incertain. Pendant que je le lisais, La Libre annonçait une exposition namuroise qui vient de s’ouvrir sur ce thème : « Anatomie d’une cabane, pour se réfugier ou réfléchir » (Guy Duplat, LLB, 16/4/2025).

Rembrandt, Le philosophe en contemplation, 1932, huile sur bois, musée du Louvre, Paris
« Certains matins, la maison est un refuge. » D’autres jours, elle ne l’est plus, ne suffit plus « à nous protéger des mauvaises nouvelles qui déferlent par vagues et ne peuvent susciter que désespérance : tant de haine, tant de bêtise, tant de souffrance et en face, l’impuissance et la colère que nous avons seules à leur opposer. » D’où le sujet du livre : où et comment trouver refuge ?
Anne Le Maître nous invite dans sa recherche, pour nous et pour d’autres, de « lieux sûrs où reprendre souffle, où poser nos valises et où mettre à l’abri ce qui nous est le plus cher. » Qu’en disent les dictionnaires ? Le refuge ou l’abri a de nombreux synonymes, qui désignent « un dedans qui s’oppose à un dehors menaçant », ce qui suppose une porte, une serrure. On le cherche pour s’éloigner d’un péril ou de la « laideur du monde », provisoirement.
Le désir de cabane naît chez l’enfant qui se détache du cocon maternel. Anne Le Maître convoque ses lectures d’enfance sur le thème de la petite maison accueillante à laquelle substituer un jour la maison refuge avec sa chaleur, ses livres, un jardin… Parmi les lieux de fiction où nous entraîne parfois durablement la lecture d’œuvres qui ont compté et comptent encore, j’ai retrouvé Comment Wang-Fô fut sauvé, cette nouvelle de Marguerite Yourcenar qui me fascine aussi, Une chambre à soi de Virginia Woolf. La peinture du Philosophe en contemplation par Rembrandt. Entre autres.
« Alors, qu’est-ce que je mets en sûreté quand je bâtis un abri ? Qu’est-ce qu’au contraire je veux tenir à l’extérieur des murs ? Qu’est-ce que je protège et qu’est-ce que je fuis ? Que suis-je capable d’affronter et pour servir quel but ? A quel moment et dans quelle intention vais-je pousser la porte et reprendre la route ? » La montée dans un refuge de montagne permet de « dépouiller un peu de soi-même et de l’humain moderne » et peut être beaucoup plus qu’un « divertissement », explique Anne Le Maître, qui se souvient de ses randonnées et des beautés de l’ascension. Ce n’est pas uniquement un effort sportif. Tout dépend du sens que nous y mettons.
Faire refuge en un monde incertain est riche des questions posées autant que de la recherche de réponses. Si l’anxiété par rapport au monde actuel incite au repli sur soi, cet « inconfort » moral est sans comparaison avec les souffrances physiques et mentales des victimes de la guerre, des catastrophes naturelles, des effets délétères du changement climatique. Aussi la réflexion initiale s’élargit : « la question est bien, non pas comment trouver, mais comment faire refuge. Et ce, pour d’autres aussi bien que pour moi. » Comment « jardiner des oasis » ?
Le chapitre « Devenir gardiens » s’ouvre sur une question adressée à l’essayiste : « Mais comment peut-on seulement se permettre d’aspirer à la sécurité et à la tranquillité d’un refuge quand tant d’autres que nous, dans le monde, n’en ont ni la possibilité, ni même l’espoir ? » Celle qui la lui a posée est une « héroïne du quotidien », écrit-elle : jour après jour, celle-ci tente « non pas de trouver refuge, mais bien de faire refuge pour de plus mal lotis qu’elle. » Les derniers chapitres sont ceux que j’ai trouvés les plus intéressants, dans cette optique.
Merci, Anne Le Maître, avais-je écrit ici en présentant Sagesse de l’herbe. Après Un si grand désir de silence et Le jardin nu, en cheminant dans la lecture de Faire refuge en un monde incertain où nous nous reconnaissons souvent (comme ce fut le cas dans Chez soi de Mona Chollet), nous découvrons le sens profond du titre, accrocheur au premier abord, devenu appel à l’engagement et à l’ouverture.
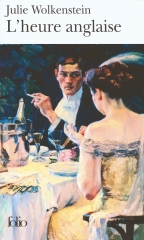 « Edward la croyait experte en bouquets. Ou bien faisait-il semblant ? Comme elle, lorsqu’elle admirait ses vins ? Non, il l’avait observée un jour, sur le versant d’une montagne, l’avait regardée arranger des brindilles sauvages. Il l’avait aimée encore plus après cela, elle en était sûre. C’était la première fois qu’elle composait un bouquet, trouvant instinctivement les bons gestes, comme si les fleurs guidaient sa main. Au début, elle se penchait pour se donner une contenance, échapper aux yeux d’Edward, masquer le trouble qui la saisissait en les croisant. »
« Edward la croyait experte en bouquets. Ou bien faisait-il semblant ? Comme elle, lorsqu’elle admirait ses vins ? Non, il l’avait observée un jour, sur le versant d’une montagne, l’avait regardée arranger des brindilles sauvages. Il l’avait aimée encore plus après cela, elle en était sûre. C’était la première fois qu’elle composait un bouquet, trouvant instinctivement les bons gestes, comme si les fleurs guidaient sa main. Au début, elle se penchait pour se donner une contenance, échapper aux yeux d’Edward, masquer le trouble qui la saisissait en les croisant. »
Julie Wolkenstein, L’heure anglaise
Julie Wolkenstein a écrit une thèse sur Henry James, dont le fantôme hante un peu L’heure anglaise, son deuxième roman (2000) qui m’avait beaucoup plu à la première lecture. Elle y raconte une journée d’été d’Edward et Susan Sanders, qui vivent dans une belle maison à la campagne, en 1911. Je me souvenais surtout de la longue promenade clandestine d’Edward, averti par un télégramme à la gare d’un rendez-vous annulé, qui le laisse libre pour la journée. Il décide de rentrer à pied en longeant la rivière, tandis que Susan se rend à Londres, sans qu’il le sache.

Motif "Chèvrefeuilles" du papier peint par William Morris
« Edward », la première partie, remonte à la veille au soir : en secouant les cendres de son cigare à la fenêtre, il regarde les rectangles de lumière sur la pelouse et descend éteindre l’électricité à la cave. Deux cents bouteilles de vin ramenées de Provence – il les collectionne depuis dix ans – y témoignent de sa véritable passion, alors que ses amis louent davantage la qualité de ses cigares, hérités de son père. Dans leur chambre, Susan dort déjà.
Le matin, une fois qu’il a vu ses enfants, Miles et Flora, au petit déjeuner, et Susan qui a rempli un panier de fleurs blanches pour la soirée chez les Porter, leurs voisins, Edward va prendre le train pour se rendre à l’étude Closely, Sanders & Co. Au téléphone, on lui a confirmé qu’il était « inutile de venir » : le voilà libre pour la journée. Sans avertir chez lui, Edward emprunte le sentier qui borde la Sheldon River et se souvient, en marchant, de son enfance solitaire.
Sa mère, « née Lady Virginia, fille du dix-septième duc de Coolingham », a mis quatre filles au monde, toutes décédées avant la naissance de son fils. Féministe militante qui réunissait des femmes du monde chez elle, elle n’entrait quasi jamais dans la nursery où Edward jouait seul avec ses soldats de plomb. Livré aux nurses, il ne voyait guère son père, retranché dans son bureau où il se faisait même porter ses repas.
Sa mère s’était tuée dans un accident d’automobile, son père ne lui avait pas survécu longtemps. Il avait vendu leur maison. Ne fait-il pas comme son père, au fond, en laissant derrière lui chaque matin sa famille et les domestiques ? Tout à sa flânerie inopinée, il ne se montre pas quand il entend les voix de deux d’entre elles, ni quand il aperçoit ses enfants avec leur gouvernante. Rentré dans la salle à manger ouverte sur le jardin, que prolongent les chèvrefeuilles de William Morris sur le papier peint, il épie la maisonnée à cette heure où il n’est jamais là.
La cuisinière a préparé un gigot d’agneau qui doit cuire sept heures, il s’en délecte, lui à qui on ne sert d’habitude que de la volaille ou du poisson maigre. Dans leur chambre, Susan a laissé traîner un roman d’Edith Wharton ; il en tombe un carton : l’annonce du décès de Miss Amanda Closely à trente ans, celle qu’il avait failli épouser.
« Susan », la deuxième partie , deux fois plus courte, débute dans le bureau d’Edward à Londres, où son épouse pensait lui faire la surprise, après son rendez-vous chez Asquith, d’un déjeuner ensemble. Au rez-de-chaussée, dans la vitrine d’un magasin de nouveautés, elle a remarqué d’emblée une écharpe en soie brochée, bordée de velours écarlate. Elle décide de l’acheter pour la porter le soir même.
Elle aussi est assaillie par ses souvenirs, de ses amies de jeunesse dont l’une était morte accidentellement lors d’une sortie en voilier. En déjeunant seule dans le salon de thé où elles se retrouvaient jadis, elle pense à ce qu’elle doit annoncer à Edward. Ses pensées croisent celles d’Edward, les éclairent d’un autre jour. Elle ne sait pas encore qu’elle va le retrouver à la maison en rentrant.
Le couple en couverture du Folio (un détail d’une peinture de Cucuel) a peut-être été choisi pour ce regard non échangé ou par allusion à l’endroit où les Sanders passent leurs vacances, dans le Midi. J’ai préféré reprendre ce motif de William Morris dans leur salle à manger, où se déroule la dernière partie de ce roman où Julie Wolkenstein excelle à peindre des atmosphères, un saut dans le temps inattendu et révélateur. « Une intrigue faussement simple », selon le billet de Keisha, fan de cette romancière, qui m’a donné envie de relire L’heure anglaise.
 Les mosaïques que je rencontre en balade dans Schaerbeek sont pour la plupart des mosaïques de trottoir artisanales. Elles ont le charme du « fait main » (contrairement aux mosaïques toutes faites, trop régulières), elles retiennent par leurs couleurs, leur originalité, leur sujet qui répond à une demande plus ou moins précise.
Les mosaïques que je rencontre en balade dans Schaerbeek sont pour la plupart des mosaïques de trottoir artisanales. Elles ont le charme du « fait main » (contrairement aux mosaïques toutes faites, trop régulières), elles retiennent par leurs couleurs, leur originalité, leur sujet qui répond à une demande plus ou moins précise.
Quand je suis passée devant, il y a peu, cette mosaïque d’un numéro sur le mur d’une maison m’a séduite par sa finesse et sa composition. Le chiffre deux, très clair, se détache noir sur blanc ; le fond évoque le craquelé d’une faïence. J’admire à l’intérieur du cadre le jeu des courbes végétales, le vert des tiges en camaïeu, les nuances des fleurs rouges…
Au moment où je prends la photo ci-dessus, la porte s’ouvre. A la jeune femme qui sort, je dis mon sentiment : elle m’apprend que c’est sa mère qui a composé ce numéro de maison et que c’est elle aussi qui a créé une grande et charmante mosaïque d’entrée que je ne manque jamais de regarder au passage, non loin de là. Abritée sous un porche, elle n'est pas facile à photographier (la photo date d’il y a quelques années).
Bravo, l’artiste !