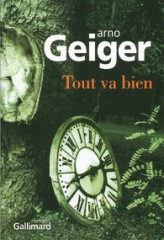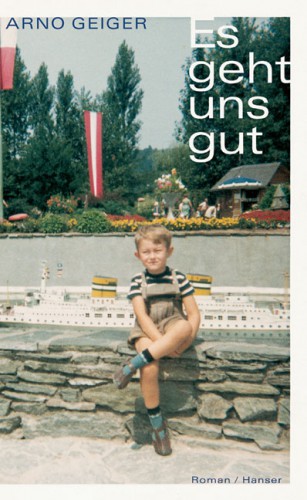Des branches d’érable traversent la jolie couverture de Jardin de printemps, un roman de Tomoka Shibasaki (Haru No Niwa, 2014, traduit du japonais par Patrick Honnoré), romancière née à Osaka en 1973. Quasi pas d’intrigue dans ce récit : Tarô, un des derniers occupants d’un immeuble d’une trentaine d’années voué à la démolition, passe le plus clair de son temps libre à observer ce qu’il voit de chez lui.

Styrax japonica / Source : http://www.eggert-baumschulen.de/
Une femme au balcon du premier étage, le lierre sur un mur de séparation en parpaings, au-dessus duquel un prunier et un érable « plus entretenus » étendent leurs branches, le ciel et les nuages… Tarô s’imagine marcher sur les nuages et de là, regarder la ville en bas, « comme une scène de dessin animé, parfaitement ». Cette femme aux lunettes de monture noire, qui a emménagé en février, tient un carnet de croquis, elle semble regarder quelque chose et il finit par voir quoi : « la maison d’à côté, plus vers chez lui. La maison bleu clair. »
Le View Palace Saeki III compte quatre appartements au rez-de-chaussée, quatre à l’étage, « désignés chacun non par un numéro mais par un signe du zodiaque ». Comme le nom des locataires n’apparaît nulle part (« la norme de nos jours »), Tarô appelle la dame de l’appartement du Serpent Mme Serpent, lui habite celui du Sanglier. Un jour, celle-ci le guette à son retour du bureau : elle a trouvé une clé avec un petit personnage et pensé qu’elle lui appartenait, c’est le cas. Pour la remercier, il lui offre « des mamakari marinés au mirin », des poissons séchés qu’un collègue lui a rapportés – il sera souvent question de nourriture dans ce roman, et d’échanges de ce genre : dosettes de café, saumon, etc.
L’occupante de l’appartement du Dragon l’intrigue, et un matin, en la voyant passer devant l’immeuble, il la suit qui se dirige vers la maison bleu clair, tend le cou pour regarder par-dessus le mur, « franchement l’air suspect » : « C’était une construction dans le style occidental. Les lattes horizontales de la façade étaient peintes dans un lumineux bleu clair. Une pointe de pique ornait le sommet du toit de tuiles brun-rouge à quatre pans comme une pyramide aplatie. » De son appartement, Tarô en voit l’arrière et le vitrail aux libellules rouges d’une petite fenêtre.
C’est la maison des Morio (leur nom est indiqué près du portail). Près de l’entrée, un vélo d’enfant, un tricycle et une petite voiture bleu clair elle aussi. Dans le jardin privé, un lilas des Indes. Sa voisine rentrant chez elle, lui continue vers la gare. Avant son divorce, Tarô était coiffeur dans un salon géré par son ex-beau-père. Un mal de dos l’a fait choisir ensuite un boulot commercial plus stable.
Il finit par faire connaissance avec « Mme Dragon » qui aimerait regarder la maison bleue de son balcon à lui, plus proche, parce qu’elle la trouve magnifique. Nishi est dessinatrice de mangas et, pour le remercier de son accueil, l’invite à dîner dans une brasserie – elle adore la bière. Là, elle lui montre un livre de photographies, « Jardin de printemps » : quatre ou six photos par page, presque toutes en noir et blanc, toutes de la maison bleue ou du jardin. Elle date de 1964, l’année des J. O. de Tokyo ; c’était le genre de maison que construisaient des gens cultivés avec le désir « d’en faire trop ». Nishi l’a découverte en visitant un site de locations immobilières et quand elle a vu le carrelage jaune-vert de sa salle de bain, elle a reconnu la maison de l’album, consacré à un couple qui l’habitait, un réalisateur de films publicitaires (qui s’appelle aussi Tarô) et une comédienne.
Jardin de printemps tourne autour de cette fascination pour la maison bleue, celle de Nishi puis celle de Tarô à sa suite. Sa voisine va tout faire pour y pénétrer en se mêlant à la vie des Morio. Tarô observe alors avec encore plus d’attention les logements des environs, les coquilles vides ou habitées de leur quartier. Et aussi les arbres, les oiseaux, les insectes, comme la gale du styrax japonica qui inquiète Mme Serpent ou la petite urne de guêpe potière qu’il trouve dans le rail de sa fenêtre coulissante.
Prix Akutagawa 2014, ce roman court (140 pages) gentiment envoyé par Lewerentz qui l’a trouvé trop contemplatif à son goût, est un roman de petits riens, en effet. Le narrateur, qui préfère à tout se vautrer sur un canapé, est incité par ses voisines, et surtout par l’audacieuse Nishi, à s’intéresser davantage aux autres et à leur histoire, et pas seulement via internet ou les réseaux sociaux.
Tomoka Shibasaki écrit dans un style minimaliste plutôt familier. Il me semble que si, sans m’y être vraiment ennuyée, la lecture de ce roman me laisse un goût de trop peu, c’est dû et à cette écriture peu travaillée et au caractère passif du personnage (à l’opposé du héros de La compagnie des artistes, attaché à la résidence Cairo ; Melbourne, il est vrai, n’est pas Tokyo, mais j’ai pensé quelquefois pendant ma lecture au roman de Chris Womersley). J’ai pourtant apprécié la description des petits gestes entre voisins, à la japonaise, et surtout l’attention portée à cette maison, à ses détails, à son jardin, qui en fait un espace dédié à la recherche du beau et de la lumière, un rêve de vie heureuse.