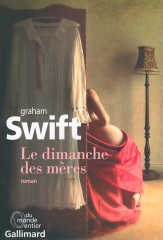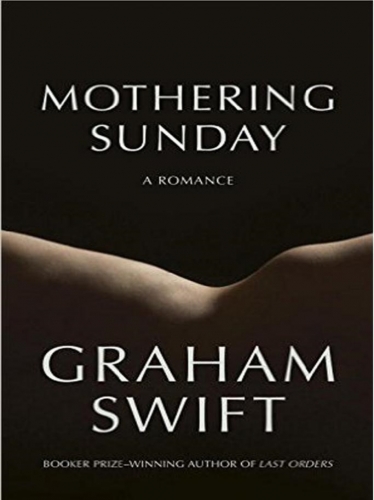Une série télévisée sur les attentats de 2016 à l’aéroport de Zaventem (Bruxelles-National) ? Quand j’ai appris le tournage de « Lost Luggage », j’ai été choquée comme chaque fois qu’on s’empare d’une tragédie récente pour élaborer une fiction. Le procès des attentats est encore en cours à Bruxelles – je ne la regarderais pas. L’article de La Libre annonçant la diffusion de cette coproduction Arte/VRT (2022) m’a pourtant décidée à regarder au moins le premier épisode (il y en a six en tout).

Photo Lara Chedraoui dans "Lost Luggage" © De Mensen
J’ai suivi toute la série, un « récit post-traumatique » axé sur les suites des deux explosions qui ont causé la mort de seize personnes et blessé une centaine d’autres, sans compter le traumatisme psychologique des témoins, des proches, des intervenants pour les secourir. Lara Chedraoui (chanteuse du groupe rock Intergalactic Lovers) joue le rôle principal, celui de Samira Laroussa, une policière de l’aéroport hantée par ce qu’elle a vu, dont des flashs lui reviennent, sans qu’elle se souvienne de tout.
Parmi les morts et parmi les blessés, il y a eu des policiers et des employés de l’aéroport, en plus des passagers Tous ont eu la malchance d’être là au mauvais moment. « Lost luggage » est centré sur la récupération des bagages perdus dans ces circonstances. Tous les objets retrouvés dans le hall des départs ont été mis pêle-mêle dans un hangar. Certaines valises portaient un nom, d’autres pas.
Alors que les vols vont reprendre, dix jours après les attentats, le chef de la police aéroportuaire désigne Samira pour s’en occuper : il faut trier tout cela, photographier, étiqueter, contacter les familles quand l’identification est possible, recevoir les personnes qui réclament leurs affaires ou celles d’un proche. La policière ne comprend pas qu’on les charge de cela, alors qu’ils sont en sous-effectif depuis les attentats. Mais elle s’y met.
Le travail est énorme, sous-estimé, et très délicat, surtout dans la relation avec les personnes concernées de près par les attentats. Un objet dérisoire, même abîmé, peut jouer un rôle clé dans la vie « d’après ». Tous ne comprennent pas à quel point il importe de tout conserver. Les particuliers regrettent que la restitution des effets personnels prenne tant de temps et qu’on ne les autorise pas à fouiller eux-mêmes dans les bagages.
La vie de couple de la policière est mise à rude épreuve, tant son travail l’obsède. Le respect et l’empathie dont elle fait preuve sont remarquables. Elle-même a été traumatisée, plus qu’elle ne le pense au début. Son sens du devoir, sa délicatesse avec ceux qui ont souffert, qui continuent à souffrir des attentats, vont l’éloigner de son compagnon, de sa famille, de ses collègues. Elle ne peut plus bavarder de tout et de rien, elle ne peut plus reprendre sa vie d’avant.
Généreuse, elle accepte que son frère plutôt bohème mis à la porte de son appartement vienne dormir chez eux. Implacable, elle rejette son père qui n’a pas pris soin de sa mère malade et l’a laissée seule pour s’occuper d’elle jusqu’à la fin. Quand elle rentre chez elle, son compagnon l’accueille avec patience, mais leur projet de mettre un enfant au monde est mis à mal. Il ne comprend pas ses réactions ou son mutisme.
Samira rend visite à l’hôpital à un collègue gravement blessé, à une passagère dont la mère s’impatiente du fait que les bagages de sa fille n’ont pas encore été restitués. Elle assiste à des scènes de colère, de rupture, de désespoir… Elle fait face à l’incompréhension, à l’indifférence – elle prend sur elle. Pour ceux qui ont vécu ces événements, voir la vie des autres reprendre « comme avant » est souvent insupportable.
Chaque épisode repart des explosions et raconte les journées de Samira – et même les nuits, qu’elle passe parfois dans le hangar – aux prises avec les demandes, les injonctions, les consignes et avec sa propre vie qui se délite malgré elle. L’actrice joue très juste dans ces situations extrêmement tendues.
La série « Lost luggage » est « dédiée à toutes les victimes visibles et invisibles de la terreur, pour qu’elles ne soient pas oubliées » (Arte). Elle rend hommage aussi à ceux qui donnent tout ce qu’ils peuvent à ceux qui ont tout perdu. Les scènes avec des enfants sont bouleversantes. Rester humain contre l’inhumain, réparer ne fût-ce que quelques fils d’une vie brisée, voilà l’attitude dont témoigne Samira Laroussa. Et elle n’est pas la seule à être solidaire.
Même si nous avons lu les articles, portraits, récits consacrés aux attentats, même si nous suivons le cours du procès et les témoignages – l’un ou l’autre accusé a été choqué voire bouleversé d’être « pardonné » par certains –, cette série psychologique fait prendre encore mieux conscience, à travers des situations concrètes, de la profondeur des traumatismes et de la difficulté pour beaucoup à remettre du sens dans leur vie, à continuer. A voir sur Arte.tv
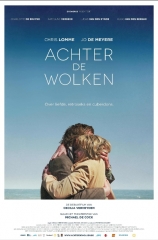 « Jamais tape-à-l’œil, sa mise en scène élégante [celle de la jeune scénariste et réalisatrice flamande Cecilia Verheyden] n’élude pourtant aucune question liée au sujet. Notamment celle de la sexualité des personnes âgées, abordée frontalement mais avec énormément de tact et une touche d’humour. Et s’il évoque bien par exemple la "tendance" du "rétrosexe" (le fait de coucher avec un ancien amour), le film ne se résume jamais à une enquête sociologique, toujours concentré sur son personnage principal.
« Jamais tape-à-l’œil, sa mise en scène élégante [celle de la jeune scénariste et réalisatrice flamande Cecilia Verheyden] n’élude pourtant aucune question liée au sujet. Notamment celle de la sexualité des personnes âgées, abordée frontalement mais avec énormément de tact et une touche d’humour. Et s’il évoque bien par exemple la "tendance" du "rétrosexe" (le fait de coucher avec un ancien amour), le film ne se résume jamais à une enquête sociologique, toujours concentré sur son personnage principal.