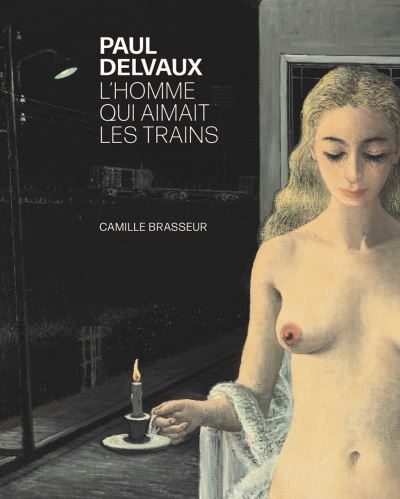Portret van een jonge vrouw (Portrait d’une jeune femme) est un petit livre illustré publié en 2019 par la Fondation Phoebus. Sous ce titre, Leen Kelchtermans, historienne de l’art, raconte l’histoire du tableau éponyme, dû à un maître anversois anonyme, montré cette année à l’Orangerie du château de Moorsel dans le cadre d’une grande exposition sur la dentelle, du Moyen Age à nos jours.

Maître anversois anonyme, Portrait d'une jeune femme, 1613,
huile sur panneau, 107 x 77 cm, The Phoebus Foundation, Antwerpen
La collection Phoebus Focus est dédiée à la recherche de l’histoire cachée derrière une œuvre d’art. C’est ce que fait ici l’essayiste en interrogeant le contexte et tous les détails de ce portrait minutieux. « How to look chic ? » Voilà une question que se posent bien des candidates à l’élégance sur les réseaux sociaux. Nul doute que cette jeune femme, avec ses dentelles et ses bijoux, pouvait y prétendre. Elle maîtrise l’art du paraître au XVIIe siècle.
« Une jeune femme se tient devant un mur gris foncé et nous regarde, avec un sourire parcimonieux. » (L. K.) Son col délicatement travaillé, ses accessoires coûteux attirent notre attention et aussi ce jeune visage, ces yeux en amande. Sa main droite est posée du bout des doigts sur une table couverte d’un tissu vert. En haut à droite, l’inscription « A°.1613 » indique l’année où le peintre l’a immortalisée. Ni lui ni elle ne sont identifiés.
La qualité du tableau, la précision dans le rendu de la peau, des vêtements, des bijoux, illustrent l’essor de l’art du portrait flamand à cette époque, un genre prisé par les riches marchands. Leen Kelchtermans interroge tous les aspects de cette représentation : l’apparence, la parure, les accessoires, la pose, le regard. Elle propose une véritable incursion dans le monde du portrait féminin baroque. D’autres portraits de la même époque signés de grands maîtres lui seront comparés, avec leurs ressemblances ou variantes par rapport au Portrait d’une jeune femme.

Maître anversois anonyme, Portrait d'une jeune femme, 1613 (détail)
La fraise ornée de dentelle, « collerette de lingerie finement tuyautée, plissée ou godronnée, souvent fort importante et sur plusieurs rangs, tournant autour du cou qui fut portée par les hommes et les femmes des XVIe et XVIIe siècles » (TLF), entoure le visage d’une façon spectaculaire, de même que les manchettes sur ses poignets. La jeune femme porte en plus un double rang de perles autour du cou, perles qu’on retrouve sur une sorte de diadème et sur la croix qui y est accrochée, ainsi qu’au poignet droit.
En 1625, Jacob Cats, dit « Vader Cats », zélandais et calviniste, a publié « Houwelick », un traité de bonnes manières : une femme des Pays-Bas du Nord pouvait y lire comment il convenait de se comporter à chaque étape de sa vie, en tant que vierge, célibataire, épouse, mère, veuve. Ce bestseller est riche d’enseignements sur la condition féminine, les règles et les normes de l’époque.
La mode vestimentaire féminine évoluera lentement au cours du XVIIe siècle, l’influence espagnole, le goût pieux pour le noir et le blanc, les tenues strictes cédant peu à peu la place à plus de souplesse, aux couleurs pastel, avec l’abandon de la fraise pour un décolleté d’une épaule à l’autre, à la française. La jeune femme du portrait porte de très beaux vêtements, avec un contraste marqué de la soie finement brodée en couleurs avec la jupe et le manteau noirs. Ses bijoux témoignent de son rang social : perles, rubis, diamants, couvrant d’oreille maintenant le diadème, chaîne en or travaillée avec pendentif autour de la taille, bagues.

Maître anversois anonyme, Portrait d'une jeune femme, 1613 (détail)
Qui est-elle ? Sans doute une femme mariée. Son attitude légèrement tournée vers la droite indique qu’elle se tenait à gauche de son mari qui, sur le pendant, devait se tourner légèrement vers la gauche, ainsi qu’il convenait pour représenter deux époux, on peut le vérifier sur maints portraits de l’époque. Selon Leen Kelchtermans, la Bible est à origine de ces connotations de la droite et de la gauche, indiquant la supériorité et l’infériorité.
Sa lecture de ce Portrait est passionnante, approfondie point par point. Elle se termine sur un examen du regard pénétrant, assuré, auquel le peintre a donné vie par de petites touches de blanc. L’œuvre, surtout de « représentation », est riche de renseignements sociologiques. L’artiste, en faisant le portrait de cette jeune femme, l’a représentée dans sa beauté idéale et dans le respect des conventions (édictées par les hommes) liées à son statut d’épouse.
Dans ce petit livre d’art très bien illustré, quasi une page sur deux montre une reproduction en pleine page ou un gros plan d’une partie du tableau. L’analyse précise et documentée de ce Portrait d’une jeune femme donne envie d’explorer cette collection. Peut-être disposera-t-on un jour d’une traduction française ? Merci à celle qui me l’a mis entre les mains.
* * *
P.-S. Après contact avec la Fondation Phoebus, j’ajoute que le livre de Leen Kelchtermans sera traduit en anglais l’an prochain ; la traduction française n’est pas encore prévue. Pour info, la collection Phoebus Focus sera bientôt disponible en librairie et en ligne. (13/12/2019)