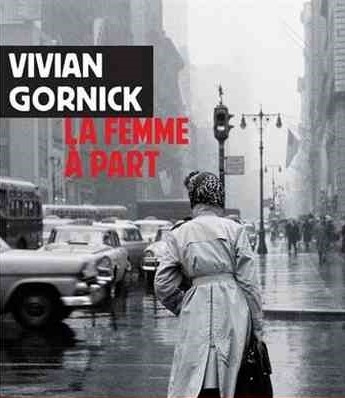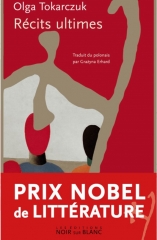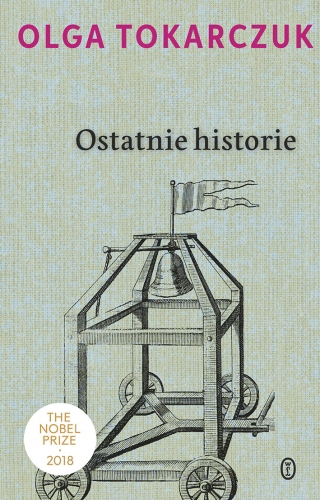Une femme en imper traverse une rue sous la pluie : la photo de couverture m’a fait mettre la main sur La femme à part de Vivian Gornick. Cette New-Yorkaise, « critique littéraire et écrivain », raconte dans The Odd Woman and The City (2015, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Laetitia Devaux) ses déambulations en ville, ses rencontres et observations, ses lectures. Dans ce livre de souvenirs (« a memoir »), les détails personnels ont été modifiés, précise-t-elle, la chronologie, des personnages et des scènes sont « composites ».
Leonard, « un homme gay et spirituel », est son interlocuteur privilégié : « Leonard et moi partageons le même goût pour la politique du préjudice. Le sentiment exalté d’être né dans un ordre social préétabli et injuste flambe en nous. » Depuis plus de vingt ans, ils se voient une fois par semaine pour une promenade, un café, pour parler surtout. « L’image de soi que chacun projette sur l’autre est l’image mentale que nous avons de nous – celle qui nous permet de nous sentir complet. » Tous deux ont le même problème : « un net penchant pour le négatif ».
Avec une grande liberté de ton, cette femme à part – « odd » signifie « étrange, bizarre », on lira plus loin d’où vient le titre – rend compte de leurs conversations, les commente. Elle met par écrit les paroles, les échanges, les gestes dont elle a été témoin dans la journée. On parle, on se parle beaucoup dans les rues de New York qu’elle fréquente, elle écoute, elle intervient. C’est sa vision d’« une ville où aucun de nous ne va nulle part, car nous sommes déjà là, nous autres les éternels spectateurs du poulailler qui arpentons ces artères misérables et merveilleuses à la recherche de notre reflet dans les yeux d’un inconnu. » Elle se sent proche de Samuel Johnson marchant dans Londres au dix-huitième siècle « pour apaiser sa dépression chronique ».
Vivian Gornick a grandi dans le Bronx en rêvant de Manhattan, le centre du monde dont elle se sentait alors très loin. A quatorze ans, elle a commencé à prendre le métro pour « parcourir Manhattan de long en large, tard les soirs d’hiver ou dans la chaleur de l’été. » Rentrée dans le Bronx, elle attendait que sa vie commence. « Dès que je serais assez grande, New York m’appartiendrait. »
« Les trottoirs de cette ville sont couverts de gens qui tentent d’échapper à l’emprisonnement de la mélancolie pour embrasser la promesse de l’espoir. A certains moments, New York semble chanceler sous l’impact. » De sa mère, elle a hérité une conception tchekhovienne de l’existence. Surtout après la mort de son père – « la bonne personne » que sa mère avait eu la chance d’épouser –, celle-ci ressentait une insatisfaction perpétuelle. « Moi, j’errerais pour le reste de ma vie dans le purgatoire de l’exil volontaire, toujours en quête de la bonne personne à qui parler. » Fatiguée de chercher « l’Amour avec un grand A, le Travail avec un grand T », elle lit, écrit, finit par épouser un scientifique : un bon camarade, un certain confort de vie, mais ce n’était pas « le bon », ils ont bientôt divorcé.
Quelques pages sur l’atmosphère « indescriptible » après le 11 Septembre, sur les gens dans le métro, dans le bus. Ceux dont on découvre la vie en lisant comptent aussi beaucoup dans sa vie, comme Mary Britton Miller « devenue une Femme à part » à vingt-huit ans en s’établissant à New York (1911) « où elle vécut seule et écrivit pendant toute sa longue vie ». Dans ses romans signés Isabel Bolton, « elle s’accommode de la vie parce qu’il y a la ville à aimer », son véritable sujet, selon Vivian Gornick, indissociable de la solitude, angoissante, mais à laquelle les êtres humains comme elle sont réticents à renoncer.
Elle rend visite à une écrivaine de sa connaissance, qui a été obligée par l’arthrite d’entrer dans une maison médicalisée à l’âge de quatre-vingt-cinq ans. Du confort et des soins attentifs, mais quasi plus personne avec qui parler vraiment – « des bavardages, ça oui, lui dit-elle. Mais une conversation comme celle que nous avons là ? Jamais. » Et pourtant, stoïque, elle s’y intéressait à son entourage, « son goût de romancière pour les bizarreries de l’humanité l’y aidait. »
Vivian Gornick évoque beaucoup de ces femmes qui font face ou n’y arrivent pas. Comme Constance Woolson devenue l’amie d’Henry James en Italie, suicidée à Venise. Comme Evelyn Scott, une écrivaine des années vingt dont tout moderniste de Greenwich Village connaissait le nom – un bouquiniste amateur tombé en possession de ses lettres, journaux et manuscrits a publié sa biographie (intitulée Pas mal pour une femme) dont elle se régale.
« A la fin du dix-neuvième siècle, plusieurs génies littéraires ont écrit de grands livres sur les femmes des temps modernes. En l’espace de vingt ans ont paru Jude l’Obscur par Thomas Hardy, Portrait de femme d’Henry James, Diana of the Crossways de George Meredith. Aussi perspicaces que fussent ces romans, c’est Femmes à part de George Gissing qui me parle le plus. J’ai l’impression que ses personnages sont les hommes et les femmes de mon entourage. […] Gissing a trouvé le mot juste : nous sommes les femmes « à part ». » (La traductrice signale dans ses remerciements avoir modifié le titre habituel de la traduction française, Femmes en trop).
Grande marcheuse (dix kilomètres à pied par jour pendant des années) et grande lectrice, Vivian Gornick restitue de façon très vivante ces moments intenses que sont les rencontres dans le monde et dans les livres. Parmi toutes ces voix new-yorkaises, je n’oublierai pas celle de John Dylan, un grand comédien du Public Theatre qu’elle avait souvent croisé, devenu aphasique après une attaque. Elle raconte une lecture à laquelle il l’avait invitée, dans son appartement, des Textes pour rien de Beckett et conclut, émue et émouvante : « Je savais que je venais d’entendre Beckett – de l’entendre vraiment – pour la toute première fois. »