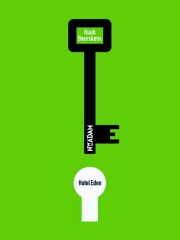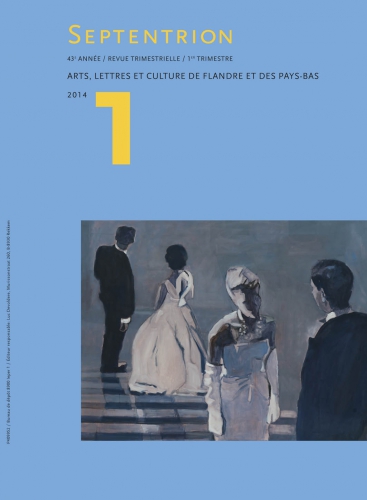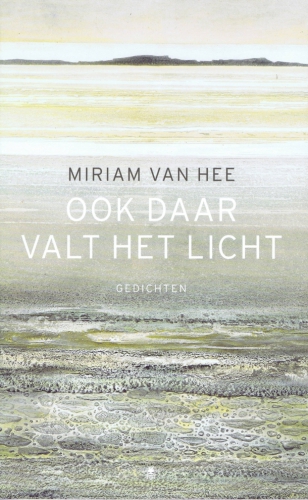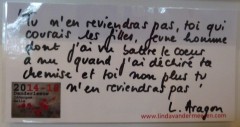Cela fait bien longtemps qu’Euterpe, partie vers d’autres aventures, ne nous titille plus avec ses féminins féministes, je pense à elle en juxtaposant ces deux suffixes homonymes en français et en néerlandais. Au stand de Ons Erfdeel vzw à la Foire du Livre, j’ai retrouvé Septentrion que je lisais régulièrement à la bibliothèque de l’école. J’ai reçu avec plaisir un numéro de cette revue trimestrielle des « Arts, lettres et culture de Flandre et des Pays-Bas » qui a aussi un blog destiné à faire mieux connaître la culture des « Plats Pays » aux lecteurs francophones.
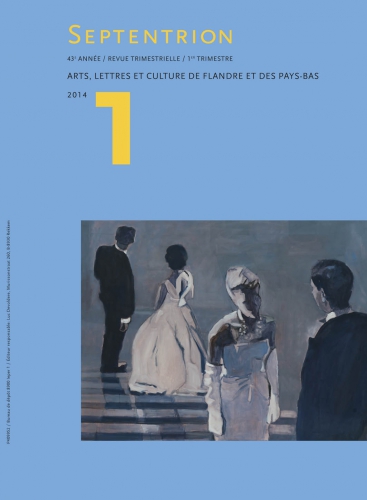
Dans ce numéro 1 de 2014, Bart Stouten (présentateur, producteur pour la chaîne de musique classique Klara (VRT) et poète, comme vous pouvez le lire sur son blog) présente la poésie de Miriam Van hee sous le titre « Tout commence chez soi… mais où ? » (traduit par Jean-Philippe Riby). Née en 1952, cette poétesse flamande le fascine avec ses vers « épurés, lumineux » et il nous parle de ses recueils publiés depuis 1978 (Le maigre repas / Het karige maal).
Voici deux poèmes de Miriam Van hee, tirés de Là où tombe la lumière / Ook daar valt het licht (2013). Elle est la première femme à avoir reçu, en 1998, le prix triennal de poésie de la Communauté flamande. En 2007, l’édition française de son recueil La cueillette des mûres / De bramenpluk a été récompensée par le prix européen Poesias, rebaptisé depuis prix Virgile.
Bart Stouten conclut son article par ce bel éloge : « Miriam Van hee est à mes yeux la poétesse du mystère. La poétesse du contre-jour. La poétesse d’un paradoxe qui fait des mots un silence. A la vérité, là encore choit la lumière. Aussi étrange que cela puisse paraître, la lumière éclaire jusqu’à l’indicible. »
Sur place
en bas est le village, il paraît
tout avoir, un clocher
une place, un pont et des lointains
un bois de chênes où le vent parfois
se déchaîne, et des maisons
les volets sont fermés, des taches
de lumière bougent sur le chemin
de terre et c’est miracle, un monde
habitable à ce point, et que pousse
le raisin dans un sol aussi dur
et que la treille ombrage
sans y penser, le pommier porte
encore des pommes petites, rouges et qui
sous l’œil de personne, tomberont
quand leur heure sera venue
Surplace
Beneden ligt het dorp, het lijkt
alsof het alles heeft, een toren
een plein, een brug, een achtergrond
een eikenwoud waarin de wind
tekeer kan gaan, en huizen
de luiken zijn gesloten, vlekken
licht bewegen op de aarden weg
het is een wonder, zo bewoonbaar
als de wereld is, dat druiven
kunnen groeien in zulke harde grond
en de wingerd schaduw geeft
zonder bedoeling, de appelboom
draagt appels nog, kleine, rode, die
voor niemands ogen zullen vallen a
ls hun tijd gekomen is
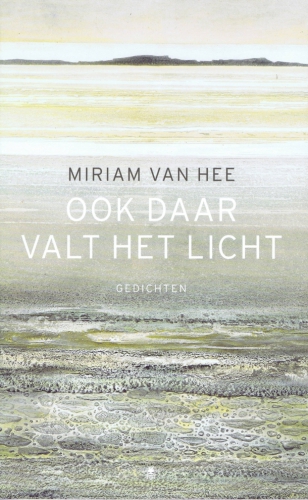
Le moment venu
ce serait beau, le moment venu
d’en avoir le désir, de sortir
dans le matin et si jamais nous
avions la force de nous risquer dans le bois
pour chercher un endroit où nous étions
jadis venus, couchés sur un rocher, nos regards
dominant un coude de la rivière
quelque chose allait survenir, un animal
nous apparaîtrait, que nul ne nous dérange
le moment venu, quand nous aurons enfin
résolu nos problèmes et serons libérés,
écoutons, entendons-nous déjà le murmure
de l’eau, ne connaissions-nous pas un peu le monde
nous avions attendu la neige, attendu le
train, nous avions été en retenue, nous
avions grimpé, nous nous étions perdus
on nous avait trouvés, donc, le moment
venu, prenons les sentiers battants
plutôt que les battus, sans nous retourner, toujours
il y aura quelque chose de connu, la terre meuble
qui s’enfonce sous les pins, c’est ce que nous aimions
Eens zover
het ware mooi, als het eens zover is
om ernaar te verlangen, naar buiten
te gaan in de ochtend en mochten wij
sterk genoeg zijn om het bos in te durven
op zoek naar een plek waar wij vroeger
al waren, wij lagen er toen op een rots
uit te kijken over een bocht in de rivier
iets stond te gebeuren, een dier zou zich
aan ons vertonen, laat niemand ons storen
als het een zover is en wij onze problemen
dan eindelijk opgelost hebben en vrij zijn,
laten wij luisteren of wij het water al horen
ruisen, wij wisten toch iets van de wereld
wij hadden gewacht op de sneeuw, op de
trein, wij waren nagebleven op school, wij
hadden geklommen, we waren verdwaald
we werden gevonden, dus, als het eens
zover is, laten wij de onzekere weg voor
de zekere nemen, niet omzien, er zal altijd
iets zijn dat we herkennen, de meegaande
grond onder de dennen, daar hielden we van
Miriam Van hee
(Ook daar valt het licht, 2013, traduit du néerlandais par Philippe Noble)