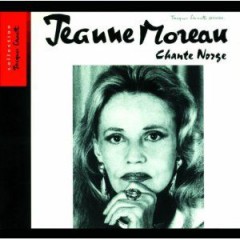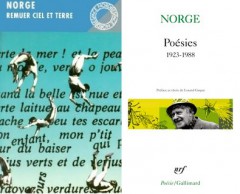« Lorsque des familiers de Norge se donnent la joie de révéler son œuvre à des amis qui l’ignorent encore, ils se trouvent tellement habités par leur sujet qu’ils cherchent à tout dire à la fois du poème et du poète. » Ainsi commence l’introduction de Jean Tordeur au gros volume des Œuvres poétiques (1923-1973) de Norge publiées chez Seghers en 1978.

Je suis parfois surprise que de grands écrivains belges de langue française, comme Marie Gevers dont j’ai parlé récemment, soient inconnus hors de Belgique, même de nom. Est-ce dû à cet étiquetage fallacieux de littérature « francophone » qui pose une frontière entre la littérature française de France et celle d’ailleurs ?
Né à Bruxelles, Georges Mogin dit Géo Norge (1898-1990), d’abord voyageur de commerce, – dans le textile et non le bois, comme Marcel Thiry, autre poète marchand – a passé la seconde moitié de sa vie en France, dans le Midi, où il s’est installé définitivement comme antiquaire à Saint-Paul de Vence. Bruxelles, le Hainaut, l’Ardenne, le paysage méditerranéen l’ont inspiré, mais surtout le langage, son royaume.
Dans ses Œuvres poétiques, le tout premier poème annonce la couleur : Norge joue avec les mots, le rythme, mêle humour et sérieux, sentiments et saveurs.
La pêche du poème
Leurre comme tout et tous
mais je goûte quand même
belle,
la belle tentation de dire.
O, si confusément tiré des limbes
cérébraux : poème :
poisson un peu étrange
et féerique à travers
les rutilances de l’aquarium
et le cohue de l’eau.
Scintille et sois né !
Or, voici la phrase – illusion optique –
si fièrement et drôlement indigente
et non dite.
(27 Poèmes incertains, 1923)
De petits traits au crayon, des croix, marquent dans la table des matières de ce gros recueil tout blanc les poèmes les plus souvent relus. C’est sur ces traces que je vous entraîne – que dire d’un poète sinon de se mettre à son écoute ?
Réveil
Le petit jour poreux
qui efflue,
réhabite
nos vitreuses pensées
On s’entoge encore une fois
du faux habit de soi-même.
On replâtre le masque d’hier
à ce visage trop frileux
de sa nudité.
On reprend sa vie – pliée
sur un fauteuil
au pied du lit –
comme un vêtement qu’on soigne.
On inventorie la risqueuse
monnaie des paroles qu’il faudra dire,
la trouble marchandise
des gestes qu’il faudra faire.
Pour demeurer la dupe
de son signalement.
Et chacun trouve naturel
de n’être pas devenu
un autre.
(Plusieurs malentendus, 1926)
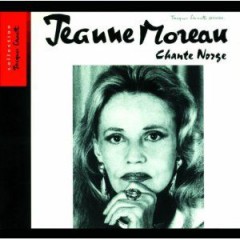
http://www.musicme.com/#/Norge/albums/Jeanne-Moreau-Chante-Norge-5060281616180.html
Jeanne Moreau a chanté Norge. Plus d’un poème chante ou se dit chanson : chansons gaies, chansons graves, aux titres terre à terre ou plus secrets. Vers courts et vers longs, vers libres, poèmes en prose, hors des modes et des conventions en tous genres.
Les pigeons
Les paroles de Lucie, c’était comme un lâcher de pigeons. De pigeons blancs. Je les regardais monter dans le bleu du ciel ; la lumière jouait sur leurs plumes. Par trois, par six, par dix, ils tournaient, ils filaient dans toutes les directions. Et ces mouvements d’ailes ! – Alors, vous ne répondez pas ? dit-elle. Moi, j’admirais, j’étais charmé. Comment ? Il fallait écouter aussi ! Et répondre.
(Les Oignons, 1956)
Servez-vous au buffet : sa poésie est diverse. Pour faire connaissance avec Norge, Remuer ciel et terre est une bonne anthologie de poche. Rappelez-vous : Colo vous en a proposé quelques poèmes et les a même traduits en espagnol, à relire sur Espaces, instants. Vous trouverez Norge aussi en Poésie/Gallimard.
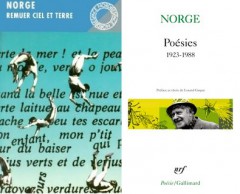
Pour finir
Le savez-vous, chez ce peuple d’oiseaux,
La mode fut qu’on se coupât les ailes ;
Pourquoi de l’aile, on ne volait plus guère,
On mangeait trop et l’on marchait si peu
Que pour finir on se coupa les pattes.
Quant à chanter, le fait devint si rare
Que pour finir, on se coupa la gorge.
(Bal masqué parmi les Comètes, 1972)
 Dans l'eau du temps qui parle à petits mots
Dans l'eau du temps qui parle à petits mots