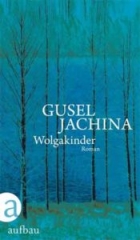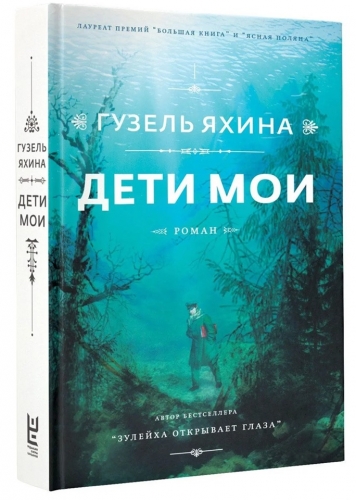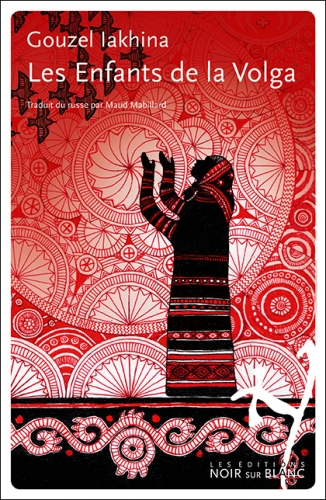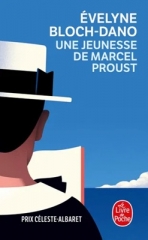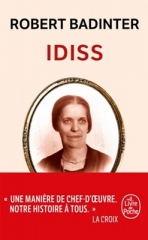Et l’improbable devint réalité. Sous ce titre, Sylvie Leemans raconte « 40 ans de vie communautaire » aux Fraternités du Bon Pasteur à Bruxelles. Elle a fait partie du noyau fondateur de cette communauté chrétienne originale et en présente toutes les facettes à travers un regard personnel – un témoignage de première main.

Photo © FBP
Je n’habitais plus à Woluwe Saint Pierre quand Le Bon Pasteur de la rue au Bois, un vaste domaine de plus de sept hectares, avec un très beau parc, est passé en 1985 d’une congrégation qu’on appelait « les Sœurs du Bon Pasteur » à un petit groupe de chrétiens « porteurs d’un projet de vie communautaire ». Dans l’ex-« Manoir d’Anjou », les religieuses accueillaient des jeunes filles issues de familles en difficulté ou des orphelines de guerre. Nous les voyions parfois à la messe de Ste Alix, la paroisse de ma jeunesse. Quelques fois, j’ai accompagné la classe dont j’étais titulaire au Bon Pasteur pour une retraite. J’étais curieuse de découvrir l’histoire et le fonctionnement de la communauté actuelle de l’intérieur.
La presse avait rendu compte à l’époque de ce changement de propriétaire qui avait donné la priorité à un projet de vie chrétienne ; les religieuses avaient résisté aux offres alléchantes des promoteurs immobiliers. Fraternité, prière partagée et ouverture aux plus démunis étaient au cœur de ce projet de vie collective d’un nouveau style. Licenciée en criminologie, Sylvie Leemans travaillait dans le secteur de l’aide à la jeunesse quand elle a croisé ces « rêveurs » désireux de fraterniser, sans savoir encore qu’elle allait vivre 38 ans de vie communautaire au Bon Pasteur.
C’est l’objectif premier de son livre : « partager le « fabuleux » de la vie communautaire » sans en nier les difficultés, donner à d’autres l’envie de se lancer dans une forme d’habitat groupé, chrétien ou non – une formidable aventure humaine. Tous les habitants y sont locataires de leur logement. En plus des « communautaires » (adultes engagés de tout âge), le domaine comporte des logements de transit pour personnes fragilisées, une colocation de six jeunes travailleurs (Koté jardin), un kot de dix étudiants, des logements loués avec des baux limités dans le temps.
Ces espaces ont été aménagés peu à peu, bénévolement, « par les futurs occupants et leurs réseaux », avec un objectif de vie simple dans la belle nature du domaine. Un des choix fondamentaux était d’habiter des logements indépendants, de fraterniser à certains moments dans des espaces communs, d’être autonome et indépendant financièrement, tout en faisant vivre le projet des Fraternités.
Charte des Fraternités du Bon Pasteur, pratiques spirituelles, accueil, partages, engagement, fêtes, tâches… Tous les aspects de cette communauté qui relie des personnes aux situations différentes (célibat, mariage, famille, vie religieuse, prêtrise) et aux implications diverses sont abordés. Sylvie Leemans décrit cette aventure humaine sans l’enjoliver pour autant. Cela demande organisation et disponibilité. Comme dans tout groupe, des jeux de pouvoir et des conflits doivent être surmontés. En communauté aussi, on s’engage « pour le meilleur et pour le pire ».
Beaucoup de questions sont posées, comme « est-il raisonnable d’espérer que chacun apporte tout ce qu’il peut, tout ce qu’il est dans la construction commune ? » L’habitat partagé confronte forcément aux différences entre les êtres humains, c’est un défi à relever en permanence. Certaines pratiques fragilisent le groupe, d’autres le ressoudent. Il y a des périodes fastes et des périodes creuses, des temps de remise en question.
J’ai apprécié l’honnêteté intellectuelle de Sylvie Leemans, amie d’une amie, dans la description et sa réflexion nuancée sur ce vécu au Bon Pasteur. Son respect des visions différentes, sans masquer la réalité des difficultés qui surgissent. Son désir de laisser une trace de ce qui fut et de l’évolution sur quatre décennies, ce qui peut être utile aux autres dans le futur. Au-delà de ce projet particulier, Et l’improbable devint réalité peut intéresser ceux qui souhaitent vivre en colocation ou en habitat partagé, groupe ou communauté. N’est-ce pas, finalement, une belle façon de réfléchir sur la manière dont on peut vivre sa vie en paix avec les autres, tout en veillant au bien commun ?