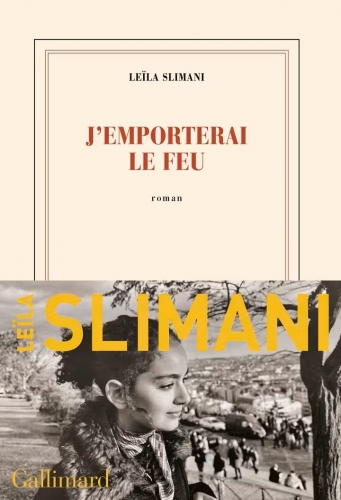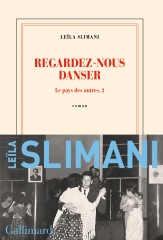Premier titre lu dans la collection « Ma nuit au musée », Le parfum des fleurs la nuit est un texte de Leïla Slimani plus personnel que Le pays des autres où elle raconte l’histoire de sa famille. Elle parle ici d’abord de l’écriture, sa passion, de son bureau où le besoin de s’isoler engendre refus (dire non aux sollicitations) et renoncement : « L’écriture est discipline. Elle est renoncement au bonheur, aux joies du quotidien. On ne peut chercher à guérir ou à se consoler. On doit au contraire cultiver ses chagrins comme les laborantins cultivent des bactéries dans des bocaux de verre. »

Felix Gonzalez-Torres, “Untitled” (Blood), 1992 ; “Untitled” (7 Days of Bloodworks), 1991,
Vue de l’exposition « Luogo e Segni », Punta della Dogana, Venise, 2019 : Collection Pinault.
Courtesy Felix Gonzalez-Torres Foundation Cappelletti © Palazzo Grassi.
Photo Delfino Sisto Legnani et Marco
Elle a tout de même accepté de rencontrer une éditrice, en décembre 2018, se promettant d’être intraitable pour préserver l’écriture d’un roman en cours. Mais elle dit oui à sa proposition : être enfermée une nuit dans un musée à Venise. La Douane de mer est devenue un musée d’art contemporain, ce n’est pas ce qui l’intéresse, mais bien « l’idée d’être enfermée », sans doute « un fantasme de romancier ». Leïla Slimani cite les écrivains qu’elle aime et chez qui elle retrouve ses propres obsessions, comme Virginia Woolf écrivant dans son Journal : « J’ai posé à la malade imaginaire et tout le monde me laisse tranquille. »
« Ce que l’on ne dit pas nous appartient pour toujours. Ecrire, c’est jouer avec le silence, c’est dire, de manière détournée, des secrets indicibles dans la vie réelle. La littérature est un art de la rétention. » Evoquant Le monde d’hier de Stefan Zweig, elle se demande ce qu’il aurait pensé de notre époque « où toute prise de position vous expose à la violence et à la haine, où l’artiste se doit d’être en accord avec l’opinion publique ».
En avril 2019, Leïla Slimani, qui n’a rien à raconter sur l’art contemporain et ne tient pas à répéter tout ce qui a déjà été écrit sur Venise, observe les gens, l’afflux des touristes qui a réduit la population des Vénitiens de moitié en trente ans, « comme des Indiens dans une réserve, derniers témoins d’un monde en train de mourir sous leurs yeux ». Elle se souvient de ses voyages au Japon, en Inde. A la Douane de mer, le gardien la conduit au petit lit de camp installé dans « une salle où sont exposées des photographies de l’Américaine Berenice Abbott. » « Buena notte ».
La voilà prise au piège dans un endroit où les fenêtres ne s’ouvrent pas, où il est interdit de fumer : pourquoi a-t-elle accepté ? A un ami qui jugeait l’exercice « assez snob », elle a parlé d’une « sorte de performance », d’une expérience. Mal à l’aise dans ce musée, elle écrit sur ses peurs, peut-être héritées de sa mère inquiète de tout, avoue sa peur des hommes « qui pourraient [la] suivre ». Dans le milieu où elle a grandi, les livres étaient plus présents que l’art, même si ses parents s’intéressaient aux peintres contemporains marocains et si son père peignait des toiles mélancoliques à la fin de sa vie. Elle se souvient de ses premières visites au musée à Paris, d’un voyage en Italie avec un ami.
Avec le fascicule de l’exposition en cours, « Luogo e Segni » (« Lieu et signes »), elle regarde les œuvres, s’intéresse aux artistes, s’interroge sur l’art conceptuel. « Le rideau » en billes de plastique rouge sang de Felix Gonzales-Torres, mort du sida, lui rappelle celui de l’épicier de son enfance et la ramène à son obsession du corps, de la déchéance, de la douleur. Au centre du musée, voici l’installation de Hicham Berrada qui lui a inspiré le titre : un galant de nuit appelé aussi « mesk el arabi » qu’elle aperçoit dans des terrariums à travers des vitres teintées, « plante familière, chantée par les poètes et tous les amoureux », la plonge dans les réminiscences. « A Rabat, il y avait un galant de nuit près de la porte d’entrée de ma maison. » Son parfum, que son père respirait par la fenêtre ouverte le soir, « ne cessait de l’émerveiller. »
« Je m’appelle la nuit. Tel est le sens de mon prénom, Leïla, en arabe. Mais je doute que cela suffise à expliquer l’attirance que j’ai eue, très tôt, pour la vie nocturne. » « Le galant de nuit c’est l’odeur de mes mensonges, de mes amours adolescentes, des cigarettes fumées en cachette et des fêtes interdites. C’est le parfum de la liberté. » Pourquoi s’être enfermée là ? Pour écrire sur sa jeunesse, sur son parcours, ses choix, ses lectures ?
Les œuvres commentées par Leïla Slimani sont celles qui renvoient à quelque chose en elle, qui activent sa mémoire, qui réveillent des « fantômes du passé », celui de son père en particulier. « En disparaissant, en s’effaçant de ma vie, il a ouvert des voies que, sans doute, je n’aurais jamais osé emprunter en sa présence. » Elle évoque sans préciser sa déchéance sociale et son incarcération. « Ce qui est arrivé à mon père a été fondateur dans mon désir de devenir écrivain. » Il lisait beaucoup. « Il était ma famille mais il ne m’était pas familier. »
Le parfum des fleurs la nuit, récit d’une nuit dans un musée d’art contemporain, est surtout l’histoire d’un rendez-vous de Leïla Slimani avec elle-même, un texte sur sa vie en même temps qu’une réflexion sur l’enfermement, la solitude, la création littéraire. J’ai aimé la franchise avec laquelle elle aborde son sujet, sans se soucier des conventions.
 « Une femme accroupie, ses sacs de courses posés par terre, cherchait un album pour une petite fille. Un vieux monsieur qui s’appuyait sur son parapluie expliqua au libraire qu’il voulait offrir des classiques pour Noël. « Parce que ça fait toujours plaisir. » A la caisse, une jeune femme dans un manteau beige écrivait un mot sur la première page d’un roman. Ce spectacle le rendit heureux et il aurait pu tous les embrasser. Mehdi se fraya un chemin entre les rayons. Il avait trop chaud à présent dans son manteau et il transpirait dans ses bottines fourrées. Il avait envie de tout acheter, des romans et des essais, des livres d’histoire et même des recueils de poésie. Il s’imaginait une vie où il aurait le temps de lire tous ces livres, une vie qui n’aurait pas d’autre but que de pénétrer l’âme des autres et où les voyages seraient immobiles. C’était ça le problème, se dit-il, cette impossibilité à choisir une existence, à s’y tenir, ce désir persistant d’une autre vie que la sienne. Il se retrouva devant le rayon des actualités. Sur une table, il aperçut ce qu’il cherchait. Une pile d’exemplaires de Notre ami le roi qui était interdit au Maroc mais dont tout le monde parlait. »
« Une femme accroupie, ses sacs de courses posés par terre, cherchait un album pour une petite fille. Un vieux monsieur qui s’appuyait sur son parapluie expliqua au libraire qu’il voulait offrir des classiques pour Noël. « Parce que ça fait toujours plaisir. » A la caisse, une jeune femme dans un manteau beige écrivait un mot sur la première page d’un roman. Ce spectacle le rendit heureux et il aurait pu tous les embrasser. Mehdi se fraya un chemin entre les rayons. Il avait trop chaud à présent dans son manteau et il transpirait dans ses bottines fourrées. Il avait envie de tout acheter, des romans et des essais, des livres d’histoire et même des recueils de poésie. Il s’imaginait une vie où il aurait le temps de lire tous ces livres, une vie qui n’aurait pas d’autre but que de pénétrer l’âme des autres et où les voyages seraient immobiles. C’était ça le problème, se dit-il, cette impossibilité à choisir une existence, à s’y tenir, ce désir persistant d’une autre vie que la sienne. Il se retrouva devant le rayon des actualités. Sur une table, il aperçut ce qu’il cherchait. Une pile d’exemplaires de Notre ami le roi qui était interdit au Maroc mais dont tout le monde parlait. »