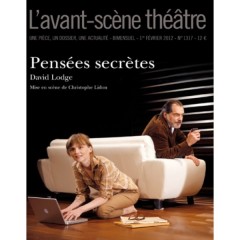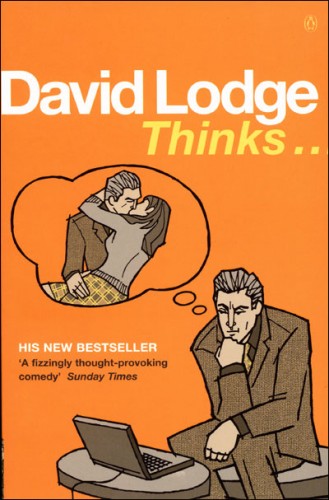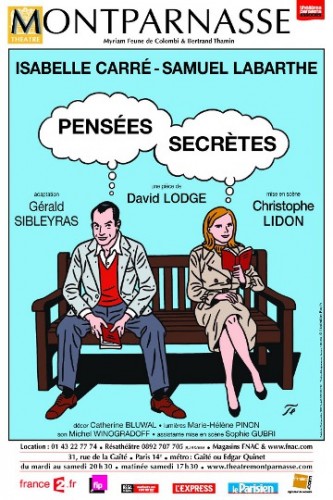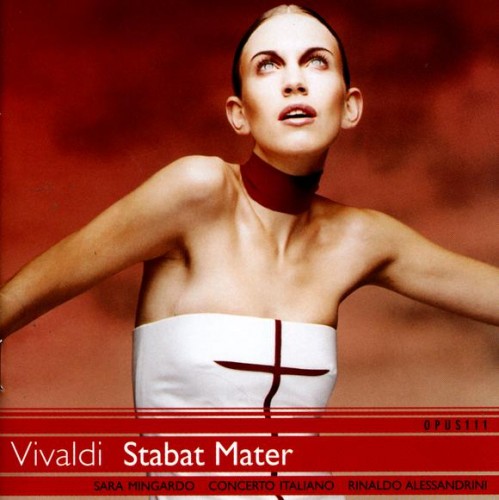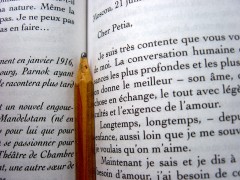4 mars 2013 : cette fois, ça y est, le ciel est d’humeur printanière, d’azur parfait, et la gelée sur les toits à peine fondue, on sort les chaussures de marche pour en profiter. Je vous ai déjà parlé du parc Josaphat, le plus proche de chez moi.
Cette fois, balade au parc de Laeken, on peut y accéder juste en face du Château de Laeken et de ses magnifiques serres, lieu de réceptions royales et résidence privée du prince Philippe. Nos souverains Albert II et Paola habitent juste à côté, au Château du Belvédère entouré de beaux jardins.
Peu de promeneurs un lundi matin – une pensée pour tous ceux qui ont repris le travail après un week-end sans pluie mais encore frisquet. Un monument attire les regards en haut de l’allée, le mémorial Léopold Ier autour duquel le parc a été aménagé puis ouvert aux Bruxellois dès 1880, quelques années après sa création. La flèche néo-gothique du monument se voit de loin – de ma terrasse, le la vois qui pointe à l’horizon non loin de l’Atomium.
La statue en pied du premier roi des Belges, sous la flèche, est entourée de neuf colonnes surmontées d’allégories correspondant aux neuf provinces du pays (en 1995, le Brabant a été scindé en deux, Brabant wallon et Brabant flamand, ce qui nous en fait dix à présent). Je ne vous le montre que de loin, vu les barrières métalliques qui l’entourent pour l’instant, protection du monument ou des passants, je ne sais – des pierres s’en sont déjà détachées.
Au nord de Bruxelles, ce parc à l’anglaise, avec ses vastes pelouses et ses arbres remarquables, est agréablement vallonné, ce qui donne de beaux points de vue, vers l’Atomium ou vers la ville.
Des clôtures en châtaignier protègent certaines zones du parc où des lapins se réfugient dans leur terrier dès qu’on approche, tandis que d’autres, immobiles au soleil, jouent les invisibles, ignorant qu’ils sont trahis par leur postérieur blanc.
Pies et corneilles se disputent un coin de feuilles mortes, des perruches vertes signalent bruyamment leur présence, vite repérées dans les ramures des arbres qui bourgeonnent. Partout des taupinières dans les pelouses du parc, c’est à cette saison que les taupes restaurent leurs galeries, après les gelées de l’hiver. Dans quelque temps, elles attireront moins l’attention que les jonquilles qui foisonnent sur certaines pentes, cela promet.
Dans le bas du parc, la jolie chapelle Sainte Anne, toute blanche, a été attribuée au culte orthodoxe russe. Une autre résidence royale, non loin de là : le château du Stuyvenberg où réside la reine Fabiola depuis la mort du roi Baudouin. Sur le chemin du retour, la vue sur le monument Léopold Ier est encore plus belle, dans son entourage de verdure.
Les lions d’Adolphe Fassin ont fière allure près des grilles du Château de Laeken. Le long de l’avenue du Parc royal, où le trafic est incessant, les clochettes des perce-neige mettent de la lumière dans le lierre couvre-sol.
Une dernière photo, avant de rentrer, pour le pittoresque Pavillon Chinois dans son beau jardin, qui cache le Musée d’art japonais situé juste derrière.
Autour du parc public de Laeken et du domaine royal (accessible uniquement lors de l’ouverture des serres, cette année du 19 avril au 12 mai), d’autres jardins font de Laeken une belle étape de la Promenade Verte autour de Bruxelles.