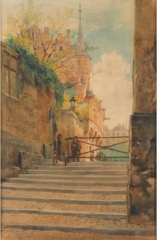Une première secousse avait ébranlé certains lecteurs & lectrices en juin dernier, en lisant ce qu’un président de parti, après sa victoire aux élections, déclarait dans La Libre Belgique : « On va gérer le pays comme des ingénieurs, pas comme des poètes. » La petite phrase avait provoqué une série de réponses, du monde culturel et des ingénieurs eux-mêmes, et pas seulement dans « mon » journal.

Maurice Wagemans (1877-1927), La lecture sur le pont
Et voici que le porte-parole de ce même parti, s’exprimant « à titre personnel » dans le même journal, le 9 mars dernier, signe une opinion dont le titre et le chapeau révèlent clairement l’intention. Je les cite : « La culture ne devrait pas grimper par subsides, mais s’élever par plébiscite. » « Laisser la culture s’autoréguler n'est pas une menace, c’est une nécessité. Car si personne ne veut d’un spectacle, d’un film ou d’une exposition, pourquoi forcer son existence à coups de subventions publiques ? » Bien que le texte commence par une belle déclaration (« La culture a sauvé ma vie »), on reste très dubitatif en le lisant, aussi par rapport à cette affirmation finale : « Ceux qui méritent de briller n’ont pas besoin de tuteurs : ils s’élèvent par eux-mêmes. Vive la culture, et vive la liberté. »
Depuis lors, des voix qui comptent dans le secteur culturel se font entendre dans les pages « Débats » du journal. Le 12 mars, Jean-Marie Klinkenberg, membre de l’Académie royale de Belgique, a répondu par une opinion intitulée « Culture libératrice ou culture libertarienne ? » : « Je ne puis certes témoigner que de quelques modestes expériences de la "culture subventionnée" de ce pays : dix années à la Commission d’aide à l’édition, vingt autres à la Commission des lettres, quarante au Conseil de la langue française. Toutes charges exercées bénévolement, à titre de service à la communauté, en marge de ma carrière de chercheur. »
S’inquiétant d’une « révolution culturelle » du côté américain, Klinkenberg observe qu’elle a aussi commencé chez nous. Ceux qui opposent « la culture qui sait se vendre et une culture élitiste déconnectée du réel » vont dans la même direction. « Il est temps de nous opposer, à notre niveau, à un mouvement dont l’aboutissement, l’histoire nous l’a appris, est l’abolition du savoir, de la culture et, in fine, de la vraie liberté : non celle de quelques-uns, mais celle de toutes et tous. »
La philosophe Pascale Seys, dont je vous ai déjà parlé ici, a écrit une carte blanche le 17 mars : « Défendre la culture, armer l’avenir ». Elle y rappelle que « L’argument selon lequel l’impôt ne devrait pas soutenir des œuvres qui ne correspondent pas aux préférences du grand nombre va totalement à l’encontre de la culture en tant que bien commun. » Comment ne pas acquiescer à ceci : « L’avenir s’invente dans la palpitation des idées et des cœurs, par l’art et par les œuvres qui nous élèvent, qui nous rassemblent, et qui donnent à nos existences un horizon de désir et d’espérance. »
La ministre-présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles et ministre de la culture (un ministère vraiment nécessaire ? avait aussi osé le parti dont il est question), Élisabeth Degryse, a précisé dans un entretien du 21 mars : « La qualité d’un spectacle ne se mesure pas à l’applaudimètre, mais des indicateurs chiffrés pourraient être pris en compte. » Elle rassure : « Le soutien public à la culture est, reste et restera essentiel. »
Pour terminer ce billet sur un sujet qui me tient à cœur, vous le savez, je reprends encore quelques propos de Bernard Foccroulle, organiste et compositeur, qui a été successivement directeur de la Monnaie et du Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence. Lui aussi s’inquiète des discours pernicieux qui se répandent : « Au cœur de la culture, il y a l’art, et au cœur de l’art, il y a la poésie, à laquelle j’ajouterai la notion de complexité – infinie – le tout procédant fondamentalement par interaction. En cela, la culture est totalement étrangère au consumérisme – dont l'emblème superlatif est le selfie au musée, pris devant l’œuvre à laquelle on tourne le dos ! Et pour que la société puisse aller à la rencontre de la culture, les projets participatifs sont essentiels. »
« Et c’est là que le pouvoir agissant de la poésie refait surface. […] Alors, qu’est-ce qui définirait cette "poésie" ? Il me semble que c’est tout à la fois un certain "regard" sur les choses et les gens, une forme de quintessence, une invitation à la contemplation et à l’intériorisation. À travers leurs œuvres, ces grands artistes convoquent la part de poète qui se trouve en chaque être humain. La poésie me semble indissociable de notre humanité. » (La Libre Belgique, 24/3/2025)
***
Sur le calendrier de mars, les résultats d’un dépistage ont tout à coup semé de multiples rendez-vous, en ont annulé d’autres. L’opération est pour après-demain. Je vous reviens dès que possible.
En attendant, comme dit l’Augustin, lisez bien.
Tania