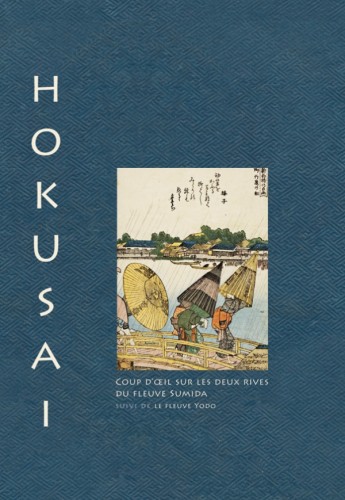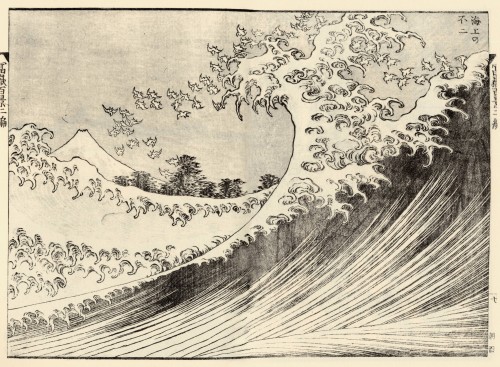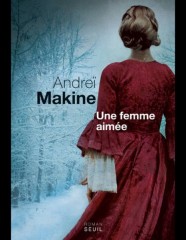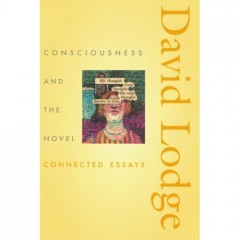Une femme aimée (2013) d’Andreï Makine, inspiré par Catherine II de Russie (1729-1796), raconte le rêve d’un jeune cinéaste : Oleg Erdmann veut rendre son humanité à cette femme trop souvent réduite à deux mots, le pouvoir et le sexe.

Portrait de Catherine par Louis Caravaque en 1745
Un grand miroir qui s’abaisse, « telle une fenêtre à guillotine », entre le salon blanc et or où l’impératrice reçoit ses invités de marque et l’alcôve où elle rejoint ses amants, voilà le point de départ de son scénario. Oleg veut tout savoir d’elle, et ses amis le taquinent : il y aura de la matière pour « une série télévisée de trois cents épisodes et demi ! »
Dans l’appartement communautaire où il a sa chambre, son amie Lessia se moque elle aussi de la fascination d’Oleg pour « la Messaline russe » redevenue pour lui« une petite princesse allemande qui regardait la neige tomber sur la Baltique ». Oleg voudrait montrer une femme et son « impossibilité d’être aimée ».
Quand il a parlé de son projet à son vieux professeur, celui-ci a tenté de l’en détourner – trop ardu, trop coûteux, trop délicat. Mais Oleg continue à imaginer des scènes : le double examen imposé aux favoris, chez le médecin d’abord, puis avec la comtesse Bruce qui s’assurait de leur virilité. Au-dessus de son lit, des listes : le bilan de ses bienfaits dressé par Catherine II elle-même en 1781, la chronologie de son règne (1762-1796), la liste des amants qui ont « duré », les montants des récompenses octroyées.

Portrait de Catherine II par Levitsky en 1794
Pour gagner « son minimum vital et du temps pour écrire », Oleg travaille aux abattoirs de Leningrad une nuit sur trois. Jourbine, un jeune comédien, comme lui un provincial qui se débrouille avec la pauvreté, lui a trouvé ce travail. Erdmann porte un nom qui attire les sarcasmes, on le traite de « mutant russo-allemand », de « paysan de Sibérie ». Mais à sa grande surprise, il y a un an (en 1980), son premier court-métrage a plu au Ministère de la Défense et ce succès inattendu lui a valu l’amour de Lessia.
Le meurtre de Pierre III par les favoris de son épouse est le premier des nombreux épisodes où sexe et violence tissent le destin de la grande Catherine. Lessia, qui s’éloigne d’Oleg peu à peu, suggère un jour que « ce qui serait intéressant à filmer, c’est ce que Catherine n’était pas… », les instants de sa vie « qui la rendaient à elle-même » : cette femme « n’était pas qu’une machine à signer des décrets, à écrire à Voltaire, à consommer des amants… »
« L’Histoire régie par la soif de domination et le sexe » : il ne manque pas d’éléments pour nourrir cette vision, des accès de sensualité que Catherine note dans son journal de petite princesse jusqu’aux frères Zoubov, les amants de la fin de son règne. Bassov, l’ancien professeur d’Oleg, s’intéresse vraiment à son scénario, mais l’incite à la prudence devant le Comité d’Etat.

Tenture de Philippe de Lasalle, réalisée pour le palais de Catherine II de Russie
à St Petersbourg, autour de 1775, soie, 186 x 76,5 cm (© Clichés Prelle)
Lourié, l’historien expert du jury, met le doigt sur des erreurs concernant les monnaies en cours au XVIIIe siècle. Les membres du Comité ricanent, satisfaits. Et puis Lourié évoque de plus en plus librement Catherine II, et Oleg comprend sa stratégie : attirer l’attention sur des détails inexacts pour que le jury ne s’attarde pas sur les « choses politiques risquées ». Et cela réussit. La réalisation est confiée à Mikhaïl Kozine, Erdmann sera son « assistant artistique ».
Dina, l’actrice qui joue la jeune Catherine II, se jette dans les bras d’Oleg après sa rupture avec Lessia. Eva Sander jouera la « vieille » Catherine II, l’Allemande se montre vraiment sensible à sa vision de l’héroïne. Pas tout de suite, pas encore à Peterhof où ils se rencontrent pour la première fois et dont il gardera l’image d’une « inconnue qui marchait sous les arbres blanchis par le givre. »
Au milieu du roman, Makine passe des années 80 aux années 90. Leningrad s’appelle à nouveau Saint-Pétersbourg. Oleg se rétablit d’un coup de couteau dans le ventre reçu lors d’une attaque contre le journal qui l’emploie. Dina vit de spots publicitaires. Kozine est devenu un de ces clochards ivres qui traînent dans le métro.

Portrait d'Alexandre LanskoÏ par Levitsky en 1780
Oleg lit encore tout ce qui éclaire la personnalité de Catherine II et s’attache en particulier au seul qui l’ait vraiment aimée, le comte Lanskoï – « une parenthèse de douceur ». Resté plus de quatre ans auprès de la tsarine, de 1780 à 1784, il ne l’a jamais quittée, c’est la mort qui les a séparés. Avec Eva Sander, le jeune cinéaste avait parlé de ce rêve qu’ils avaient dû avoir, de partir à deux loin de la cour pour un « voyage secret à travers l’Europe », en Italie peut-être – ce que quasi rien n’atteste.
Pour manger, Oleg vend ses livres, l’un après l’autre. Puis il tombe très malade. Au printemps, lors d’une première promenade après sa convalescence, il est bloqué avec d’autres passants par des gardes du corps qui barrent le trottoir pour un « play-boy » et une jeune femme blonde qui embarquent dans une grosse voiture. Oleg reconnaît Jourbine, l’ami d’autrefois, et celui-ci le fait monter avec eux. Il a fait fortune dans les affaires, possède plusieurs restaurants, et il vient d’acheter un studio de cinéma.
Son « méga-projet » ? Tourner une série télévisée sur Catherine II, « pas la momie qu’on découvre dans les livres d’histoire », une Catherine « dépoussiérée, une bombe qui nous explose à la figure ! » A Oleg de se débrouiller avec les excès de Jourbine qui veut « un bon divertissement » axé sur les aspects les plus racoleurs de l’histoire, mais sans mensonges gratuits. Et voilà le scénariste cette fois du côté de ceux qui gagnent beaucoup d’argent, disposent d’un bel appartement – la série a beaucoup de succès – et d’une liberté toute nouvelle. Cela durera-t-il ?
Une femme aimée parle d’une grande figure historique, par épisodes vifs et précis : une femme que Makine a « humanisée » alors que l’histoire, dit-il , l’a « cannibalisée ». Mais aussi de la Russie, des conditions de vie avant et après la chute du Mur. Poussé par Jourbine, Oleg ira rencontrer à Berlin le réalisateur d’un film érotique sur la tsarine, mais c’est avec Eva Sander dont il va pousser la porte qu’il partagera son rêve le plus fort.