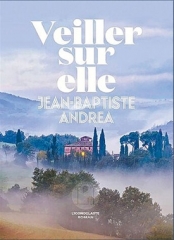Heureux hasard : j’étais en train de lire enfin, quarante ans après leur publication, Vies minuscules de Pierre Michon (°1945) – et le voilà interrogé sur son dernier opus par Augustin Trapenard à La Grande Librairie, mercredi dernier. De « Vie d’André Dufourneau » à « Vie de la petite morte », il sort du silence des vies de gens de la campagne, dans la Creuse, « des hommes et des femmes de son canton natal, des « pays » qu’il a connus ou dont l’existence lui a été rapportée par des proches » écrit Jean-Louis Tissier dans Géographie et cultures, qui analyse le livre sous l’angle de la « ruralité ».
D’abord Michon se souvient d’un jour de l’été 1947 où il était dans les bras de sa mère, « sous le grand marronnier des Cards », quand s’est avancé vers eux un inconnu qui s’est présenté : André Dufourneau. Bien des années auparavant, orphelin envoyé par l’assistance publique, il avait aidé les parents de la grand-mère de Michon, Elise, pour les travaux de la ferme et y était resté dix ans. Elise, « encore fille », s’était attachée à l’enfant et lui avait appris à lire et à écrire.
L’auteur ouvre une parenthèse : « Parmi les palabres patoises, une voix s’anoblit, se pose un ton plus haut, s’efforce en des sonorités plus riches d’épouser la langue aux plus riches mots. L’enfant écoute, répète craintivement d’abord, puis avec complaisance. Il ne sait pas encore qu’à ceux de sa classe ou de son espèce, nés plus près de la terre et plus prompts à y basculer derechef, la Belle Langue ne donne pas la grandeur, mais la nostalgie et le désir de la grandeur. » Recréant la scène, l’auteur révèle son grand amour : la Belle Langue. Il l’écrit un peu plus loin : « Mais parlant de lui, c’est de moi que je parle […] ».
On mesure en le lisant l’écart qui s’est creusé entre cette langue littéraire avec ses subjonctifs imparfaits, son vocabulaire recherché, au risque de paraître désuète ou précieuse, et celle qui s’écrit le plus souvent aujourd’hui dans les livres, plus proche de la langue parlée, plus simple. Racontant la vie de cet homme parti en Afrique, Michon dit sa confiance en la « langue-mère » qui lui donnerait « avec tous les autres pouvoirs, le seul pouvoir qui vaille : celui qui noue les voix quand s’élève la voix du Beau Parleur. »
A Mourioux, quand son petit-fils était malade ou inquiet, la grand-mère Elise allait chercher les « Trésors » pour le distraire : « deux boîtes de fer-blanc naïvement peintes et cabossées » contenant des objets « dits précieux », « de ces bijoux transmis qui sont mémoires aux petites gens ». Parmi eux, « la Relique des Peluchet », « une petite Vierge à l’enfant en biscuit », un « gri-gri ». A son tour, Pierre Michon déroule leur histoire dans « Vie d’Antoine Peluchet ». Faute de pouvoir raconter celle du père « inaccessible et caché comme un dieu » (son père est parti quand Michon avait deux ans), l’auteur donne vie ensuite à ses grands-parents paternels, Eugène et Clara, qui leur rendaient visite une fois par an après la disparition de leur fils.
Des souvenirs de pension alimentent les « Vies des frères Bakroot », le grand et le cadet. L’aîné « lisait des livres ». C’était le préféré du professeur de latin, chahuté, « que par antiphrase sans doute » ses élèves appelaient Achille. Celui-ci « n’avait pas de persécuteur plus impitoyable que le petit Bakroot. » Rémi s’intéressait davantage aux jeux, puis aux filles. De l’aîné, Roland, Michon écrit que « sa vie s’était fourvoyée dans les passés simples – je le sais, pour être lui » ; du cadet, qu’il était « le contemporain des choses ». On suivra l’un des deux jusqu’au cimetière. Arrêtons-nous là, pour ne pas trop en dire, de ces Vies minuscules où « Vie de Georges Bandy », le sixième récit et le plus long, m’a paru le plus fort.
L’auteur est loin de se donner le beau rôle, qu’il narre ses amours ou les ivresses auxquelles le mène son rêve d’écrivain alors inaccompli. J’ai admiré la sensibilité avec laquelle il donne présence à ses personnages et son style qui rend avec justesse la sensation, le sentiment, le souvenir. J’ai cherché plus d’un mot dans le dictionnaire avant de reprendre le cours du texte, au phrasé hors du commun. Pierre Michon déploie les « Grands Mots » pour dire d’humbles destinées et y mêler sa propre quête, celle d’un homme obstiné à parer la vie de la Belle Langue.