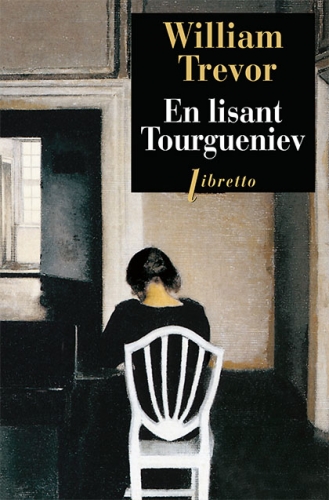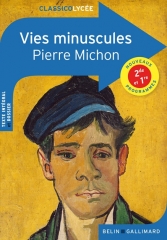En lisant Tourgueniev de William Trevor (traduit de l’anglais par Cyril Veken), retrouvé dans ma bibliothèque, porte en couverture un détail d’une peinture de Vilhelm Hammershoi (Les portes ouvertes) qui convient parfaitement au roman. J’avais quasi tout oublié de Marie-Louise, la fille cadette des Dallon, et de son mariage désastreux.
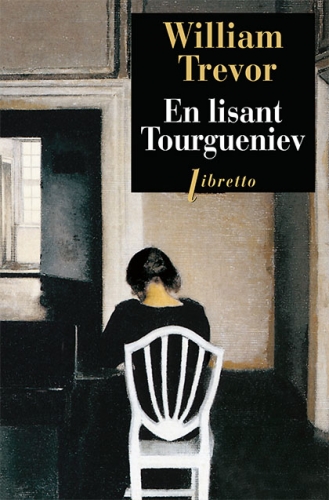
Le romancier irlandais nous introduit d’abord dans la salle à manger d’un asile où une femme de « cinquante-sept ans à peine, menue et d’apparence fragile, s’applique devant son repas », à la table où elle mange seule. Un visiteur est annoncé, Marie-Louise se force à finir son assiette pour avoir droit au parloir. Elle est déçue d’y trouver son mari qui cherche à la rassurer, l’établissement va devoir fermer : « Eh bien, toi, tu sais où aller. Tu n’as pas de souci à te faire. » – « Je croyais que ce serait peut-être Insarov. »
Le narrateur alterne de brèves scènes à l’asile où vit Marie-Louise et le récit de son destin conjugal, en flash-back. L’institutrice de l’école protestante avait eu dans sa classe la fille cadette des Dallon de Culleen, une famille pauvre. Et « presque une génération avant », Elmer Quarry, d’une famille bien connue en ville : lui et ses sœurs étaient les héritiers des Textiles Quarry sur Bridge Street. Ce célibataire de trente-cinq ans « était à des lieues à la ronde le seul protestant quelque peu nanti ».
Les Dallon et leurs enfants habitaient une ferme décrépite à quelques kilomètres du magasin. En janvier 1955, Elmer avait remarqué la jeune femme, « agréable à regarder », et invité Marie-Louise à l’accompagner au cinéma. Sa sœur Letty et son frère James n’étaient pas du tout favorables à cette relation entre leur sœur de vingt et un ans et « cet Elmer Quarry, incapable de rire, ce drapier né ! »
Mais ils s’étaient revus. Rose et Mathilde, les sœurs d’Elmer, qui l’aidaient au magasin et habitaient avec lui dans l’appartement à l’étage, l’avaient supplié en vain de ne pas épouser cette fille sans le sou. A son mariage, en septembre, Elmer avait félicité Mme Dallon pour le bon repas, ses sœurs n’avaient pas mangé grand-chose. L’institutrice, à la fête, se souvenait de la vivacité de Marie-Louise enfant, de ses bêtises : « elle était innocente ».
Pour leur lune de miel, Elmer a choisi l’Hôtel de la plage dans une petite ville du bord de mer. Une fois montée dans la chambre, Marie-Louise se sent pleine d’angoisse, consciente d’avoir fait « une erreur monumentale » en se mariant – « mais une fois la décision prise, à quoi bon réveiller des hésitations enfouies ? » Au dîner, on remarque l’œillet d’Elmer à la boutonnière, puis les mariés sortent pour une promenade. A la surprise de sa femme, Elmer propose alors d’aller boire un verre au pub, comme le leur a proposé un client de l’hôtel. Entraînés par l’un puis par l’autre, ils boivent trop et rentrent si engourdis qu’ils tombent immédiatement dans le sommeil.
Au retour, les sœurs d’Elmer expliquent à Marie-Louise le travail au magasin, ses tâches ménagères. Leur belle-sœur découvre un escalier dérobé qui conduit à deux greniers mansardés – un endroit qu’elle trouve rassurant pour y jouir d’un peu d’intimité. Si son amie Tessa n’était pas partie à Dublin, elle aurait pu lui parler de son malaise conjugal. Un an après le mariage, elle se réveille en larmes, ses espérances déçues. Elle voit comment sa mère, les clientes observent sa silhouette, sa mine. Elle n’est pas heureuse, mais ne se confie à personne.
« A quatorze ans, elle avait cru être amoureuse de son cousin à la santé fragile, et plus tard, de James Stewart » – « des enfantillages, à présent ». Sous le moindre prétexte, les sœurs Quarry ne cessent de la critiquer, elle et sa famille. Elles ne se doutent pas, quand elles voient leur frère sortir le soir pour aller à la salle de billard du Y.M.C.A., où il ne touchait jamais à l’alcool, qu’il se rend désormais dans le bar d’un hôtel, avec un voisin, et s’y fait servir du whiskey.
Le dimanche, Marie-Louise se rend d’abord régulièrement à la ferme, à bicyclette. Elle aime aller au hasard et se retrouve un jour devant l’allée qui mène à la maison de sa tante Emmeline, la mère de son cousin Robert. Tous deux l’accueillent chaleureusement. Robert est heureux de la voir, lui montre comment il vit, entre les soldats de plomb de son enfance et les livres. Passer du temps avec son cousin, chez lui ou au bord de la rivière, devient l’obsession de Marie-Louise : il lui a dit qu’il l’aime encore, ils se confient l’un à l’autre. Robert lui fait la lecture des livres de Tourgueniev qu’il aime.
En lisant William Trevor, vous découvrirez l’importance de ces retrouvailles que Marie-Louise garde secrètes ; elle se crée intérieurement une autre vie et prend ses distances avec les Quarry, avec tout le monde. Hélas, même si Elmer se montre toujours « gentil », le comportement étrange de sa femme, au mépris des convenances, va alimenter des rumeurs et la mener à l’asile.
Le romancier irlandais excelle à rendre les maladresses du couple, leur milieu, la férocité des sœurs, les remords des parents Dallon qui n’ont pas découragé ce mariage. Ce drame psychologique à découvrir est publié en anglais sous le titre Two Lives avec un autre roman court de 1991, Ma maison en Ombrie (déjà prêt sur la table de lecture).
 « Marie-Louise », murmure-t-elle en cette matinée qui suit l’arrivée inopinée de son visiteur. « Marie-Louise Dallon. Madame Querry, en fait. » C’est un homme âgé maintenant, et ses sœurs encore plus. Il a devant lui quoi ? une douzaine d’années, mettons quatorze ou quinze, mais les sœurs, elles, sont inusables. Il prend toujours en charge sa pension dans l’établissement de Miss Foye, comme depuis le premier jour. Il y a des années, les sœurs ont essayé de faire adresser la note à Culleen, mais son père n’avait pas les moyens. « Quel brave homme, votre mari ! » lui répète Miss Foye. Il faut dire qu’elles sont un certain nombre à n’avoir personne pour subvenir à leur pension : celles qui occupent les dortoirs collectifs dépourvus de tout confort, celles qui n’ont droit qu’à la vaisselle de tôle émaillée. Un brave homme, oui, qui s’est adonné à la boisson. Il n’y est pour rien, s’ils ont décidé de fermer ce genre d’institution. On regroupera les plus agitées, on leur trouvera un autre asile. Elle n’a jamais fait partie des agitées.
« Marie-Louise », murmure-t-elle en cette matinée qui suit l’arrivée inopinée de son visiteur. « Marie-Louise Dallon. Madame Querry, en fait. » C’est un homme âgé maintenant, et ses sœurs encore plus. Il a devant lui quoi ? une douzaine d’années, mettons quatorze ou quinze, mais les sœurs, elles, sont inusables. Il prend toujours en charge sa pension dans l’établissement de Miss Foye, comme depuis le premier jour. Il y a des années, les sœurs ont essayé de faire adresser la note à Culleen, mais son père n’avait pas les moyens. « Quel brave homme, votre mari ! » lui répète Miss Foye. Il faut dire qu’elles sont un certain nombre à n’avoir personne pour subvenir à leur pension : celles qui occupent les dortoirs collectifs dépourvus de tout confort, celles qui n’ont droit qu’à la vaisselle de tôle émaillée. Un brave homme, oui, qui s’est adonné à la boisson. Il n’y est pour rien, s’ils ont décidé de fermer ce genre d’institution. On regroupera les plus agitées, on leur trouvera un autre asile. Elle n’a jamais fait partie des agitées.