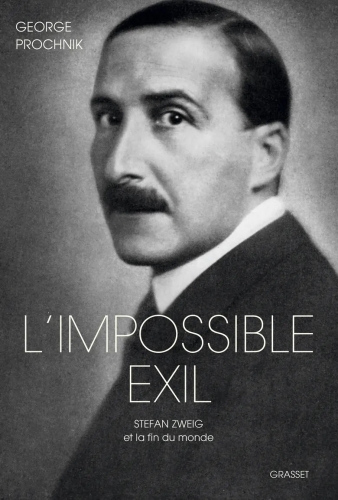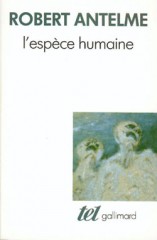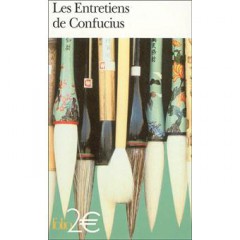Dans la littérature concentrationnaire, j’avais jusqu’à présent laissé de côté le témoignage de Robert Antelme (1917-1990). Pour présenter L’espèce humaine, le survivant du camp de travail forcé écrivait en 1947 : « Je rapporte ce que j’ai vécu. L’horreur n’y est pas gigantesque. Il n’y avait à Gandersheim ni chambre à gaz, ni crématoire. L’horreur y est obscurité, manque absolu de repère, solitude, oppression incessante, anéantissement lent. Le ressort de notre lutte n’aura été que la revendication forcenée, et presque toujours elle-même solitaire, de rester, jusqu’au bout, des hommes. »

© Linda Van der Meeren, Gegrift / Gravé
Robert Antelme appartenait au même groupe de résistants que Marguerite Duras, épousée en 1939. Elle échappe au guet-apens, aidée par Jacques Morland (François Mitterand), mais lui est arrêté et se trouve depuis le mois d’août à Buchenwald, dans un block affecté en majorité à des Français. Le premier octobre 1944, ils savent qu’ils vont partir – « C’était mauvais, on le savait, le transport » – une peur abstraite pour les nouveaux qui ne savent alors rien de l’histoire du camp : « Ignorants des fondements et des lois de cette société, ce qui apparaissait d’abord, c’était un monde dressé furieusement contre les vivants, calme et indifférent devant la mort. »
Une soixantaine d’hommes sont rassemblés dehors au lever du jour, on leur donne « un vêtement rayé bleu et blanc, un triangle rouge sur la gauche de la poitrine, avec un F noir au milieu, et des galoches neuves. » Rasés, propres, ils attendent des heures, avant de marcher jusqu’à la gare du camp, de s’entasser dans un wagon à bestiaux, pour une destination inconnue, « vers le Nord ».
Une fois arrivés à Bad Gandersheim, ils sont logés d’abord dans une vieille église transformée en grange. Là un nouveau tri : les spécialistes, puis ceux qui pourraient faire des corvées dans l’usine, puis les autres, comme lui, qui ne savent rien faire et qui travailleront dehors « à charrier des poutres, des panneaux, à monter les baraques dans lesquelles le kommando devait loger plus tard. »

© Linda Van der Meeren, Buchenwald
Là-bas, dans le monde des vivants, on se sait mortel, mais on travaille, on mange, on agit pour mettre cette certitude à distance. « Nous sommes tous, au contraire, ici pour mourir. C’est l’objectif que les SS ont choisi pour nous. Ils ne nous ont ni fusillés ni pendus mais chacun, rationnellement privé de nourriture, doit devenir le mort prévu, dans un temps variable. Le seul but de chacun est donc de s’empêcher de mourir. » Dans l’obscurité, quand on échappe à la surveillance, on ne fait rien. On rentre les mains dans les poches pour les réchauffer, jusqu’à ce qu’un kapo crie : « Hände !... (Les mains !) » – seuls les SS ont le droit de garder les mains dans leurs poches.
Antelme raconte le travail absurde – ils sont censés fabriquer des carlingues d’avions Heinkel –, les coups, les privations, la promiscuité, la faim, les poux… L’énorme machine nazie, malgré qu’elle s’y efforce tous les jours, ne peut pas « muter notre espèce », même quand « la figure et le corps vont à la dérive », même quand on est réduit à manger des épluchures. Il observe les comportements des uns et des autres, la solidarité, les vols – « il n’y avait que la haine et l’injure qui pouvaient distraire de la faim. »
Après « Gandersheim », deux cents pages environ sur trois cents, « La route » et « La fin » racontent la longue marche mortelle après l’évacuation du camp (les malades, à qui on promet l’hôpital, seront assassinés dans un bois) puis le train vers Dachau, et enfin, leur libération. Les soldats américains, gentils et respectueux, sont néanmoins incapables de comprendre ce qu’ils ont vécu – « effroyable », « inimaginable », il faudra se contenter de ces mots-là.

Linda Van der Meeren invite à son exposition "La Grande Guerre. 100 oeuvres pour cent ans de guerre"
du dimanche 9 au dimanche 16 novembre, de 13h à 18h, à Denderleeuw.
L’espèce humaine, le seul livre qu’ait écrit Robert Antelme juste après la guerre, dédié à sa sœur morte en déportation, est plus qu’un témoignage. Au vécu, il mêle une réflexion sur ce qu’il observe, ce qu’il éprouve. Les SS, dans leur apparent triomphe, ont fabriqué la conscience « irréductible ». « C’est ici qu’on aura connu les estimes les plus entières et les mépris les plus définitifs, l’amour de l’homme et l’horreur de lui dans une certitude plus totale que jamais ailleurs. »
 « Il est révélateur que de tous les grands personnages anglais, celui qui fascinait le plus Zweig était le roi Jean, un homme instable, entreprenant, qui fut non seulement dessiné par William Blake mais mis en scène par Shakespeare. Zweig était fasciné par Blake qu’il décrivait comme « une de ces natures magiques qui, sans voir clairement leur chemin, sont portées par leurs visions, comme par des ailes d’ange, à travers les espaces vierges de l’imaginaire. » Nous sommes loin des goûts simples des Anglais qu’il vantait, « les chats, le football et le whisky ». Stefan Zweig avait acheté le portrait du roi Jean par Blake au début de sa vie de collectionneur et il le conservait jalousement, comme Freud la petite statuette d’Athéna qu’il avait emportée en exil à Londres. « Entre tous mes livres et tous mes tableaux, ce dessin m’a accompagné plus de trente ans ; que de fois depuis le mur, le regard magiquement éclairé de ce roi fou est tombé sur moi ! De tous les biens que j’ai perdus ou qui sont loin de moi, écrit Zweig, c’est ce dessin que je regrette le plus dans mes pérégrinations. Le génie de l’Angleterre que je m’étais efforcé de saisir dans les rues et les villes, s’était brusquement révélé à moi dans la figure véritablement astrale de Blake. »
« Il est révélateur que de tous les grands personnages anglais, celui qui fascinait le plus Zweig était le roi Jean, un homme instable, entreprenant, qui fut non seulement dessiné par William Blake mais mis en scène par Shakespeare. Zweig était fasciné par Blake qu’il décrivait comme « une de ces natures magiques qui, sans voir clairement leur chemin, sont portées par leurs visions, comme par des ailes d’ange, à travers les espaces vierges de l’imaginaire. » Nous sommes loin des goûts simples des Anglais qu’il vantait, « les chats, le football et le whisky ». Stefan Zweig avait acheté le portrait du roi Jean par Blake au début de sa vie de collectionneur et il le conservait jalousement, comme Freud la petite statuette d’Athéna qu’il avait emportée en exil à Londres. « Entre tous mes livres et tous mes tableaux, ce dessin m’a accompagné plus de trente ans ; que de fois depuis le mur, le regard magiquement éclairé de ce roi fou est tombé sur moi ! De tous les biens que j’ai perdus ou qui sont loin de moi, écrit Zweig, c’est ce dessin que je regrette le plus dans mes pérégrinations. Le génie de l’Angleterre que je m’étais efforcé de saisir dans les rues et les villes, s’était brusquement révélé à moi dans la figure véritablement astrale de Blake. »