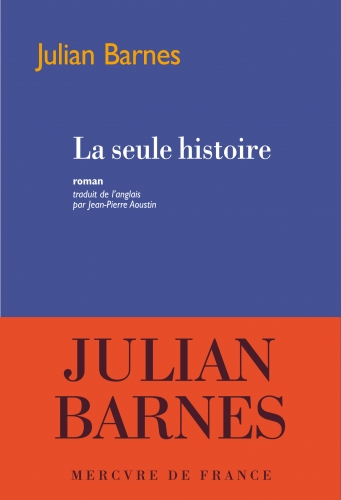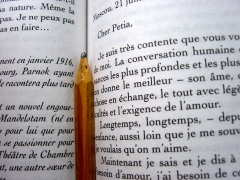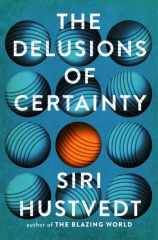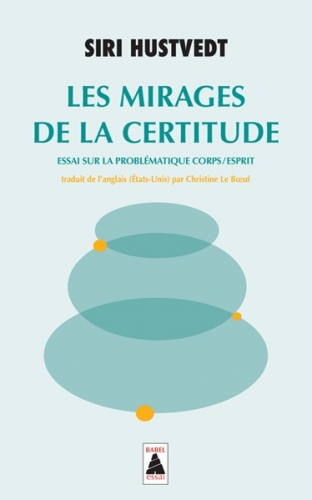La seule histoire de Julian Barnes (2018, traduit de l’anglais par Jean-Pierre Aoustin) s’ouvre sur une épigraphe tirée d’Un dictionnaire de langue anglaise de Samuel Johnson (1755) : « Roman : une petite histoire, généralement d’amour ». Dans notre vie, écrit le narrateur en première page, « il y a d’innombrables événements, dont nous faisons d’innombrables histoires. Mais il n’y en a qu’une qui compte, qui vaille finalement d’être racontée. Ceci est la mienne. »
Dans les années soixante, il habitait « le Village », un secteur de la grande banlieue résidentielle à environ vingt kilomètres au sud de Londres, où il y avait une gare, une place gazonnée pour les parties de cricket, un terrain de golf et un club de tennis. A la fin de sa première année d’université, à la maison pour trois mois, il s’y était inscrit, se doutant bien que la suggestion de sa mère visait à lui faire rencontrer une jeune femme de son milieu, une future épouse.
Trois semaines plus tard, un tirage au sort pour un tournoi amateur double mixte lui avait donné pour partenaire Mrs Susan McLeod – « « sort » est un autre mot pour « destin », non ? » Les cheveux retenus en arrière par un ruban, une tenue blanche à liserés verts, presque exactement de la même taille que lui. Elle avait un jeu élégant et précis, ils avaient gagné le premier match. Quand il l’avait interrogée sur son mari, elle avait ri : « Mr E. P. ? Non. Lui, c’est le golf. »
Il la reconduit chez elle en voiture, plusieurs fois, et sa mère lui lâche un soir : « On fait maintenant le taxi, hein ? » Comme il n’y a « rien » entre eux, sinon une complicité rieuse, Paul Casey se moque de ce que peuvent dire les gens en voyant un jeune homme de dix-neuf dans en compagnie d’une femme de quarante-huit ans. Chez les McLeod, il fait connaissance avec le mari, les deux filles toutes les deux à l’université, reste parfois dîner chez eux.
Un jour, Susan lui tend les clés de leur break Austin pour qu’il la conduise chez son amie Joan, à cinq kilomètres, la sœur survivante de son premier amour, Gerald, mort subitement de leucémie. Joan est une femme corpulente, elle paraît plus âgée, fume et boit beaucoup. Paul, présenté comme le « chauffeur » qui la conduit chez l’ophtalmo, un prétexte, se sent tout de suite à l’aise et plaisante.
Vient le temps des premiers baisers et ce qui s’en suit. Tout lui plaît chez Susan : « Elle rit de la vie, c’est dans sa nature. Et elle est la seule, de sa génération qui a fait son temps (comme elle s’était présentée), à le faire. Elle rit de ce dont je ris. Elle rit aussi en me frappant derrière la tête avec une balle de tennis ; à l’idée de prendre l’apéritif avec mes parents (ce qui n’aura pas lieu) ; elle rit de son mari, comme elle le fait en malmenant la boîte de vitesses du break Austin. Naturellement, je présume qu’elle rit de la vie parce qu’elle en a vu bien des facettes, et la comprend. »
La première des trois parties du roman raconte l’épanouissement, l’enchantement de ce premier amour de Paul. Ils riront tous les deux quand ils seront exclus du club de tennis, et bientôt le besoin de se voir plus souvent, plus longtemps, d’être à eux seuls les amènera à de nouveaux projets qui répondent à leurs désirs. Le narrateur conclut cette partie ainsi : « Quand elle est morte, il y a quelques années, j’ai compris que la part la plus essentielle de ma vie avait finalement disparu. Je penserai toujours à elle en bien, me suis-je promis.
Et voilà comment je me souviendrais de tout cela, si je le pouvais. Mais je ne le peux pas. »
La suite de leur histoire verra d’abord cet amour faire face vaillamment à la vie commune – ils vont s’installer à Londres. Paul continue ses études de droit, puis travaille comme avocat. Susan est souvent seule et ne peut pas échapper totalement à ses affaires familiales. Des aspects de sa personnalité qui avaient échappé à l’attention de Paul vont mettre à l’épreuve non ses sentiments pour elle mais sa capacité à freiner ses démons et à la rendre heureuse.
La seule histoire tourne autour de cette question posée au début : « Préféreriez-vous aimer davantage, et souffrir davantage ; ou aimer moins, et moins souffrir ? C’est, je pense, la seule vraie question. » Avec les années, Paul finira par douter de la corrélation entre force de sentiment et degré de bonheur. Julian Barnes décrit ses personnages avec finesse et lucidité, souvent avec humour. Les décennies d’écart entre cette histoire de jeunesse du narrateur et son point de vue au moment de la raconter en font aussi une réflexion masculine émouvante sur le sentiment amoureux et le passage du temps.