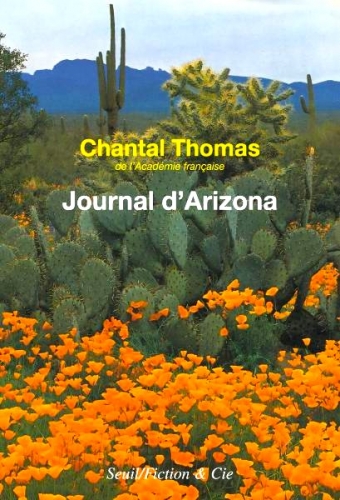Après L’homme sans postérité d’Adalbert Stifter (1805-1868), voici un autre récit court de l’écrivain autrichien : Le sentier dans la montagne (Der Waldsteig, 1845), traduit pour la première fois en français par Germaine Guillemot-Magitot en 1943, quasi un siècle plus tard – c’est le texte réédité par les éditions Sillage. D’autres traducteurs le proposent sous le titre Le sentier (ou Le chemin) forestier.

Adalbert Stifter, Im Gosautal, huile sur toile, 1834
Un de ses bons amis raconte l’histoire de Tiburius, qui l’y a autorisé « dans l’espoir que les extravagants, qui s’entendent si bien à gâcher leur existence par mille sottises, en profiteront ». On disait de Tiburius qu’il était « un original » voire un « fou ». On le disait déjà de son père, un grand extravagant, qui versait toujours dans l’excès, aussi bien pour lui-même que pour ses chevaux ou ses collections. Quant à sa mère, elle le couvait, le gâtait et le protégeait excessivement de tout. Son précepteur et son oncle, un « vieux garçon », ne firent pas mieux.
Cet oncle criait « Tiburius » pour le sortir de ses rêveries, en réalité son neveu s’appelait Théodore Kneight. Après la mort de ses parents, Tiburius, son nom pour tout de monde désormais, avait hérité de leurs propriétés et de leur fortune. Timide, il s’était offert, au début, de beaux vêtements et tout ce qui lui apportait du bien-être. Ses nouvelles activités – musique, dessin et peinture, lecture et collections diverses –, trop tôt abandonnées, ne l’avaient pas empêché de sombrer dans la mélancolie, puis la maladie. Il repoussait tous les conseils de ses amis et s’enfermait en lui-même.
Après le récit de ses infortunes, la suite raconte la « résurrection » de Tiburius. On lui a parlé d’un médecin original arrivé dans le pays, et qui tient davantage à jardiner qu’à exercer son métier. Intéressé, Tiburius décide d’aller le voir pour se faire expliquer un passage obscur d’un ouvrage de Haller. Le docteur lui répond puis lui fait « les honneurs de son jardin ». Tiburius prend alors l’habitude d’aller le voir à Querleithen.
Le jour où il demande au médecin quel remède pourrait soigner son mal, celui-ci lui répond simplement : « Vous marier. Mais auparavant allez faire une cure dans quelque station thermale, c’est là sans doute que vous rencontrerez l’épouse qui vous est destinée. » Tiburius suit son conseil et se rend dans une ville d’eaux d’une vallée alpestre.
Le sentier dans la montagne, en plus de conter sa métamorphose, est une ode aux bienfaits de la montagne. Très prudent dans ses premières promenades, Tiburius va peu à peu se risquer plus loin sur les chemins et en découvrir un, près d’une falaise rocheuse, qui offre des paysages splendides. Laissant son équipage l’attendre en bas près de sa voiture, il ira de plus en plus loin, si loin qu’un jour il se perdra même. Mais il y fera une belle rencontre.
Merci à Dominique et à Aifelle qui m’ont donné envie de lire Stifter. Les monts de Bohême et les forêts profondes de sa région natale l’ont enchanté et inspiré. Il était aussi un bon peintre de paysages. Sa propre vie a été plus douloureuse et frustrée que celle de Tiburius. Adalbert Stifter, à travers l’histoire de ce riche hypocondriaque réputé « fou » qui va trouver la guérison et le bonheur sur ce sentier qui mène dans les bois, écrit une ode aux beautés naturelles, aux plantes, à la marche en montagne, à la vie simple.
Ce « fils d’un tisserand des forêts de Bohême », grand admirateur de Goethe, est devenu à son tour un écrivain important des lettres allemandes du XIXe siècle, admiré de Nietzsche, Hermann Hesse ou Thomas Mann. « Par ce rêve d’une société reposant sur la raison, la beauté et l’humanité, Stifter se sentait un continuateur de Goethe, et il n’a cessé d’affirmer cette parenté, en même temps qu’il proclamait sa volonté de recréer un style classique, « granitique ». Mais la naïveté voulue, la simplicité de son style sont le produit d’un travail inlassable, d’un effort incessant pour vaincre la terreur qui est le sentiment fondamental de son œuvre. » (Encyclopædia universalis)