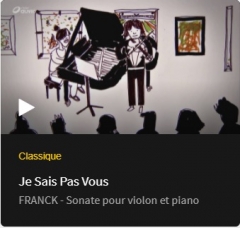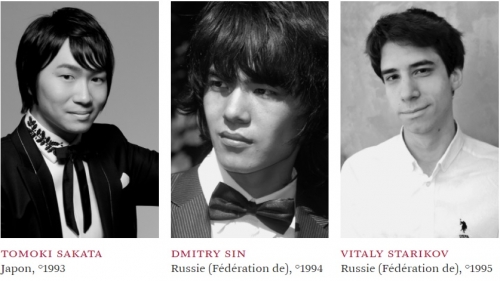Depuis que j’avais vu son Sous-Bois, je me réjouissais à l’idée de découvrir d’autres œuvres textiles d’Elise Peroi. Là où se trouve la forêt, le titre de son exposition au Botanique, est prometteur. Cela vaut la peine de la visiter, bien que l’espace qui y est dédié m’ait déçue, à l’opposé du grand salon ensoleillé de la Maison des Arts de Schaerbeek.

© Elise Peroi, Semer (détail), 2021, lin, soie peinte, bois
(désolée pour le jaunissement des couleurs, photo prise sans flash)
Le Botanique : l’endroit paraissait idéal pour cette artiste. Mes beaux souvenirs de l’orangerie qui s’étire au-dessus des jardins ne m’avaient pas préparée au choc du chantier de restauration en cours. Effacée, la carte postale. C’est une forêt d’échafaudages qu’il faut traverser dans un long couloir puis autour de la rotonde, avant de monter à la « galerie » où n’arrive pas une goutte de lumière naturelle.

Restauration en cours au Botanique
Mais l’exposition nous la rend, la lumière, celle des jardins, des bois, et l’ombre bienfaisante des arbres. Au centre de la salle, Forêt, une enfilade de quatre panneaux, aimante le regard. Près des murs, d’autres œuvres et je commence par celle que j’ai mise en premier, Semer, où l’artiste même semble nous accueillir : une femme se penche vers la terre. Les jeux des fils dans la double chaîne donnent du relief à cette apparition et l’œil s’attarde entre feuillages et fleurs, entre vides et pleins. On retrouvera cette figure dans Clairière, plus loin.

© Elise Peroi, Forêt (détail), 2021, lin, soie peinte, bois
Le premier élément de Forêt – si c’étaient les quatre saisons, ce serait l’hiver – est en noir & blanc, ce qui donne toute une gamme de gris et accentue le contraste entre fils tendus et parties tissées. Dans Ce qu’il reste de gestes, la belle monographie très bien illustrée qui vient de paraître aux éditions CFC, le texte central d’Elise Peroi, « Absence/Présence », s’articule comme ses œuvres dans la dualité : « Pièce et processus », « Corps et outil », « Tisseur et jardinier », « Corps et décor ». Elle y cite entre autres François Cheng et Gilles Clément.

© Photo Thomas Jean Henri / Elise Peroi, Vue d’atelier pour Assemblée, 2017
Je ne vous montre que des détails de cette grande œuvre installée au milieu de la salle – ma photo d’ensemble ne donne pas grand-chose. Le soleil se fraie un chemin entre les feuilles, éclaire un tronc, des branches, l’œuvre invite à se promener dans les quatre temps de ce paysage évoqué avec douceur. Non pas des couleurs passées mais des couleurs, des espaces où l’on passe.
© Elise Peroi, Pour faire une prairie (détail), 2020, lin, graminées
Sur de petites étagères, Elise Peroi a déposé des graines glanées au Jardin Botanique. Des graminées sèches entrent dans le tissage de Pour faire une prairie, créent une bordure naturelle accordée aux fils de lin. C’est beau. Sa pratique artistique établit des liens subtils. On aurait envie de toucher, en plus de regarder.
Là où se trouve la forêt, l’exposition aussi se dédouble : Faire sillons est présenté en parallèle au Centre culturel de La Tour à Plomb. « Exposition miroir en deux lieux distincts », écrit Coline Franceschetto sur le feuillet du Botanique : « visant à mettre en exergue ce paysage dans la mise en perspective de notre système de représentation basé sur la verticalité et l’horizontalité. Une forêt levée, un champ sillonné. »
La grande salle du musée du Botanique accueille l’exposition Home Game de memymom, un duo bruxellois, Marilène Coolens et Lisa De Boeck, mère et fille. Cette rétrospective de plus de de 220 œuvres, de 1990 à aujourd’hui, permet de découvrir le « langage visuel post-moderne attrayant et haut en couleur » de ces autodidactes qui font tout elles-mêmes : « photographie, recherche des décors et des lieux, casting, éclairage et postproduction » (Botanique). Pas d’autoportraits mais des mises en scène. Un univers décalé en guise de « mémoires ». La vidéo proposée sur le site du Botanique présente très bien leur démarche.