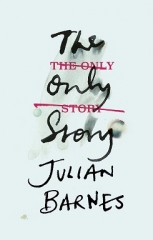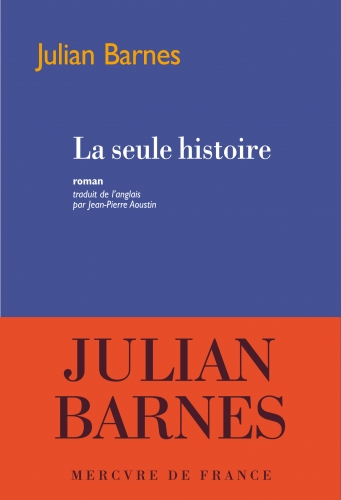Dans Les jardins de Torcello (2024), Claudie Gallay nous emmène de nouveau à Venise. La romancière raconte la vie de Jess, une Française restée à Venise plus longtemps qu’elle ne le pensait, dans un magnifique appartement avec vue sur la Giudecca où elle a rendu quelques services à Pietro Barnes, un chirurgien qui travaille à Milan. Il y passe rarement, il ne lui fait pas payer de loyer.

Jess guide des Français qui la contactent via son site, quatre au maximum par balade, en s’adaptant à leurs demandes. Quarante euros de l’heure, cela lui permet d’assurer le quotidien. Elle connaît bien Venise, ses clients l’apprécient. A travers les balades guidées, nous découvrons des endroits méconnus, des anecdotes sur la ville.
Pietro comptait garder l’appartement, mais six mois plus tard, il confie la vente à une agence immobilière. Jess s’angoisse. Quand il est vendu à des New-Yorkais, il ne reste que quelques mois à la jeune femme pour « vider les armoires, donner les vêtements, la vaisselle, tout ce qui est possible » aux associations pour les pauvres, à la demande du propriétaire. Gentiment, Pietro lui renseigne un ami qui pourrait avoir « besoin d’une fille comme elle » : Maxence Darsène, « avocat, débordé, bordélique », qui habite sur l’île de Torcello.
Jess n’est pas tentée par la campagne. Elle rompt avec Angelo, charmant mais marié, près de qui elle s’ennuie, et se met à chercher un studio au loyer abordable dans le quartier qu’elle aime – « ça va être compliqué ». Quand elle téléphone à son amie Brousse, enceinte, celle-ci donne à Jess des nouvelles de sa mère, qui aurait besoin d’aide à l’hôtel des Géraniums. « Les clients, les douches. Si elle y retournait, elle serait la bonne. Elle avait vu trimer sa mère, sa grand-mère. Elle avait tourné le dos. Elle n’aurait pas la même vie. »
Pour se rendre à Torcello, « la dernière île de la lagune », Jess prend le vaporetto, puis change de bateau jusqu’à cette île où ne restent que quelques maisons, une basilique, et beaucoup d’oiseaux. Une vieille femme lui montre un chemin de terre qui mène à la grille rouillée de l’entrée de la propriété de M. Darsène. Interpellée par le gardien, Elio, Jess aperçoit à l’arrière de la maison un homme dans la soixantaine, « petit gabarit, un peu dégarni » ; c’est Maxence qui doit partir et lui propose de revenir un autre jour.
Elle a déjà fait la connaissance de « Spoontus », le chat de « Max », comme l’appelle Colin, la cinquantaine, les yeux clairs, les cheveux tirés en catogan, qu’elle rencontre à sa deuxième visite. Il la prévient : Maxence peut être insupportable, mais il l’aime « infiniment ». Pour Colin, elle est « la nouvelle bonne », mais Jess a fixé ses conditions. Elle veut bien ranger, repasser, cuisiner, mais pas nettoyer les salles de bains ni les chiottes. A l’étage, l’avocat lui montre une pièce pleine de dossiers à classer, les archives de « trente ans de pénal ». Il lui reste un dernier procès avant d’en finir avec ça. Il aimerait aussi qu’elle s’occupe du chat quand il doit s’absenter.
La vie de Jess continue ainsi : l’appartement à vider, les touristes à guider, la maison de Maxence où son compagnon, quand il ne file pas à la Biennale d’art, sous-titre des séries italiennes. « Colin est italien et parle un français parfait. Maxence est français de père, lyonnais de naissance, et vénitien par sa mère. » Il accorde à Jess un « droit de passage » pour venir travailler là certains jours. Les studios qu’elle visite ne lui plaisent pas ou sont trop chers.
Sur l’île, elle découvre la passion de Maxence pour les jardins autour de la maison (jardins des moines au XVIIe siècle), abîmés par l’acqua alta de 2019 qui les a noyés. Il a entrepris de les recréer, replante à l’identique des vignes, des plantes aromatiques, des légumes… Il reste beaucoup à faire, avec l’aide d’Elio, qui monte un mur entre lagune et maison pour faire rempart à l’eau. Ce « monde à part » plaît beaucoup à Jess qui rend service, nourrit le chat et les chevaux, observe la maisonnée, les relations entre ces trois hommes, leurs invités.
Pour ses vingt-six ans, elle s’offre un tour de gondole. Son amie Brousse ne veut plus parler de ce qui s’est passé au lac avec Moreno, dans le massif du Taillefer, où elles avaient prévu une randonnée entre filles. Moreno les y avait conduites dans sa voiture, à cause d’une batterie à plat. Il l’appelait par son vrai prénom, Louise. Il avait plongé dans le lac, n’était pas remonté, ce souvenir la hante.
Dans Les jardins de Torcello, Claudie Gallay raconte comment la jeune femme s’attache de plus en plus aux habitants de l’île, apprend à les connaître, dans cet endroit hors du commun loin de l’agitation du monde. Les phrases sont simples, souvent courtes, les retours à la ligne nombreux dans ce récit où croît le désir pour Jess, comme pour le lecteur, de rester là. « L’amour est une île », disait un autre de ses romans, en sera-t-il de même ici pour l’amitié ?
 « La porte de la maison rose était grande ouverte, à l’intérieur les furettes faisaient ami-ami avec le chat. Maxence leur a mis des colliers anti-tiques.
« La porte de la maison rose était grande ouverte, à l’intérieur les furettes faisaient ami-ami avec le chat. Maxence leur a mis des colliers anti-tiques.